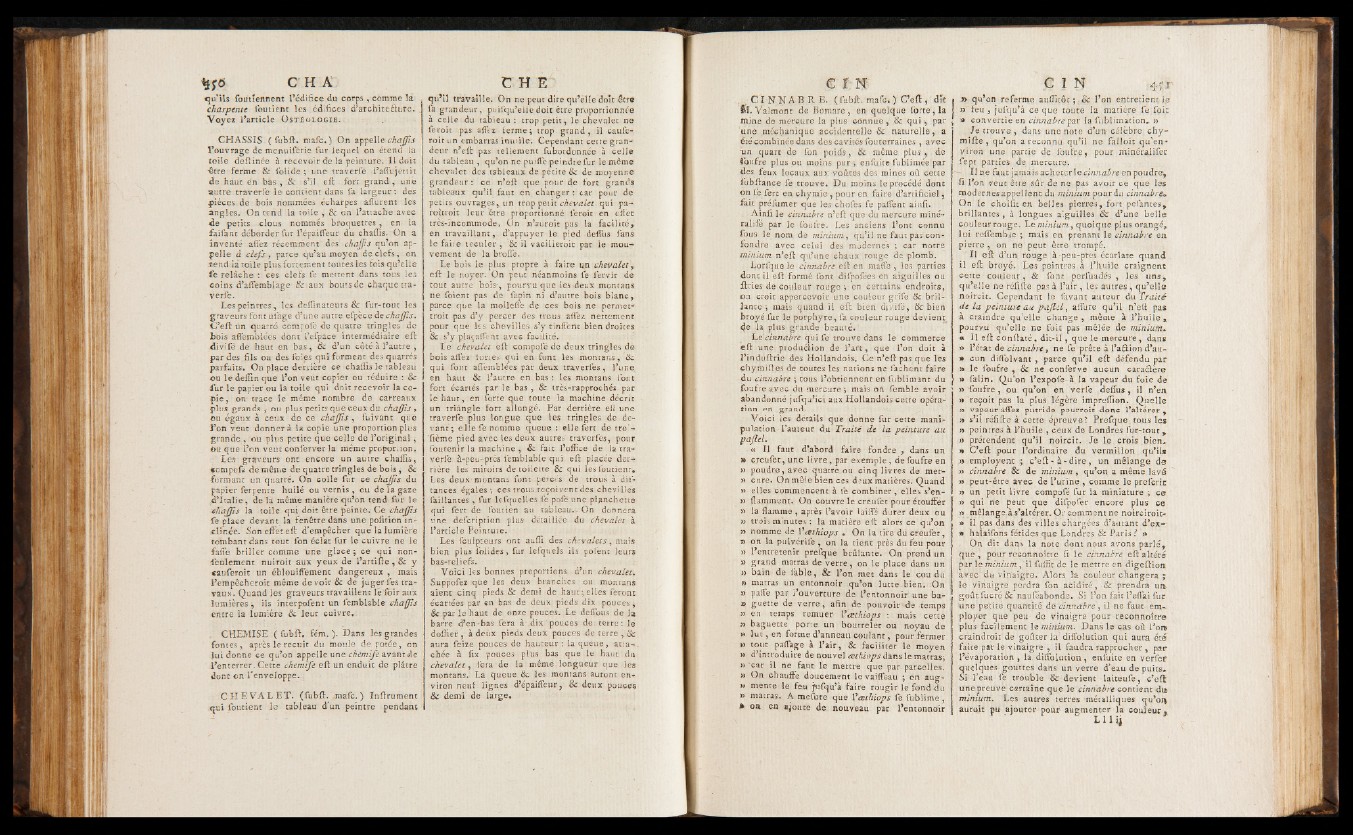
C H A
■ qu’ ils foutîennent l’édifice du corps, comme la
ch a rp en te foutient les édifices d’archite&ure. .
Voyez l ’article O s t é o l o g ie .
CHASSIS (fubft. mafe. ) On appelle chajjfis
l ’ouvrage de menuiférie fur lequel en étend la
toile deftinée à recevoir de la peinture. I l doit
■ être ferme & loiide ; une traverfe l’aflujettit
de haut en bas , & s’ il eft fort grand , une
autre traverfe le contient dans fa- largeur: des
pièces de bois nommées écharpes affiurent les
angles. On tend la toile , & on l’attache avec
de petits clous nommés broquettes , en la
faifant déborder fur l’épaifleur du chaflis. On a
Inventé affez récemment des chajfis qu’on appelle
à clefs y parce qu’au moyen de cle fs , on
Æend là toile plus fortement toutes les fois qu’ elle
le relâche : ces clefs fe mettent dans tous les
coins d’aflemblage & aux bouts de chaque traverfe.
Les peintres , lçs cfeflinateurs & fur-tout les
graveurs font ufage d’ une autre efpèce de chajjfis.
C ’eft un quatre compofé de quatre tringles de
bois aflemblées dont l’efpace intermédiaire eft
divîfé de haut en bas, & d’ un coté à l ’autre ,
par des fils ou des foies qui forment des quarrés
parfaits. On place derrière ce chaflis le tableau
ou le deflin que l’on veut copier ou réduire : 8c J
iu r le papier ou la toile qui doit recevoir la cop
ie , on trace le même nombre de carreaux
plus grands , ou plus petits que ceux du chafjïs,
ou égaux à ceux de ce chajjfis , fuivant que
J’on veut donnera la copie une proportion plus
grande , 'ou plus petite que celle de l’original,
Ou que l’on veut conferver la même proportion.
Les graveurs ont encore un autre chaflis,
9cmpcjfi de même de quatre tringles de bois, &
formant un quarré. On colle fur ce chajjis du
papier ferpente huilé ou vernis , ou de la gaze
.d’ Italie, de la même manière qu’ on tend fur le
ehajfîs la toile qui doit être peinte. Ce chajfis '
fe place devant la fenêtre dans une polïtion inclinée.
Son effet eft d’ empêcher que la lumière
tombant dans tout fon éclat fur le cuivre ne le
fafle briller comme une glace ; ce qui non-
'feùlement nuiroit aux yeux de l’artifte, & y
«auferoit un éblouifiement dangereux , mais
l ’empêcheroit même de voir & de juger fies travaux.
Quand les graveurs travaillent le foir aux
lumières , ils interpofent un femblable chafjfis
entre la lumière & leur cuivre,.
„ CHEMISE ( fubft. fém. ). Dans les grandes
fontes, après le recuit du moule de potée, on
lui donne ce qu’ on appelle une chemife avant de
l’enterrer. Cette chemife eft un enduit de plâtre
dont on l ’enveloppe.
C H E V A L E T , (fubft. mafe. ) Infiniment
qui foutient le tableau d’un peintre pendant
C H E
qu’ il travaille. On ne peut dire qu’elle doit êtr«
fa grandeur, puilqu’eile doit être proportionnée
à celle du tableau : trop petit, le chevalet ne
feroit pas aflez ferme; trop grand, il caufe-
roit un embarras inutile. Cependant cette grandeur
n’eft pas tellement fubordonnée à celle
du tableau , qu’on ne puifle peindre fur le même
chevalet des tableaux de petite & de moyenne
grandeur : ce n’eft que pour de fort grands
tableaux qu’il faut en changer : car pour de
petits ouvrages,, un trop petit c h e v a l e t qui pa-
foîtroit leur être proportionné feroit en effet
très-incommode. On n’auroit pas la facilité,
en travaillant, d’appuyer le pied deflus fans
le faite teculer , & il vacilieroit par le mouvement
de la brofle.
Le bois le plus propre à faire un c h e v a l e t ,
eft le noyer. On peut néanmoins le fiervlr de
tout autre bois-, pourvu que les deux montans
ne foient pas de. fapin ni d’autre bois blanc,
parce que la mollefle de ces bois ne permet-*
troit pas d’y percer des trous aflez. nettement
pour que les chevilles s’y unifient bien droites
& s’y plaçaient ave« facilité.
l e c h e v a le t eft compofé de deux tringles de
bois allez- foriés qui en font les montans, 6c
qui font aflemblées par deux traverfes, l’une
en haut 8c l’autre en bas : les montans font
fort écartés par le bas, & irès-rapprochés par
le haut, en forte que toute la machine décrit
un triangle fort allongé. Par derrière efl une
traverfe plus longue que les tringles de devant;
e lle fe nomme queue : elle fert de tro!-
fième pied avec les deux autres traverfes, pour
foutenir la machine , & fait l’office de la traverfe
à-peu-près femblable qui eft placée derrière
les miroirs de toilette & qui les loutienr*
Les deux montans font percés de trous à dil-
tances. égales ; ces trous reçoivent des chevilles
{’aillantes , fur .le{quelles fe pôle une planchette
qui fert de foutien au tableau.- On donnera
une defeription plus détaillée du c h e v a le t à
l’article Peinture.
Les fculpteurs ont aufli des c h e v a l e t s , mais
bien plus lolides, fur lefquels ils pofient leurs
bas-reliefs.
Voici les bonnes proportions d’ un c h e v a l e t .
Suppofez que les deux branches ou montans
aient cinq pieds & demi de haut; elles feront
écartées par en bas de deux pieds dix pouces,
& par le haut de onze pouces. Le deflous de Ja
barre d’en-bas fera à dix pouces de; terre: le
doflier, à deux pieds deux pouces de terre , &
aura feize pouces de hauteur: laqu eue, at;a-.
chée à fix pouces plus bas que le haut du
c h e v a l e t y fera de la même longueur que les
montans. La queue 8c les montans auront environ
neuf lignes d’épaifleur, & deux pouces
& demi de large.
e fN
C I N N A B R E. ( fubft. mafe. ) C’e f t , dit
M. Valmont de Bomare, en quelque forte*, la
mine de mercure la plus connue, & q u i-, par
unè méchanique accidentelle 8c naturelle, a
été combinée dans des cavités fouterraines , avec
im quart de fon poids, & même plus , de
fToufre plus ou moins pur ; enfuite fubliméeîpar
des feux locaux aux voûtes des mines où cette
lubftance fe trouve. Du moins le procédé dont
on fie fert en chymie , pour en faire d’artificiel,
fait préfumer que les chofes fe paflent ainfi.
Ainfi le c i n n a b r e n’eft que du mercure minéral’fé
par le foutre. Les anciens l’ont connu
fous le nom de m in iu m ., qu’ il ne faut pas confondre
avec celui des modernes ; car notre
m in iu m n’eft qu’une chaux rouge de plomb.
Lorique le c in n a b r e eft en malfe , les parties
dont il eft formé font difpofées en aiguilles ou
ftries de couleur rouge ;.en certains endroits,
on croit apperccvoir une couleur grifie 6c brillante
; mais quand il eft bien divifé, & bien
broyé fur le porphyre, fa couleur rouge devient
de M plus grande beauté.
Lé c i n n a b r e qui fe trouve dans le commerce
e ft une produélion de l’ar t, que l’on doit à
l’ indûftrie des Hollandois. Ce n’eft pas que les
chymiftes de toutes les nations ne fâchent faire
du c i n n a b r e ; tous l’obtiennent en fublimant du
foutre avec du mercure ; mais on femble avoir
abandonné jufqu’ici aux Hollandois cette opération
en grand.
Voici les détails que donne fur cette manipulation
l’auteur du T r a i t é de l a p e i n t u r e a u
p a j l e l .
« Il faut d’abord faire fondre , dans un
» creufet, une livre , par exemple, de foufre en
» poudre, avec quatre ou cinq livres de. mer-
» cure. On mêle bien ces deux matières. Quand
» elles commencent à le combiner, elles s’en-
» flamment. On couvre le creufet pour étouffer
» la flamme , après l’avoir laiffs durer deux ou
» trois minutes : la matière eft alors ce qu’on
» nomme de Voethiops . On la tire du creufet,
» on la pulvérife, on la tient près du feu pour
» l’entretenir prefque brûlante. On prend un
» grand matras de verre, on le place dans un
» bain de fable, & l’on met dans le cou du
d matras un entonnoir qu’on lutte.bien. On
» pafle par i’ouverture de l’entonnoir une ba-
» guette de v erre, afin de pouvoir de temps
» en temps remuer Vcethiops : mais cette
» baguette porte un bourrelet ou noyau de
» lu t , en forme d’anneau coulant, pour fermer
» tout pairage à l’air, & faciliter le moyen
» d’introduire de nouvel aethiops dans le matras;
» "car il ne faut le mettre que par parcelles.
» On chauffe doucement le vaiffeau ; on aug-
» mente le feu j'ufqu’à faire rougir le fond du
» matras. A mefure que Væthiops fe fublime,
* oa en ajoute de nouveau par l ’entonnoir
C I N
f» qu’ on referme auflitôt; .& l’on entretient le
» feu , jufqu’ à ce que toute la matière fe loic
,t » convertie en cinnabre par la fublimation. j>
Je trouve , dans une note d’un célèbre, ch y -
m ifte , qu’on a reconnu qu’ il ne falloit qu’en-
viron une partie de foufre, pour minéralifer
fepe partiel- de mercure.
—■ Il ne faut-jamais acheter le cinnabre en poudre,
n l’on veut être sûr de ne pas avoir ce que les
modernes appellent du miniuni pour du cinnabre»
On le choifit en belles pierres, fort pefantes,
brillantes , à longues aiguilles & d’une belle
couleur rouge. Le minium, quoique plus orangé,
lui reffemble ; mais en prenant le cinnabre en
pierre, on ne peut être trompé.
I l eft d ’ un rouge à -peu-près écarlate quand
il eft broye> Les peintres à l’ huile craignent
cette coujeur , & font perfuadés , les uns,
qu’elle ne réfifte pas à l’air , les autres , qu’elle
noircit. Cependant le favant auteur du Traité
de la peinture au p a f l e l ^ aflure qu’ il n’ eft pas
à craindre qu’elle change , même à l’huile *
pourvu qu’efle ne foit pas mêlée dé minium»
« Il eft conftaté, d it- il, que le mercure, dans
» l’état de cinnabre, ne fe prête à l’a&ion d’au-
» cun diflolvant, parce qu’ il eft défendu par
» le foufre , & ne confierve aucun cara&ere
» faljn. Qu’on l’expofe-à la vapeur du foie de
>5 foufre , ou qu’on en verfe deflus, il n’ en
» reçoit pas la plus légère impreflion. Quelle
>j vapeur aflez putride pourroit donc l’altérer,
» s’il réfifte à cette, épreuve? Prefque, tous les
» peintres à Fhuile , ceux de Londres fur-tout y
» prétendent qu’ il noircit. Je le crois bien»
n C’ eft pour l’ordinaire du vermillon qu’ ils
» employent ; c’e f t - à - d i r e , un mélange de
» cinnabre & de minium, qu’on, a même lavé
» peut-être avec de l’urine , comme le preferit
n un petit livre compofé fur la miniature ; ce
» qui ne peut que difpofer encore' plus ce
» mêlange;à s’altérer. Or comment ne noirciroit-
» il pas dans des villes chargées d’autant d’ex -
» halaifons fétides que Londres & Paris ? »
On dit dans la note dont nous avons parlé,
que , pour reconnaître fi le cinnabre eft akéré
par le minium, il fuffit de le mettre en digeftion
avec du vinaigre. Alors la couleur changera ;
le vinaigre perdra fon acidité, & prendra un
goûtfucré & nauféabonde. S i l’on fait l’ eflai fur
une 'petite quantité de cinnabre, il ne faut employer
que peu de vinaigre pour reconnoître
plus facilement le minium. Dans le cas où l’on?
craindroit de goûter la diflolution qui aura été
faite par le vinaigre , il faudra rapprocher , par
l’évaporation , la diflolution, enfuite en verfer
quelques gouttes dans un verre d’eau de puits»
Si Teaù fe trouble & devient laiteufe, c’eft
une preuve certaine que le cinnabre contient dit
minium. -Les autres terres métalliques qu’orç,
auroit pu ajouter pour augmenter la couleur
L 11 ij