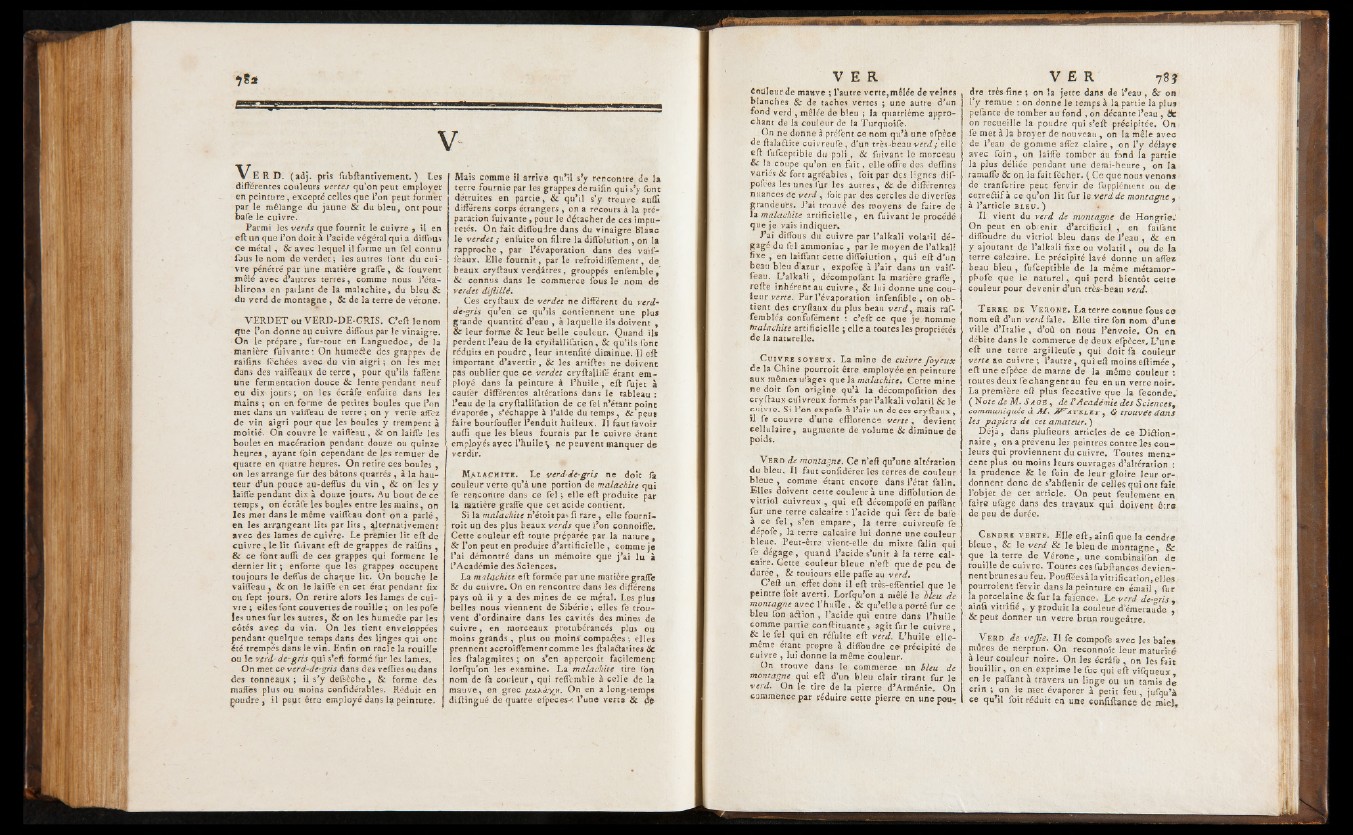
V
^V/e R D. (adj. pris fubftantivement. ) Les
différentes couleurs vertes qu’on peut employer
en peinture, excepté celles que l’on peut former
par le mélange du jaune & du bleu, ont pour
bafe le cuivre.
Parmi les verds que fournit le cuivre , il en
eft un que l’on doit à l’acide végétal qui a diffous
c e métal, & avec lequel il forme un fel connu
fous le nom de verdet-, les autres font du cuivre
pénétré par une matière grade, & fouvent
mêlé avec d’autres terres, comme nous l’établirons
en parlant de la malachite, du bleu &
du verd de montagne , & de la terre de vérone.
VERDET ou VERD-DE-GRIS. C’eftlenom
que l’on donne au cuivre diffous par le vinaigre.
On le prépare, fur-tout en Languedoc, de la
manière fuivante: On humeâe des grappes de
raifins léchées avec du vin aigri ; on les met
dans des vaiffeaux de terre, pour qu’ ils fafl'ent
une fermentation douce & lente pendant neuf
©u dix- jours ; on les écrâfe enfuire dans les
inains ; on en forme de petites boules que l’ on
met dans un vaiffeau de terre ; on y verfe affez
de vin aigri pour que les boules y trempent à
moitié. On couvre le vaiffeau, & on laiffe les
boules en macération pendant douze ou quinze
heures , ayant foin çependant de les remuer de
quatre en quatre heures. On retire ces boules ,
on les arrange fur des bâtons quarrés , à la hauteur
d’un pouce au-deffus du vin , & on les y
lailfe pendant dix à douze jours. Au bout de ce
temps , on écrâfe les boules entre les mains, on
les mec dans le même vaiffeau dont on a parlé ,
en les arrangeant lits par lits , alternativement
avec des lames de cuivre» Le premiei lit eft de
cuivre , le lit fuivant eft de grappes de raifins ,
& ce font aufli de ces grappes qui forment le
dernier lit ; enforte que les grappes occupent
toujours le deifus de chaque lit. On bouchç le
vaiffeau , & on le lailfe en cet état pendant fix
ou fept jours. On rerire alors les lames de cuivre
; elles font .couvertes de rouille ; on les pofe
les unes fur les autres, & on les humede par les
côtés avep du vin. On les tient enveloppées
pendant quelque temps dans des linges qui ont
été trempés dans le vin. Enfin on racle la rouille
ou le ver il- de-gris qui s’eft formé fur les lames.
On met ce verd-de-gris dans des veffies ou dans
des tonneaux ; il s’y defsèche, & forme des
maffës plus ou moins cenfidérables. Réduit en
poudre, il peut être employé dans la peinture.
Mais comme il arrive qu’ il s’y rencontre de la
terre fournie par les grappes de raifin qui s’y font
détruites en partie, & qu’ il s’y trouve aufli
diftërens corps étrangers , on a recours à la préparation
fuivante, pour le détacher de ces impuretés.
On fait diffoudre dans du vinaigre Blanc
le verdet ; enfuite on filtre la diffolution , on la
rapproche , par l’évaporation dans des vaif-
feàux. Elle fournit, par le refroidiffement, de
beaux cryftaux verdâtres , grouppés enfemble /
& connus dans le commerce ious le nom de
verdet diflillê.
Ces cryftaux de verdet ne different du verd*
de-gris qu’en ce qu’ ils contiennent une plus
grande quantité d’eau , à laquelle ils doivent ,
& leur forme & leur belle couleur. Quand ils
perdent l’eau de la cryrtallifaticn, & qu’ils font
réduits en poudre, leur intenfité diminue. Il eft
important d’avertir, & les artiftes ne doivent
pas oublier que ce verdet cryftaliifé étant employé
dans la peinture à l’huile , eft fujet à
caulèr differentes altérations dans le tableau :
l’ eau de la cryftallifation de ce fel n’étant point
évaporée , s’ échappe à l’aide du temps, & peut
faire bourfoufler l’enduit huileux. Il faut lavoir
auifi que les bleus fournis par le cuivre étant
employés avec l ’huile^ ne peuvent manquer de
verdir.
Ma l a ch it e . Le verd-de-gris ne doit là
couleur verte qu’ à une portion de malachite qui
fe rencontre dans ce fel ; elle eft produite par
la matière graffe que cet acide contient.
Si la malachite n’étoit pas fi rare, elle fourni-
roit un des plus beaux verds que l’on çonnoiffe.
Cette eouleur eft toute préparée par la nature ,
& l’on peut en produire d’artificielle , comme je
l’ ai démontré dans un mémoire que j ’ai lu à
l’Académie des Sciences.
La malachite eft formée par une matière graffe
& du cuivre. On en rencontre dans les differens
pays où il y a des mines de ce métal. Les plus
belles nous viennent de Sibérie •, elles fe trouvent
d’ordinaire dans les cavités des mines de
cuivre, en morceaux protubérances plus ou
moins grands, plus ou moins" compares -, elles
prennent aeproiffemenr comme les ftala&atites 8c
ies ftalagnjites ; on s’en apperçoit facilement
lorfqu’on les examine. La malachite tire Ion
nom de fa couleur, qui reffemble à celle de la
mauve, en grec p.a.Ku.'yjn. On en a long-temps
diftingué de quatre efpèces-c l’ une vert« & difr
Couleur de mauve ; l’autre verte,mêlée de veines
blanches 8c de taches vertes ; une autre d’un
fond verd , mêlée de bleu ; la quatrième approchant
de la couleur de la Turquoife.
On ne donne à préfent ce nom qu’à une efpèce
de ftalaélite cuivreufe , d’un très-beau vezd; elle
eft (ufceptible du poli , 8c fuivant le morceau
& la coupe qu’on en fa it, elle offre des deffins
variés 8c fort agréables, foit par des lignes dif-
pofées les unes fur les autres, 8c de différentes
nuances de verd , foit par des cercles de diverfes
grandeurs. J’ai trouvé des moyens de faire de
la malachite artificielle, en fuivant le procédé
que je vais indiquer»
J’ai diffous du cuivre par l’alkali volanl dégagé
du fel ammoniac , par le moyen de l’alkalr
fixe , en laifiànt cette diffolution , qui eft d’ un
beau bleu d’azur , expofée à l’air dans un vaiffeau.
L’alkali , décoinpofant la matière graffe ,
refte inhérent au cuivre, & lui donne une coule
ur verte. Par l’évaporation infenfible, on obtient
des cryftaux du plus beau verd, mais raf-
femblés confufément : c’eft ce que je homme
malachite artificielle ; elle a toutes les propriétés
de la naturelle.
Cuivre soyeux. La mine de cuivre Joyeux
de la Chine pourroit être employée en peinture
aux mêmes ufages que la malachite. Cette mine
ne doit fon origine qu’à la décompofition des
cryftaux cuivreux formés par l’alkali volatil & le
cuivie. Si l’on expofe à l’air un de ces cryftaux
îl fe couvre d’une efflorence verte , devient
cellulaire, augmente de volume & diminue de
poids.
Verd de montagne. Ce n’eft qu’ une altération
du bleu. I l faut confidérer les terres de couleur
bleue , comme étant encore dans l’état falin.
Elles doivent cette couleur à une diffolution de
vitriol cuivreux , qui eft décompofé en partant
fur une terre calcaire : l’acide qui fert de baie
a ce f e l , s’en empare, la terre cuivreufe fe
dépofe, la terre calcaire lui donne une couleur
bleue. Peut-être vient-elle du mixte falin qui
fe dégage, quand l ’acide s’unit à la terre calcaire.
Cette couleur bleue n’eft que de peu de
durée , 8c toujours elle paffe au verd,
C e ft un effet dont il eft très-effentiel que le
peintre foit averti. Lorfqu’on a mêlé le bleu de
montagne avec 1 huile, & qu’elle a porté fur ce
bleu fon aélion , l’acide qui entre dans l ’huile
comme partie conftituantè, agit fur le cuivre,
& le fel qui en réfulte eft verd. L’huile elle-
même étant propre à diffoudre ce précipité de
cuivre , lui donne la même couleur.
On trouve dans le commerce un bleu de
montagne qui eft d’un bleu clair tirant fur le
verd. On le tire de la pierre d’Arménie. On
commence par réduire cette pierre en une poudre
très fine ; on la jette dans de l'eau , 8c on
l ’y remue : on donne le temps à la partie la plue
pefante de tomber au fond , on décante l’eau , 8c
on recueille la poudre qui s’eft précipitée. On
fe met à la broyer de nouveau , on la mêle avec
de l’eau de gomme affez c la ire, on l’y délaye
avec fo in , on laiffe tomber au fond la partie 13 plus déliée pendant une demi-heure , on la
ramaffe & on la fait féchèr. ( Ce que nous venons
de tranferire peut fervir de fupplément ou de
corre&if à ce qu’on lit fur le verd de montagne ,
à l’article bleu. ) *
Il vient du verd de montagne de Hongrie*1
On peut en obtenir d’ artificiel , en faifanc
diffoudre du vitriol bleu dans de l’eau , & en
y ajoutant de l’alkali fixe ou v o la t il, ou de la
terre calcaire. Le précipité lavé donne un affez
beau bleu , fufceptible de la même métamor-
phofe que le naturel, qui perd bientôt cette
couleur pour devenir d’un très-beau verd.
T erre de Verone. L a terre connue fous ce
nom eft d’ un verd fale. Elle tire fon nom d’ une
ville d’ Italie , d’où on nous l’envoie. On en
débite dans le commerce de deux efpèces. L’une
eft une terre argilleufe , qui doit fa couleur
verte an cuivre -, l’autre, qui eft moins eftimée ,
eft une efpèce de marne de la même couleur :
toutes deux (échangent au feu en un verre noir.
La première eft plus feccativc que la fécondé»
(N ote de M .S aqs , de P Académie des Sciences9
communiquée à M. ^ a te lEt , & trouvée dans
les papiers de cet amateur, )
Dé jà, dans plufieurs articles de ce Diétion-
naire , on a prévenu les peintres contreles couleurs
qui proviennent du cuivre. Toutes menacent
plus ou moins leurs ouvrages d’altération :
la prudence & le foin de leur gloire leur or-,
donnent donc de s’abftenir de celles qui ont fait
l’objet de cet article. On peut feulement en
faire ufage dans des travaux qui doivent être
de peu de durée.
Cendre verte. Elle eÛ , ainfi que la cendre
bleue, & le verd 8c le bleu de montagne, &
que la terre de Vérone, une combinaifon de
rouille de cuivre. Toutes ces fubftances deviennent
brunes au feu. Poufféesà la vitrification, elles
pourroient fervir dans la peinture en émail, fur
la porcelaine & fur la faïence. Le verd de-gris ,
ainfi vitrifié , y produit la couleur d’émeraude ,
& peut donner un verre brun rougeâtre.
Verd de veffîe. Il fe compofe avec les baie»
mûres de nerprun. On reconnoît leur maturité
à leur couleur noire. On les écrâfe , on les fait
bouillir, on en exprime le fuc qui eft vifqueux
en le paffant à travers un linge ou un tamis de
crin ; on le met évaporer à petit fe u , jufqu’à
ce qu’ il foit réduit en une confiftance de iaiel.