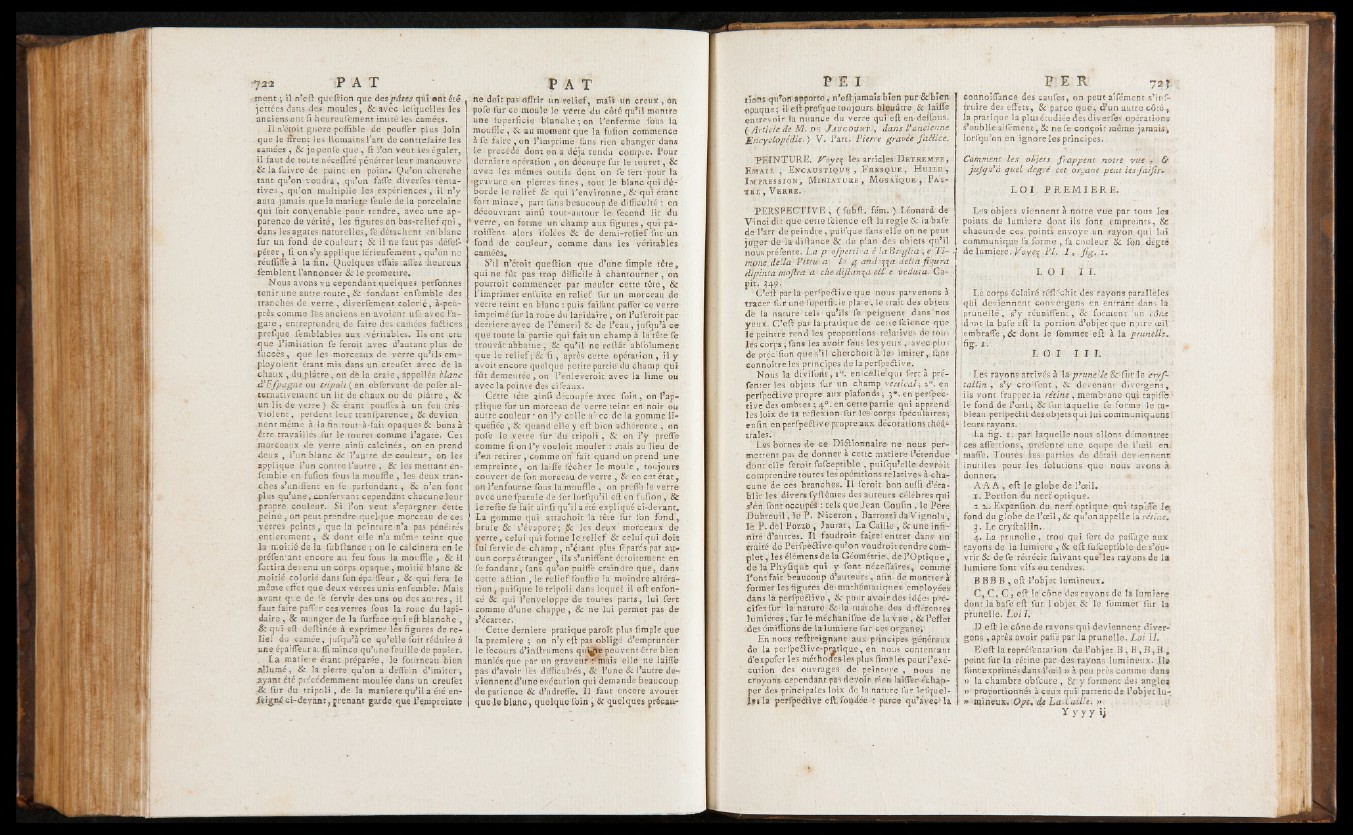
ment ; il n’eft qiieftion que d e s ^ w q u i «ntété
jettées dans des-moules , & avec leCqueîles Jes
anciens ont fi heureufement imité les camées.
I ln ’étoit guere pcffible de pouffer plus loin
que le firent les Romains l’art de contrefaire les
camées , & je penfe que , fi l’on veut les égaler,
il faut de toute nécefuté pénétrer leur manoeuvre
& la fuivre de point en point. Qu’on .cherche !
tant qu’on voudra, qu’on faffe diverfes»tentatives
, qu’on multiplie les expériences , il n’y :
aura jamais que la matière feule de la porcelaine
qui foit convenable pour tendre, avec une apparence
de vérité, les figures en basr'relief q u i,
dans les agates naturelles , fe détachent -tnblanc
lur un fond de couleur; & il ne faut pas défel-
pérer, fi on s’y applique lerieufement, qu’on ne
réufiiffe à la fin. Quelques effais allez heureux
femblent l’annoncer & le promettre.
Nous avons vu cependant quelques perlbnnes i
tenir une autre route, 8c fondant enfemble des
tranches de v erre, diverfement colorié, à-peù-
près comme les anciens en avoient ufé.avec l’agate
, entreprendre, de faire des camées faélices
prefque femblables aux véritables. Ils ont cru
que l’imitation fe feroit avec d’autant plus de
faccès , que les morceaux de verre qu’ ils em-
ployoient étant mis dans un creufet avec de la
chaux , -du plâtre, ou d’e la craie, appellée blanc
cPEfpagne ou tripoli (en obferyant de pofer alternativement
un lit de chaux ou de plâtre , &
un lit de verre) & étant pouffes à un feu très-
violent , perdent leur tranfparence >.& devien
nent meme à la fin tout-à-fait opaques & bons à
être travaillés-fur le touret comme l’agate. Ces
morceaux de verre ainfi calcinés, on en prend
deux , l’ un blanc & l ’autre de couleur, on les
applique l’ un contre l’autre , , & les mettant en-
femblè en fufion fous la mouffle , les deux tranches
s’unifient en fe parfondant, & n’en font
plus qu’une,^çonfervant cependant chacune leur
propre couleur. Si l’ on veut s’épargner dette
peine, on peut prendre quelque morceau de ces
.verres peints, que la peinture n’a pas pénétrés
entièrement, & dont' elle n’a même teint que
la moitié de la fu b fiance ; on le calcinera en le
préfen ant encore au feu fous la mouffle , & il
for tir a devenu un corps opaque, moitié blanc &
moitié colorié dans fon épa'-ffeur, & qui fera le
même effet que deux verres unis enfemble. Mais
avant que de fe fervir des uns ou des autres , il
faut faire paffer ces.verres fous la roue du lapidaire
, & manger de la furface qui eft blanche ,
& qui eft deftinée à exprimer les figures de relie
f du camée, jufqu’ à c e qu’elle foit réduite à
une épatfleur a: ffl mince qu’une feuille de papier,
La matière étant préparée, le fourneau bien
allumé, & la pierre qu’on a déffein d’ imiter;,,
ayant été précédemment moulée dans un creufet
fur dit tripoli , de la maniéré qu’ il a été en-
fHgné ci-deyant, prenant garde que l ’empreinte
ne doit pas offrir un relief, mâî§ un creux , on
pofe 1 tir ce moule le verte du côté qu’ il montre
une luperficie blanche ; on l’enferme foUs la
mouffle, & au moment que la fufion commence
a fe faire , on l’imprime fans rien changer dans
le procédé dont on a déjà rendu compte. Pour
derniere opération , on découpe fur le touret, &
avec les mêmes outils dont on fe l'ert pour la
‘gravure en pierres fines, tout le blanc qui déborde
le relief & qui l’environne, & qui étant
fort mince, part fans beaucoup de difficulté : en
découvrant ainfi tout-autour le- fécond lit du
‘ verre, on forme un champ aux figures, qui pa-
roiffent alors ifolées 8c de demi-relief fur un
fond de couleur, comme dans les véritables
caméês.
S’il n’étoit queftion que d’une fimple tête,
qui ne fût pas trop difficile à chantourner , on
pourroit commencer par mouler cette tête, &
l’imprimer enfuite en relief fur un morceau de
verre teint en blanc : puis faifant paffer ce verre
imprimé fur la roue du lapidaire , on l’uferoit par
derrière avec de l’émeril & de l’eau, jufqu’à ce
que toute la partie qui fait un champ à là'tête fe
trouvât abbatue, & qu’ il ne reftât abfolument
que le relief;i& fi , après cette opération , il y
avoit encore quelque petite partie du champ qui
fût demeurée , on l’enleveroit avec la lime ou
avec la pointe des ci féaux.
Cette tête ainfi découpée avec loin , on l’applique
fur un morceau de verre teint en noir ou
autre couleur : on l’y collé av ec de la gomme liquéfiée
, & quand elle y eft.bien adhérente , on
pofe le .verre fur du tripoli, & on l’y preffe
comme fi on l’y vouloir mouler : mais au lieu de
l’ en retirer , comme on’ fait quand on prend une
' empreinte, on laiffe fécher le moule, toujours
couvert de for. morceau de verre , & en cet état,
on l ’enfourne fous la mouffle , on preffe le verre
avec une fpatule de fér lorfqu’ il eft en fufion , &
| lerefte fe fait ainfi qu’ii a été expliqué ci-devant.
La gomme qui attachoit la tête fur fon fond’,
brûle & s’évapore; & les deux'morceaux de
yerre, celui qui forme le relief & celui qui doit
lui fervir de champ, n’étant plus féparés par aucun
corps-étranger , ils s’uniffent étroitement ën
fe fondant, fans qu’oi? puiffe craindre que, dans
cette aétion , le relief fouffre la moindre altération,
puifque le tripoli dans lequel il efi: enfoncé
& qui l’enveloppe de toutes-parts, lui fert
comme d’une chappe , & ne lui permet pas de
s’écarter..
Cette derniere pratique paroît plus fimple que
la première ; on n’y eft pas obligé d’emprunter
le fecours d’in ftru mens quille peuvent être bien.1
maniés que par un graveur :*mais elle ne laiffe
pas d’avoir les difficultés, 8c l’une 8c l’autre de-*
viennent d’une exécution qui demandé beaucoup
de patience & d’adrefie. Il faut encore avouer
c[ue le blanc, quelque foin , & quelques précaur
tîons qu’on apporté, n’eft jamais bîën pur 8cblen
opaque ; il eft:-prefque toujours hleuâtre & laiffe
entrevoir la nuance du verre qui eft en-deffous,
{•Article de M . d e J au co u r± \ dans Vancienne.
Encyclopédie. ) V- l’arc. Pierre gravée fa â ic e .
PEINTURE. Voye\ les articles D etrempe,
Em a il ' , Encaustique , E resque, Huile;,
I mpression, Min ia tur e , Mosaïque > Pa stel;
, V erre. ■
PERSPECTIVE , ( fubft. fém. ) Léonard de
Vinci dit que cette lcience eft la réglé & la bafe
de l’art de peindre, puifque fans elle on ne peut
juger de là- diftance & du plan des objets qu’ il
nous préiente. ha p ofpetti a è la BrigUa, e Ti~
mçne.de'.la PittUi a' h g ahd:-{\a delta figura
dipinta moflrd a che- dißiimyielf e veduta. Ca- .
Pir- W - „ ‘ . •
C’eft par la pertpectiive que nous parvenons a
tracer fur une fuperficie plate-, le trait des objets
db la nature tels qu’ ils fe peignent dans 'nos
yeux. C’ e fi par la pratique de cetcefcience que
lé peintre rend les proportions relatives de tous
lés corps; fans les avoir fous les yeux g avec plu -
de précifion que:s’ il cherchoità le^ im ite r fan s
connaître les principes de la perfpeélive.
Nous la divifoiîs, i ‘*. en-celle’qui fert à pré-
fenter les objets fur un champ vertical-, z°. en
përfpeélive propre aux plafonds; 3®. en perfpec-
tivedes ombres ; 40. en cette partie qui apprend
les loix de la réflexion furies corps fpéculaires ;
enfin en perfpeélive propre aux décorations théâtrales.’;
'
Les bornes de -ce Diélionnaire ne nous per-1
mettent pas de donner à cette matière I’-érendüe
dont elle feroit fufcepribïe , puifqu’elle-devroit
comprendre toutes les opérations relatives à-cha-
cune de pes branches.. Il feroit bon auffi d’établir
les divers fyftêmes des auteurs: célébrés qui
s?ên font occupés : tels que Jean Coufin , le Père
Dubreuil, le P. Niçeron , Barrozzi d'aVignoh ,
le P. dël Pozzb , Jaurat, La Caille , &une infinité
d’autres. Il faudroit faiyei entrer dans unr
traité de Perfpeélive qu’on voudroit rendre complet
, les élémens de là Géométrie, de l’Optique,
de là Phyfiqu'è qui y font néiteffalre's, comme
l’ont fait beaucoup d’au-teurs , afin de montrer à
former les figures dé‘mathématiques employées
dans là perfpeélive , & pour avoir des'idées p?c-
cifés fur* la nàture & la;marohè des différentes
lumières -, fur lé méchanlfifne de la vue , & l’effet
.dés émrftibns de la lumierefur cet organe i
En nous reftreignant aux principes géné.rau-x
de la perfpeélive-pmtique, en nous contentant
d’ex pofer les méthode s-lés plus fimple's pourl’exé-
cution des ouvrages de peintiire , nous ne
croyons cependant pas dèyoir nieW laiffer ébhàp-
per des principales loix de là nature fur lefquel-
ies la perfpectlvé eft. fondée parce qu’avec* la
connoiffance des caufes, çn peut aîfément s’ inîr.
cruire des effets, & parce que, d’un autre côté,
la pratique la plusécudiée des diverfes opérations
s’oublie aifément, & ne fe conçoit même jamais,
lorfqu’on en ignore les principes.
Comment les objets frappent notre vue &
jufqiPà quel degré cet. organe peut les jaifir*
L O I P R EM IE R E .
Les objets viennent à notre vue par tous les
points de lumière dont ils font empreints, &
chacun de ces points envoyé un rayon qui lui
communique fa forme ,.fa couleur 8c fon degré
de lumiere. Voye^- P l. I , fig . i.
L O I ï I.
Lé corps éclairé réfléch it des rayon s paral lèles
qlii deviennent convèrgens en entrant dans la
.prunelle’ 's’y réunifie ne, & forment ’un cône
(dont la bafe eft' la portion d’objet que notre oeil '
'ehibraffe, 8c dont le fommet eft à la prunelle.
jfig .iv
L O I I I I .
i Les rayons arrivés à la prunelle & fur le cryf-
tdllin , s’y croffent , & devenant divergens,
ils vont frapper la rétine , membrane qui ta pi fie1
: le fond de ï’oeil^&r fur laquelle fe forme le tableau
ped'peélif des objets qui lui communiqüent
leurs rayons.
La fi g. 1. par! laquelle nous allons démontrer-
j ceis affercions;, préfente' une, cqupe de l’oeil en;
|maffe. Toutés Les:-parties de détail deviennent
i inutiles pour les folutions que nous avons à
: donner*
A AA , eft le globe dé l’oeil*
.1.. Portion du nerf optique.
.2 2.-Exgapfion.du nerf optique qui tapiffe le
fond du globe de l’oeil, & qu’on appelle la rétine.
3. Le cryftallln..
4. La prunelle , trou qui fert de paffage aux
rayons de la lumrere , & èft fufceptible de s’ouvrir
& de fe rétrécir fuivant quelles rayons de la
lumière font vifs ou tendres.
B B B B , eft l’objet lumineux*
C, C, C , eft lef cône‘des rayons dé la lumière
donc la bafe eft fur 1 objet & le fomméc fur la
prunelle. Loi I.
D eft le cône de rayon s* qui deviennent divergens
, après avoir pafie par la prunelle. L o i IL
E eft la repréfer.tation de l’objet B, B , B , B ,
peint fur la rétine par des.rayons lumineux. Jîs>
font exprimés dans.l’oeil » à peu près comme dans
» la chambre obfcure , Sry forment des angles
, »' proportionnés à.ceux qui partent de l’objet lu-
» mineüK'. Ope, de haX-aillei ». J . .ii