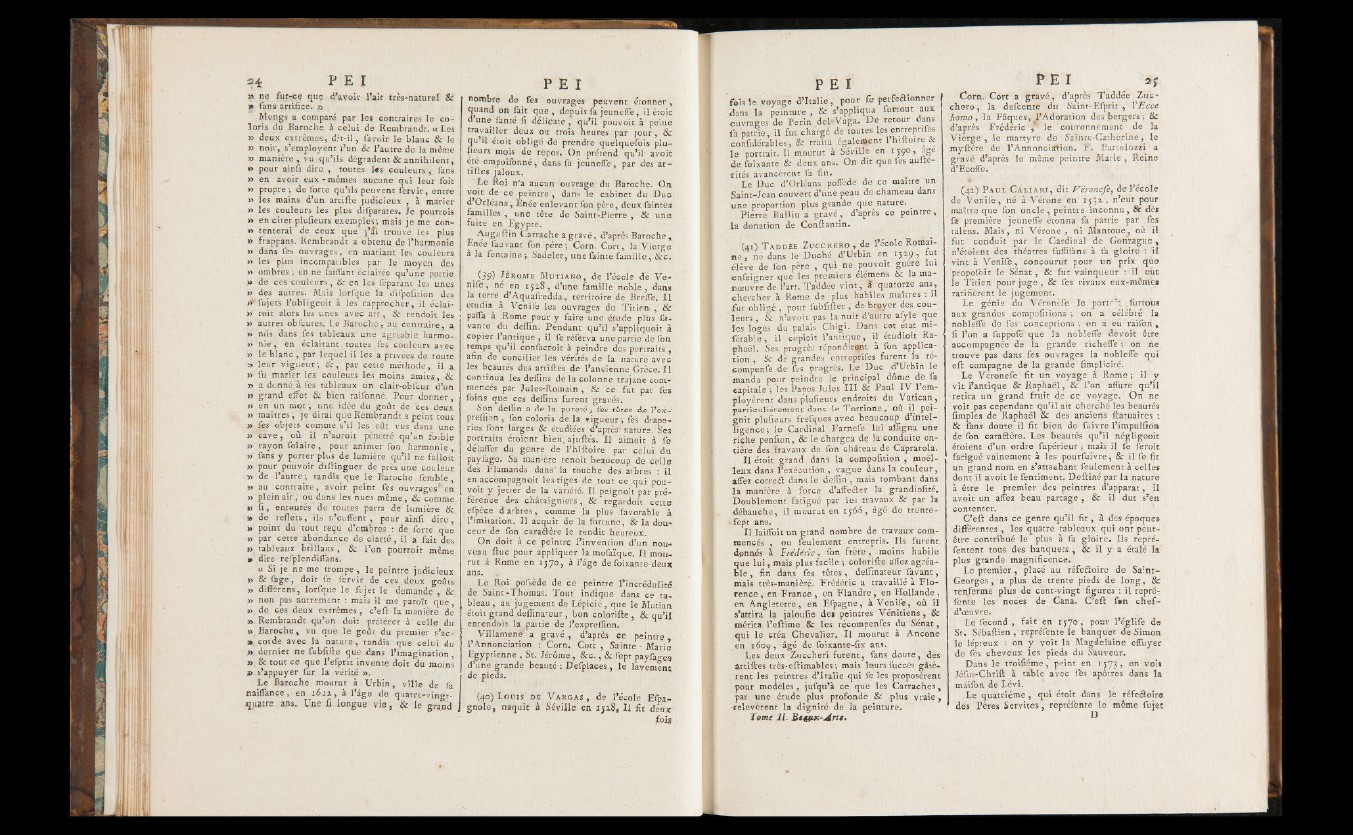
2* P E I
» ne fof-çe quç d’avoir l’air très-naturel &:
j» fans artifice. »
Mengs a comparé par les contraires le coloris
dù Baroche à celui de Rembrandt. « Les
» deux extrêmes, d.;t - il, favoir le blanc & le
» noir, s’employent l’ un & l’autre de la même
» manière, vu qu’ ils dégradent & annihilent,
» pour ainfi dire , toutes l«s couleurs , fans
» en avoir eux - mêmes aucune qui leur foit
» propre*, de forte qu’ ils peuvent fervir, entre
» les mains d’ un arcifte judicieux , à marier
» les couleurs les plus difparates. Je pourrois
» en citer plufieurs exemples*, mais je me con-
» tenterai de ceux que j’ î i trouvé les plus
» frappans. Rembrandt a obtenu de l’harmonie
» dans les ouvrages, en mariant les couleurs
» les plus incompatibles par le moyen des
» ombres *, en ne baillant éclairée qu’ une partie
» de ces couleurs, & en les féparanc les unes
» des autres. Mais lorlqùe la difpoficion des
fujets l’obligeoit à les rapprocher, il éclai-
» roit alors les unes avec a r t , & rendoit les
» autres obfçures. Le Baroche, au contraire, a
» mis dans fes tableaux une agréable harmo-
» nie , en éclairant toutes fes couleurs avec
» le blanc , par lequel il les a privées de. toute
» leur vigueur*, & , par cette méthode, il a
» lu marier les couleurs les moins amies, &
» a donné.à les tableaux un ciair-obfcur d’un
» grand effet & bien raifonné. Pour donner
» en un mot', une idée du goût de ces deux
» maîtres, je dirai que Rembrandt a peint tous
» fes objets comme s'il les eût vus dans une
» c a v e , où il n’auroit pénétré qu’ un foible
» rayon folaire , pour animer fon harmonie ,
» fans y porter plus de lumière qu’ il ne falloir
» pour pouvoir diftinguer de près une couleur
» de l’autre *, tandis que le Baroche femble,
» au contraire, avoir peint fes ouvrages*'en
» plein air , ou dans les nues même, & comme
» f i , enro.urés de tout.es parts dé lumière &
» de reflets, ils n’ euffent, pour ainfi dire
» point du tout reçu d’ombres : de forte que
» par cette abondance de clarté., il a fait des
», tableaux brillans, 8c l’on pourroit même
» dire refplendifians.
« Si je ne me trompe, le peintre judicieux
» & fage, doit fe fervir de ces deux goûts
» différens, lorfqué le fujet le demande , &
» non pas autrement : mais il me paroît q ue ,
» de ces deux extrêmes, c’eft la manière de
» Rembrandt qu’ on doit préférer à celle du
» Baroche, vu que le goût du premier s’ac-
» corde avec la nature, tandis que celui du
» dernier ne fubfifte que dans l’ imagination
» & tout ce que l ’efprit invente doit du moins
f> s’ appuyer fur la vérité ».
Le Baroche mourut à Urbin, v ille de fa
naiffance, en i 6 i z , à l’âge de quatre^-vingt-
quatre ans. Une fi longue v ie , & le grand
p E i
nombre de fes ouvrages peuvent étonner,
quand on fait q u e , depuis fa jeu neffe, il étoic
d une fante fi délicate, qu’ il pouvoit à peine
travailler deux ou trois heures par jo u r , &
qu il étoit obligé de prendre quelquefois plusieurs
mois de repos. On prétend qu’il' avoic
été empoifonné, dans fa jeuneffe, par des ar-
tiftes jaloux.
Le Roi n'a aucun ouvrage du Baroche. On
voit de ce peintre, dans le cabinet du Duc.
d Orléans, Enée enlevant fon père, deux faintes
familles , une tête de Saint-Pierre , & une
fui te en Egypte.
Auguftin Carrache a gravé, d’après Baroche,,
Enée fauvant fon père*, Corn. Cort,. la Vierge
à la fontaine y Sadeler, une fainte famille, & c .
O^) Jérome Mutiano, de l’école de V e -
n ife , ne en 1528, d’une famille noble, dans
la terre d’Aquafredda, territoire de Breffe. I l
étudia à Venîfe les ouvrages du T i t ie n , &
pafla à Rome pour y faire une étude plus fit-
-vante du defîin. Pendant qu’ il s’appliquoit à
copier l’antique , il le réfèrva une partie de fon
temps qu’ il confacroit à peindre des portraits ,
afin de concilier les v~érités de la nature avec
les beautés des artiftes de l’ancienne Grèce. I l
continua les deflins de la colonne trajane commencés
par Jules-Romain , & ce fut par fes.
foins que ces deflins furent gravés;
-Son defîin a de la pureté, fes têtes de l’ex:-'
prefïion , fon coloris de la rigueur *, fes draperies
font larges & étudiées d’après* nature. Ses
portraits étoient bien, ajuftés. I l aimoit à fe
délaffer du genre de l’hiftoire par celui du
payfage. Sa manière tenoit beaucoup de celle
des Flamands dans" la touche des arbres : il
enaccompagno.it les tiges de tout ce qui pouvoit
y jetter de la variété. Il peignoit par préférence
des châtaigniers , & ' regardoit cette
, efpèce d arbres, comme la plus favorable à
l’ imitation. Il acquit de la fortune, & la douceur
de fon caraétère le rendit heureux.
On doit à ce peintre l’ invention d’ un nouveau
ftuc pour appliquer la mofaïque. Il mourut
à Rome en 1570, à l ’âge de foixante-deux
ans.
Le Roi pofsède de ce peintre l’ incrédulité
de Saint-Thomas. Tout indique dans ce tableau,
au jugement de Lépicié , que le Mutian
étoit grand deflinateur , bon colorifte , & qu’il
entendoit la,partie de l’ ex prefïion.
Villamené a gravé , d’après ce peintre,
l’ Annonciation : Corn. Cort , Sainte - Marie
Egyptienne , St. Jérôme, & c . , & fept payfage»
d’ iine grande beauté : Defplaces, le lavement
de pieds.
(40) L o uis de Vargas , de l ’école Efpa-
gnole, naquit à Séville en ijz 8 A II fit deux
Lois
PEI
fois le voyage d’ Italie , pour Ce perfeaionner
dans la peinture , & s’appliqua lurtout aux
ouvrages de Perin del*Vaga. De retour dans
fa patrie, il fut chargé de toutes fos entrepnfes
confidérables, & traita egalement 1 hiltoire &
le portrait. Il mourut à Séville en 1590, âge
de fbixante & deux ans. On dit que les au {tentés
avancèrent fa fin. A
. Le Duc d’Orléans pofféde de ce maître un
Saint-Jean couvert d’ une peau de chameau dans
une proportion plus grande que^ nature. ^
Pierre Balliu a gravé, d’après ce peintre,
la donation de Conftantin.
(41) T addée Zucchero, de l’ école Romain
e , né dans le Duché d’ürbin en 1529, lut
élève de fon père , qui ne pouvoit guere lui
■ enfeigner que les premiers elemens 8c la manoeuvre
de l’art. Taddée v in t, 5 quatorze ans,
chercher à Rome de plus habiles maîtres . il
fut obligé , pour fubfiller , de brçyer des couleurs
, & n’ avoit pas la nuit d’autre afyle que
les loges du palais Chigi. Dans cet état mï-
férable, il copioit l’antique, il étudioit Raphaël.
Ses progrès répondirent a fon application
, 8c de grandes entrepnfes furent la ré- j
compenfe de fes progrès. Le Duc d’Urbin le
manda pour peindre le principal dôme dë fa
capitale y les Papes Jules I I I & Paul IV 1 employèrent
dans plufieurs endroits du Vatican,
particuliérement dans leT o r r io n e , où il pei- j
gnit plufieurs frefques avec beaucoup d’intelligence*,
le Cardinal Farnefe lui affigna une
riçhe penfion, & le chargea de la conduite entière
des travaux de fon château de Câprarola.
Il étoit grand dans la compolitioù , moël-
leux dans l’exécution , vague dans la couleur,
affez correél dans le deflin , mais tombant dans
la manière à force d’affeâer la grandiofité.
Doublement fatigué par les travaux & par la
débauche, il mourut en 1566, âgé de trente-
fept ans.
Il laiffoitun grand nombre de travaux commencés
, ou feulement entrepris. Ils furent
dpnnés à Frédéric, fon frère, moins habile
que iu i , mais plus facile *, colorifte affez agréable
, fin dans fes têtes, deflinateur favant,
mais très-manièrç. Frédéric a travaillé a F lo rence
, en France , en Flandre, en Hollande,
en Angleterre, en Efpagne, à V enife , où il
s’attira la jaloufie des peintres Vénitiens, &
mérita l’eftime & les récompenfes du Sénat,
qui le créa Chevalier. Il mourut à Ancône
en 1609, âgé de foixante-fix ans.
Les deux Zuccheri furent, fans doute, des
artiftes très-eftimables *, mais leurs fuccès gâtèrent
les peintres d’ Italie qui le les proposèrent
pour modèles, jufqu’ à ce que les Carraches,
par une étude plus profonde & plus v ra ie ,
■ relevèrent la dignité de la peinture.
Tome IL B€4fuc-Jlrtt»
PEI
Corn. Cort a gravé., d’après Taddée Zucchero
, la defeente du Saint-Efprit , YEcce
homo y la Pâques, ^’Adoration des bergers ; 8c
d’après Frédéric , le couronnement de la
Vierge , le martyre de Sainte-Catherine, le
myftère de l’Annonciation. F . Bartolozzi a
gravé d’après le même peintre Marie , Reine
d’Ecoffe.
(42) P aul C a l ia r i , dit Véronefe, de l’école
de V en ife , né à Vérone en 1532.) n’eut pour
maître que fon on c le , peintre inconnu, & dès
fa première jeuneffe étonna fa patrie par fes
talèns. Mais, ni Vérone , ni Mantoue, où il
fut conduit par le Cardinal de Gonzague,
m m des théâtres fuffifans à fa gloire : il
vint à Ven ife , concourut pour un prix que
propofoit le Sénat, & fut vainqueur : il eut
le Titien pour juge , & fe3 rivaux eux-mêmes
ratifièrent le jugement.
Le génie' du Véronèfe le porte:t_ .furtoixs
aux grandes compofitions *, on a célébré la
nobleffe de fes conceptions *, on a eu raifôn ,
fi l’on a fuppofé que la nobleffe devoit être
accompagnée de la grande richeffe *, on ne
trouve pas dans fes ouvrages la nobleffe qui
eft compagne de la grande {implicite.
Le Véronefe fit un voyage à Rome *, il y
vit l’antique & Raphaël, & l’on affure qu’ il
retira un grand fruit de ce voyage. On ne
voit pas cependant qu’ il ait cherché les beautés
{impies de Raphaël & des anciens ftatuaires :
& fans doute il fit bien de fuivre l’impulfiot»
de fon caraâère. Les beautés qu’ il négligeoit
étoient d’ un ordre fupérieur -, mais il fe feroit
fatigué vainement à les pourfuivre, & il fe fit
un grand nom en s’attachant feulement a celles
dont il avoit le fentiment. Deftiné par la nature
à être le premier des peintres d’apparat, il
avoit un affez beau partage, & i l dut s’en
contenter.
G’ eft dans ce genre qu’ il f i t , à des époques
différentes , les quatre tableaux qui ont peut-
être contribué le plus à fa gloire. Ils repré-
fentent tous des banquets , & il y a étalé la
plus grande magnificence.
Le premier, placé au réfe&oire de Satnt-
Georges, a plus de trente pieds de lo n g , &
renferme plus de cent^vingt figures : il repréfente
les noces de Cana. C ’eft fon ch e f-
d’oeuvre.
Le fécond , fait en 1570, pour l’églife de
St. Sébaftien , ' repréfente le banquet de Simon
le lépreux : on y voit la Magdelaine effuyer
de fés cheveux les pieds du Sauveur.
Dans le troifiéme, peint en 1573 , on voit
Jéfus-Chrift à table avec tes apôtres dans la
màifon de Lé'vi.
Le quatrième , qui étoit dans le réfeâoirej
des Pères Servîtes, repréfente le même fujet