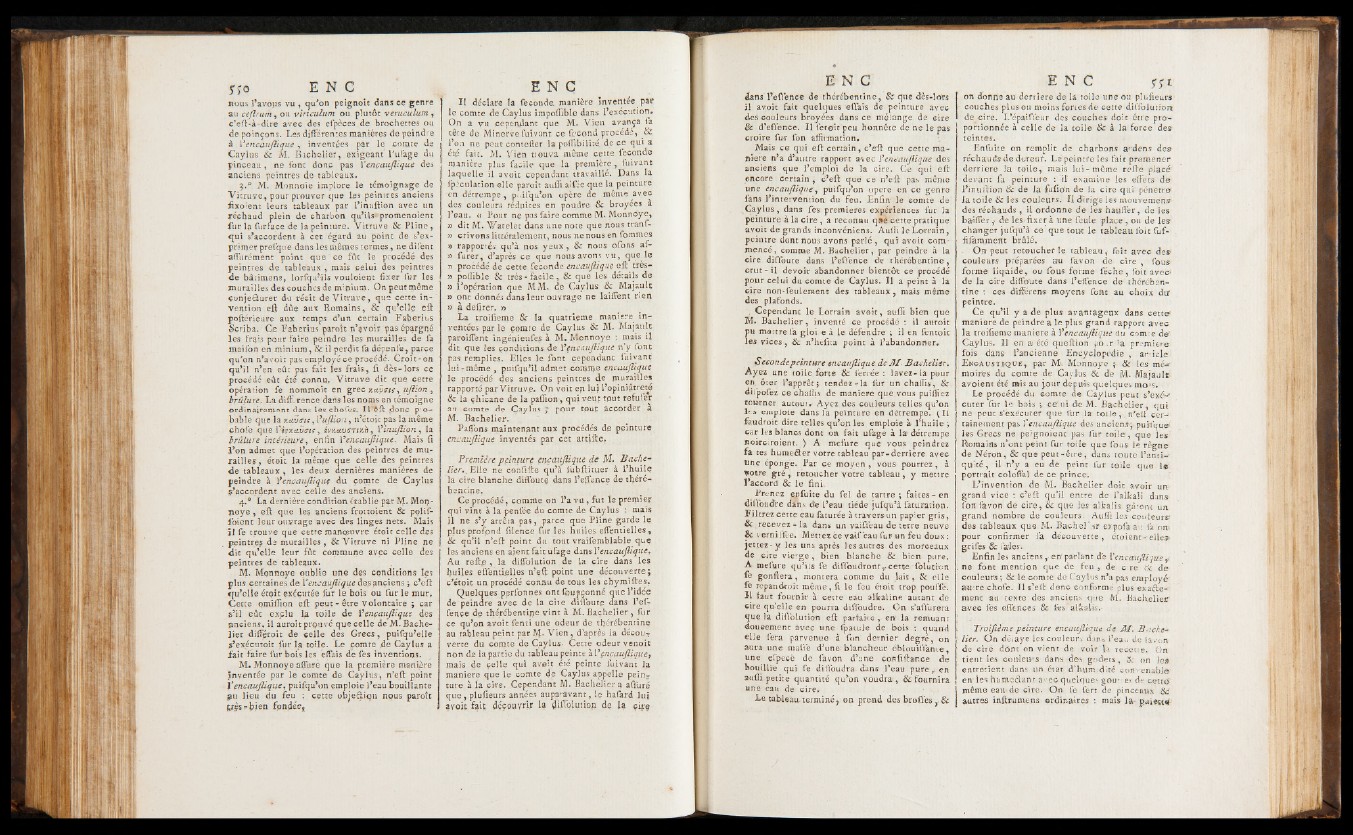
nous l’avous v u , qu’on peignoit dans ce genre
au ceflrum, ou viriculum ou plutôt veruculum ,
c ’eft-à-dire avec des efpèces de brochettes ou
de poinçons. Les différentes manières de peindre
à Y encaujlique , inventées par le comte de
Caylus 8c Al. Bachelier, exigeant Tufage du
pinceau , ne font donc pas Y encaujlique des
anciens peintres de tableaux.
3.0 M. Monnoie implore le témoignage de
Vicruye., pour prouver que les peintres anciens
fixoient leurs tableaux par l’ inuftion avec un
réchaud plein de charbon qu’ ils»promenoient
fur la furface de la peinture. Vitruve & Pline ,
qui s’accordent à cet égard au point de s’exprimer
prefque dans lesm,êmes termes, ne difent
aflu rément point que "ce fût le procédé des
peintres de tableaux , mais celui des peintres
de bâtimens, lorfqu’ils vouloieot fixer fur les
murailles des couches de minium. On peut même
çonje&urer du récit de Vitruve, que cette invention
eft dûe aux Romains, 8c qu?elle eft
poftérieure aux temps d’ un certain Faberhis
Scrjba. C.e Faberius paroît n’ avoir pas épargné
les frais pour faire peindre les murailles de fa
maifon en minium, 8c il perdit fa dépenle, parce
qu'on n’a voit pas employé ce procédé. Croit-on
qu’ il n’en eût pas fait les frais, fi dès-lors ce
procédé eût été connu, Vitruve dit que cette
opération fe nommoit en grec ujlion ,
brûlure. La différence dans les noms en témoigne
ordinairement dans les chofes. Il^êff donc p.o-r
bable que la x&vffit, Ÿujlion, n’étoit pas la même
chofe que VivKcWffiç , evKu.veTix.ri, Yinujlion, la
brûlure intérieure, enfin Y encaujlique. Mais fi
l ’on admet que l’opération des peintres de mura
ille s , étoit la même que celle des peintres
de tableaux , les deux dernières manières de
peindre à Ÿ encaujlique du çomte de Caylus
^’accordent avec celle des anciens.
4.0 La dernière condition établie par Af. Moij-
p o y e , eft que les anciens frottoient & polif-
foient leur ouvrage ^vec des linges nets. Alais
j l fe trouve que cette manoeuvre étoit celle des
peintre? de murailles, & Vitruve ni Pline ne
dit qu’elle leur fût commune avpc celle des
peintres de tableaux.
M, Monnoye oublie une des conditions l$s
plus certaines de Y encaujlique de? anciens ; c’eft
qu?elle étoit exécutée fur le bois ou fur le mur.
Cette omifiion eft peut-être volontaire ; car
s’ il eût explu la toile de l’énçaujlique des
anciens, il auroit prçuvé que celle de M. Bachelier
différoit de celle des Grecs, puifqu?elle
j ’ executoit fur la toile. Le comte d.e Caylus a
fait faire fur bois les effais de fes inventions.
M. Monnoye affure que la première manière
inventée par le comte de Caylus, n’eft point
l ’encaujlique, puifqu’on emploie l’eau bouillante
gu lieu du feu : cette obieéHqn nous paroît
très-bien fondé.e8
Il déclare la fécondé manière inventée pat?
le comte de Caylus impofiible dans l’exécution.
On a vu cependant que M. Vien avança fa
tête de Minerve fuivant ce fécond procédé, &
l’on ne peut çontefter la poffibilité. de ce qui a
été fait. Al. Vien trouva même cette fécondé
manière plus facile que la première , fuivant
laquelle il avoic cependant travaillé. Dans la
fpfculation elle paroît aufii aifie que la peinture
en détrempe, puifqu’on opère de même avec
des couleurs réduites en poudre 8c broyées a
l ’eau. « Pour ne pas faire comme M. Monnoye,
» dit M. Watelét dans une note que nous tranf-
» cri vous littéralement, nous ne nous en fommes
» rapportés, qu’à nos y e u x , & nous ofons af-
» furer, d’après ce que nous avons vu , que le
» procédé de cette fécondéencaujlique eft très-
» poflible 8c trè s -fac ile , & que les détails de
» l ’opération que A1M. de Caylus 8c Majault
» ont donnés dans leur ouvrage ne laiffent rien
» à deftrer. »
La troifieirçe & la quatrième maniéré inventées
par le çomte de Caylus & M. Majault
paroiffent ingénieufe? à M. Monnoye : mais il
dit que les conditions de l’çncaujlique n’y font
pas remplies. Elles le font cependant fuivant
lui rmême , puifqu’ il admet comme encaujlique
le procédé des anciens peintres 4e murailles
rapporté par Vitruve. On voit en lui l’opiniâtreté
& la çhicane de la pafiion, qui veqf tout refufer
au comte de Çaylus f pour tpuç accorder a
M. Bachelier. ,•
Paffons maintenant aux procédés de peinture
encaujlique inventés par cet artifte,.
Première peinture çncaujlique de M. Bâche-
lier.. Elle ne confifte qu’à fubftituer à l’ huilp
la cire blanche diffoutç dans l’effence de thérébentine.
Ce procédé, comme on l’ a v u , fut le preipie?
qui vint à la penfée du comte de Caylus : mai?
il ne s’y arrêta pas, parce que Pline garde le
plus profpnd filence fur les huiles effentielles ,
& qu’il n’eft point du tout vrailemblable que
les anciens en aient fait ufage dans Y encaujlique.
Au refte , la diffolution de la cire dans les
huiles effentielles n’eft point une découverte 5
c’étçit un procédé connu de toqs les chymiftes.
Quelques pprfonnes ont foupçonné que l’ idée
de peindre avec de la ciie dil’foute dans l’ efr
fençe d,e thérébentine vint à M. Baçhelier , fur
ce qu’on avoit fenti une odeur de thérébentine
au tableau peint par AL V ien , d’aprçs la décou*
verte du comte de Caylus- Cette odeur venoit
non de la partie du tableau peinte à Y çncaujlique,
mais de celle qui ave.it été peinte fuivant la
maniéré que le comte d,e Caylus appelle pein*
ture à la cire. Cependant M. Bachelier a afl’uré
que, plufieurs années auparavant, le hafard lift
avoit fait 4<?çpijYtft & de J? çir^
dans Fefïence de thérébentine, & que dès-lofs
il avoit fait quelques effais de peinture avec
des couleurs broyées dans ce mélange, de cire
& d'effence. Il feroit peu honnêce de ne le pas
croire fur fon affirmation.
Mais ce qui eft certain, c’ eft que cette maniéré
n’a d’autre rapport avec Y encaujlique des
anciens que l’ emploi de la cire. Ce qui eft
encore certain , c’eft que ce n’eft pas même
une encaujlique, puifqu’on opéré en ce genre
fans l’ intervention du feu. Enfin- le comte de'
Caylus, dans fes premières expériences fur la
peinture à la cire , a reconnu qflté cette pratique
avoit de grands inconvéniens. Aufii Je Lorrain,
peintre dont nous avons parlé , qui avoit commencé,
comme M. Bachelier, par peindre à la
cire diffoute dans l’ effence d-e thérébentine,
crut - il devoir abandonner bientôt ce procédé
pour celui du comte de Caylus. Il a peint à la
cire non-feulement des tableaux, mais même
des plafonds.
, Cependant le Lorrain avoit, aufïi bien que
M. Bachel ie r , inventé ce procédé : il auroit
pu mettre fa gloi e à le défendre ; il en fèntoit
les v ice s , 8c n’héfita point à l’abandon frer,
S eeondepeinture encaujlique de M- Bachelier.
Ayez une toile.forte 8c ferrée : lavez-la pour
en ôter l’apprêt;, tendez-la fur un chaffis, &
dilpofez ce chafiis de maniéré que vous puifïiez
tourner autouir Ayez des couleurs telles qu’on
les emploie dans la peinture en détrempe. ( I l
faudroit dire telles qu’oji les. emploie à- l’huile ;
car les blancs dont on fait u&ge à la? détrempe
uoirciroient. ) A melure que vous peindrez
fa tes humeâer votre tableau par-derriere avec
une éponge. Par ce moyen , vous pourrez, à
votre g r é , retoucher votre tableau, y mettre
l ’accord 8c le fini.
Prenez enfuite du fel de tartre; faite s-en
diffoudre dans de l’eau tiède jufqu’à faturation.
Filtrez cette eau farurée à travers un papier gris,
& recevez - la dans un vaiffeau de terre neuve
& verniflèe. Mettez ce vaif.’eau fur un feu doux :
je tie z -y les uns après les autres des morceaux
de cire v ie rge , bien blanche 8c bien pure.
A mefure qu’ ils fe diffoudronr,.cette Solution
fe gonflera, montera comme du la it , 8c elle
fe repandroit même, fi le feu étoit trop pouffé.
I l faut fournir à cette eau alkaline autant de
cire qu’elle en pourra diffoudre. On s’alTurera
que la diflolution eft parfaite , en- la remuant
doucement avec une fpatule de bois : quand
elle fera parvenue à fon dernier degré, on
aura une malie d’une blancheur éblouiffame,
une efpecè de favon d’ une confiftar.ce de
bouillie qui fe dilVoudra dans l’ eau pure ^ en
aufii petite quantité qu’on voudra , & fournira
une eau de cire.-
Le tableau-terminé, on prend des broÛ’es ,• 8c
on donne au derrière de la toile une du pÎLfieurs
couches plus ou moins Fortes de cette ditTolutiora
de cire. L’épaifi’eur des couches doit être proportionnée
à celle de la toile & à la force des
teintes.
Enfuite on remplit de charbons a rdens des
réchauds de doreur. Le'peintre les fait promener
derrière la toile, mais lui - même refte placé'
devant fa peinture : if examine les effets de
l ’ in uftion 8c de ia fufio-n de la cire qui pénetrO
la toile & les couleurs. I l dirige les mouvemens
des réchauds , il ordonne de les hauffer, de les
baiffer,- de les-fixera une feule place, ou de les
changer jufqü’à ce que tout le tafbleau foit fuf-
fifamment brûlé.
On peut retoucher le tableau,- foft avec des
couleurs préparées au favon de cire , fous
forme liqûide, ou fous forme féche, foit avec-
de la cire diflb'ute dans l ’eflence de thérébentine
: ces différen-s moyens font au choix dit
peintre.
Ce qu’ il y a de plus avantageux dans cette“
maniéré de peindre a le plus grand rapport avec
la troifieme maniéré à Y encaujlique du comie de’
Caylus. Il en a été queftion po.r la premiers
fois dans l’ancienne Encyclopédie , a r ic le '
Enc-austeque, par M. Monnoye ÿ & les mé-*-
moires du comte de Caylus & de M. Majaule
avoient été mis au jour depuis quelques mo's.
Le procédé du comte de Caylus peut s’exé-'
cuter fur le bois -, ce'.ni de M. Bachelier, qui
ne peut s’exécuter que fur la1 to ile , n’eft cer-^
tainement pas Y encaujlique des anciens; puifque;
les Grecs ne pe/gnoient pas fur toile-, que les
Romains n’ont peint fur toile que fous le règne
de Néron, 8c que peut-être, dans route l’antiquité,
il n’ y a eu de peint lur toile que le
portrait coloflàl de ce prince.
L’ invention de M. Bachelier doit avoir uiï
grand vice : c’eft qu’il entre de l’alkaîi dans
foit favon de cire, & que les alfcalis gâtent un
grand nombre de couleurs. Aufii les couleurs“
des tableaux que M. Bachel’ ir expofa au fa ion?
pour confirmer fa découverte, étaient-elles*
grifes & Pales.
Enfin les anciens ,e n : parlant de Y encaujlique ?
ne font mention que de feu , de c re 8c. de-
couleurs ; & le comte de Caylus n’ a pas employé“
attire chofe. Il s’eft donc conformé plus exactement
au texte des anciens que M. Bachelier
avec fès effences & fes'alkalis..
Troijième peinture encaujlique de Jff . Bachelier.
On déiaye les couleurs dans l’eau de lavon
de ciré dont on vient de voir la recette. On
tient les couleurs dans des godets, & on le»
entretient dans un état d’humidité convenable
en1 les humectant avec quelques goug es de cetto
même eau de cire. On fe fert de pinceaux
autres inftrumens ordinaires : mais la- paiect#