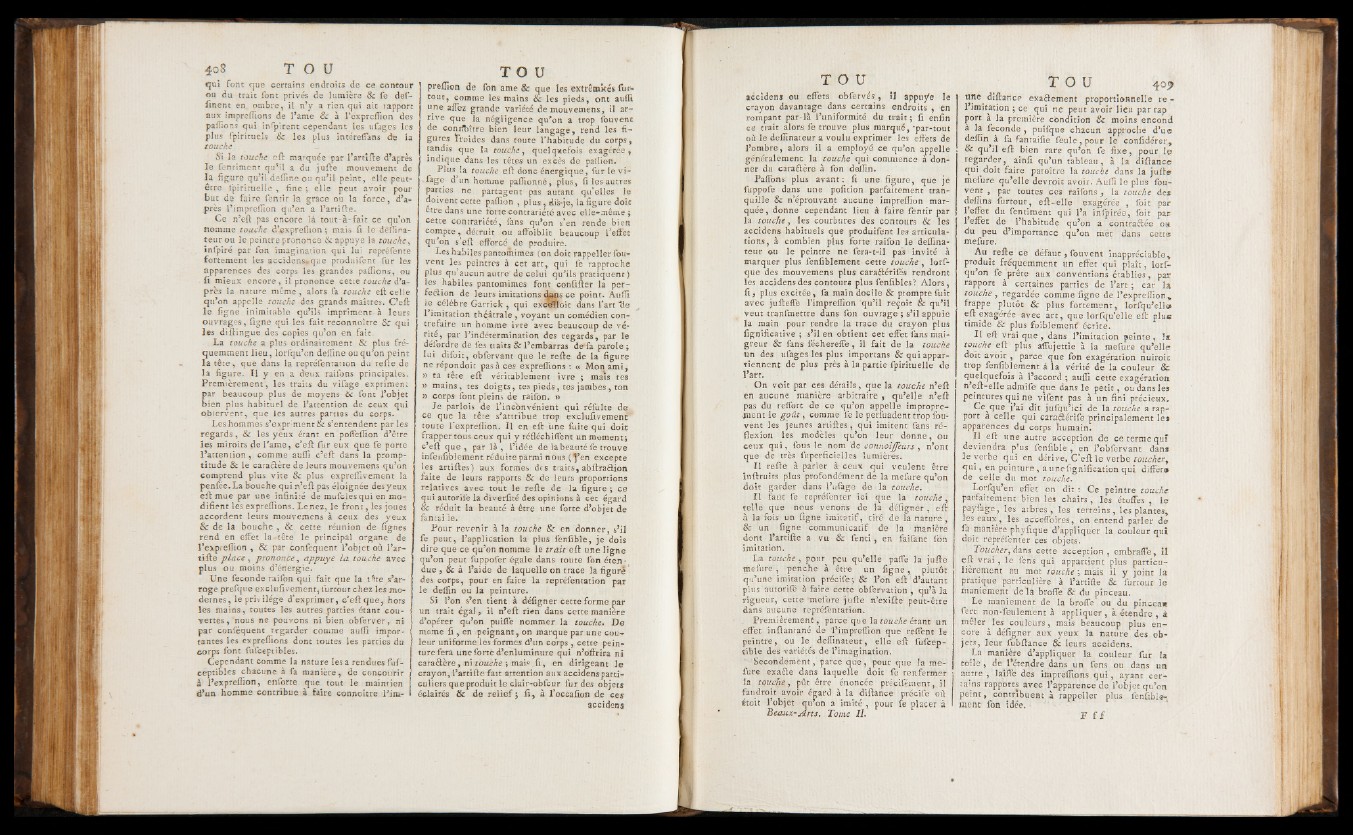
4 ° 8 T O U
qui font que certains endroits de ce contour
ou du trait font privés de lumière & fe def-
finent en. ombre, il n’y a rien qui ait rapport
aux impreffions de l ’ame & à l’expreflion des
pallions qui infpirent cependant les ufages les
plus lpirituels & les plus intéreffans de la
touche,
Si la to u ch e eft marquée "par l’artifte d’après
le fentiment qu’ il a du jufte mouvement de
la figure qu’ il deffine ou qu’il peint, elle peut-
être lpirituelle , fine ; elle peut avoir pour
but de faire fentir la grâce ou la force , d’après
l’ impreflion qu’ en a l’arti (le.
Ce n’eft pas encore là tout-à-fait ce qu’on
nomme to u ch e d’ expreïlion ; mais fi le dèfïina-
teur ou le peintre prononce & appuyé la t o u c h e,
infpiré par fon imagination qui lui repréfente
fortement les accidens« que produifent fur les
apparences des corps les grandes paillons, ou
fi mieux encore, il prononce cette to u ch e d’après
la nature même, alors fa tou ch e eft celle
qu’on appelle tou ch e des grands maîtres. C’eft
le figne inimitable qu’ils impriment à leurs
ouvrages, ligné qui les fait reconnoître & qui
les diftingue des copies qu’on en fait.
La to u ch e a plus ordinairement & plus fréquemment
lieu, lorfqu’on deiline ou qu'on peint
la tête , que dans la repréfentarion du relie de
la figure. I l y en a deux raifons principales.
Premièrement, les traits du vifage expriment
par beaucoup plus de moyens 6c font l’objet
bien plus habitue] de l’attention de ceux qui
oblervent, que les autres parties du corps.
Les hommes s’expr:ment& s’entendent par les
regards, & les yeux étant en pofleflion d’être
les miroirs de l ’ame, c'eft fur eux que fe porte
l ’attention , comme aulïi c’eft dans la promptitude
& le caractère de leurs mouvemens qu’on
comprend plus vite & plus exprelïivement la
penfée.La bouche qui n’eft pas éloignée des yeux
eft mue par une infinité de mufclesqui en modifient
les exprelïions. Leviez, le front, les joues
accordent leurs mouvemens à ceux des yeux
& de la bouche , & cette réunion de lignes
rend en effet la - tête le principal organe de
l ’expreflion , & par conféquent l’objet où l ’ar-
tifte place , prononce, appuyé la touche avec
plus ou moins d’éflergie.
Une fécondé raifon qui fait que la t$te s’arroge
prefque exclufivement, iurtout chez les modernes,
le privilège d’ exprimer, e’ e ftq u e , hors
les mains, toutes lès autres parties étant couvertes
, nous ne pouvons ni bien obferver, ni
par conféquent regarder comme aulïi importantes
les exprelïions dont toutes les parties du
corps font fufceptibles.
Cependant comme la nature lésa rendues fàl-
ceptibles chacune à fa manière, de concourir
à l’expreflion, enforte que tout le maintien
d’un homme contribue à faire connoître l ’im-
TOU
preflion de fon ame & que les extrémités fur-
tout, comme les mains & les pieds, ont aufli
une allez grande variété de mouvemens, il arrive
que la négligence qu’on a trop Couvent
ne conrfbître bien leur langage, rend les figures
froides dans toute l'habitude du corps,
tandis que la touche, quelquefois exagérée,
indique dans les têtes un excès de pallion.
Plus,là| touche eft donc énergique, fur le v ifage
d un homme paflionné, plus, fi les autres
parties ne partagent pas autant qu’elles le
doivent cette pafïion , plus , dis-je, la figure doit
etre dans une Forte contrariété avec elle-même ;
cette contrariété, fans qu’on s’en rende bien
compte, détruit ou affoiblit beaucoup l ’effet
qu’on s’eft efforcé de produire.
Les habiles pantomimes (on doit rappeller fou-
vent les peintres à cet art, qui fe rapproche
plus qu’aucun autre de celui qu’ils pratiquent)
les habiles pantomimes font confifter la per-
fe&ion de leurs imitations dans ce point. Aufli
le célèbre Garrick , qui excfelïoit dans l’art Ile
l ’imitation théâtrale , voyant un comédien contrefaire
un homme ivre avec beaucoup de vérité,
par l ’ indétermination des regards, par le
délordre de Ces ti aits & l’embarras de*fa parole ;
lui difoit, obfervant que le refte de la figure
ne répondoit pas à ces expreflions : « Mon ami$
» ta tête eft véritablement ivre ; mais tes
» mains, tes doigts, tes pieds, tes jambes, ton
» corps font pleins de raifon. »
Je parfois de l’ inconvénient qui réfulte de
ce que la tête s’ attribue trop exclufivement ‘
toute l expreflion. Il en eft une fuite qui doit
frapper tous ceux qui y réfléchiffent un moment;
c’ eft q u e , par là , l’ idée de la beauté fe trouve
infeiîfiblement réduite parmi nous ( )’en excepte
les artiftes) aux formes des traits, abftra&ion
faite de leurs rapports & de leurs proportions
relatives avec tout le refte de la figure ; ce
qui autorité la diverfité des opinions à cet égard
& réduit la beauté à être une forte d’objet de
fantai je.
Pour revenir à la touche & en donner, s’il
fe peut, l’application la plus fenfible, je dois
dire que ce qu’on nomme le trait eft une ligne
qu’on peut fuppofer égale dans toute fon étendue
, oc à l’aide de laquelle on trace la figuré
des corps, pour en faire la repréfentation par
le delfin ou la peinture.
Si l’on s’ en tient à défigner cette forme par
un trait é g a l, il n’ eft rien dans cette maniéré
d’opérer qu’on puiflé nommer la touche. De
meme fi , en peignant, on marque par une cou»
leur uniforme les formes d’ un corps , cette peinture
fera une forte d’enluminure qui n’offrira ni
cara&ère, ni touche ; mai*. f i , en dirigeant le
crayon, l’artifte fait attention aux accidensparticuliers
que produit le clair-obfcur fur des objets
éclairés & de relief ; f i, à l ’occafion de ces
accidens
accidens ou effets obfervés, il appu/e le
crayon davantage dans certains endroits , en
rompant par-là l’uniformité du trait; fi enfin
cè trait alors fe trouve plus marqué, ‘par-tout
où le deflinateur a voulu exprimer les effets de
l’ombre, alors il a employé ce qu’on appelle
généralement la touche qui commence à donner
du cara&ère à fon dejflin.
Paffons plus avant: fi une figure, que je
fuppofe dans une pofitîon parfaitement tranquille
& n’éprouvant aucune impreflion marquée,
donne cependant lieu à faire fentir par
la touche, les courbures des contours & les
accidens habituels que produifent les articulations,
à combien plus forte raifon le deflinateur
ou le peintre ne fera-t-il pas invité à
marquer plus fenfiblement cette touche, forf-
que des mouvemens plus cara&érifés rendront
les accidens des contours plus fenfibles? Alors,
f i , plus excitée, fa main docile & prompte fuit
avec jufteffe l’impreflion qu’il reçoit & qu’ il
veut-tranfmettre dans fon ouvrage ; s’ il appuie
la main pour rendre la trace du crayon plus
fignificative ; s’ il en obtient cet effet fans maigreur
& fans féchereflé, il fait de la touche
un des ufages les plus importans & qui appartiennent
de plus près à la partie fpirituelle de
l ’art.
On voit par ces détails, que la touche n’eft
en aucune manière arbitraire, qu’elle n’eft
pas du reflort de ce qu’on appelle improprement
le g o û t, comme fe le perfuadent trop fou-
vent les jeunes artiftes, qui imitent fans réflexion
les modèles qu’on leur donne, ou
ceux q u i, fous le nom de conuoijfeurs, n’ont
que dé très fuperficielles lumières.
I l refte à parler à- ceux qui veulent être'
inftruits plus profondément de la mefure qu’on
doit garder dans l’ ufage de la touche.
I l faut fe repréfenter ici que la touche,
telle que nous venons de la défigner, eft
à la fois un figne imitatif, tiré de la nature ,
& un figne communicatif de la manière
dont l’ artifte a vu & fen ti, en faifant fon
imitation.
La touche , pour peu qu’elle paffe la jiifte
mefure, penche à être un fign e , plutôt
qu’une imitation précifey & l’on eft d’autant
plus autorifé à faire cette obfervation , qu’à la
rigueur, cette mefure jufte n’exifte peut-être
dans aucune repréfentation.
. Premièrement, parce que la touche étant un
effet inftanrané de 'l’impreflion que reffent le
peintre, ou le deflinateur, elle eft fufeep-
tible des variétés de l’ imagination.
Secondement, parce que, pour que la mefure
exa&e dans laquelle doit fe renfermer
la touche , pût être énoncée précifément, il
faudrait avoir égard à la diftance précifè où
étoit l’objet qu’on a imité , pour le placer à
Beaux-dns. Tome IL
djftancp exa&ement proportionnelle r e -
1 imitation ; ce qui ne peut avoir lieu par rap
port a la première condition & moins encond
à la fécondé, puifque chacun approche d’ue
deflïn a fa fantaifie feule, pour le confidérer,
& qu’ il eft bien rare qu’on fe fix e , pour le»
regarder, ainfi qu’un tableau, à la diftance
qui doit faire paroître la touche dans la jufte
mefure qu’elle devroit avoir. Aufli le plus fou-
vent , par toutes ces raifons, la touche des
deflins iurtout, eft-e lle exagérée , foit par
l’effet du fentiment qui l’a infpirée, foit par
1 effet de l ’habitude qu’on a contra&ée o»
du peu d’importance qu’on met dans cette
mefure.
Au refte cè défaut , fou vent inappréciable,
produit fréquemment un effet qui plaît, lorfqu’on
fe prête aux conventions établies, par
rapport à certaines parties de l’art ; car la
touche , regardée comme figne de l’expreflion,,
frappe plutôt & plus fortement, Iorfqu’elfo
eft exagérée-avec ar t, que lorfqu’elle eft plue
timide & plus foiblement* écrite.
I l eft vrai que , dans l’ imitation peinte , !*
touche eft plus aflujettie à la mefure qu’elle
doit avoir , parce que fon éxagération nuiroic
trop fenfiblement à la vérité de la couleur &
quelquefois à l’accord ; aufli cette exagération
n eft-elle admife que dans le p e tit, ou dans les
peintures qui ne vifent pas à un fini précieux,
Ce^que j’ai dit jufqu’ ici de la touche a rapport
a celle qui caraâérife "principalement les
apparences du corps humain.
I l eft une autre acception de ce terme qui
deviendra p’ us fenfible , en l’obfervant dans
le verbe qui en dérive, C 'e ftle verbe toucher,
q u i, en peinture , a une lignification qui diffère
de celle du mot touche.
Lorfqu’en effet on dit : Ce peintre touche
parfaitement bien les chairs, les étoffes , le
payfage , les arbres , les terreins , les plantes,
les eaux, les accefloires, on entend parler de
fa manière phyfique d’appliquer la couleur qui
doit repréfenter ces objets.
Toucher, dans cette acception , embraffe, i l
I v r a i, le fens qui appartient plus particulièrement
au mot touche ; mais il y joint la
. pratique particulière à l’artifte & furtout le
maniement d e là broffe & du pinceau.
Le maniement de la broffe ou du pincea*
fert non-feulement à appliquer , à étendre , à
mêler les couleurs, mais beaucoup plus en-
; core à défigner aux yeux la nature des objets,
leur fubftançe & leurs accidens.
La manière d’appliquer la couleur fur la
, to ile , de l ’ëteiîdre dans un fens ou dans un
autre , laiffe dès imprèfiions q u i , ayant certains
rapports avec l ’apparence de l’objet qu’on
peint, contribuent à rappeller plus lenfibie-.
ment fon idée.
F f f