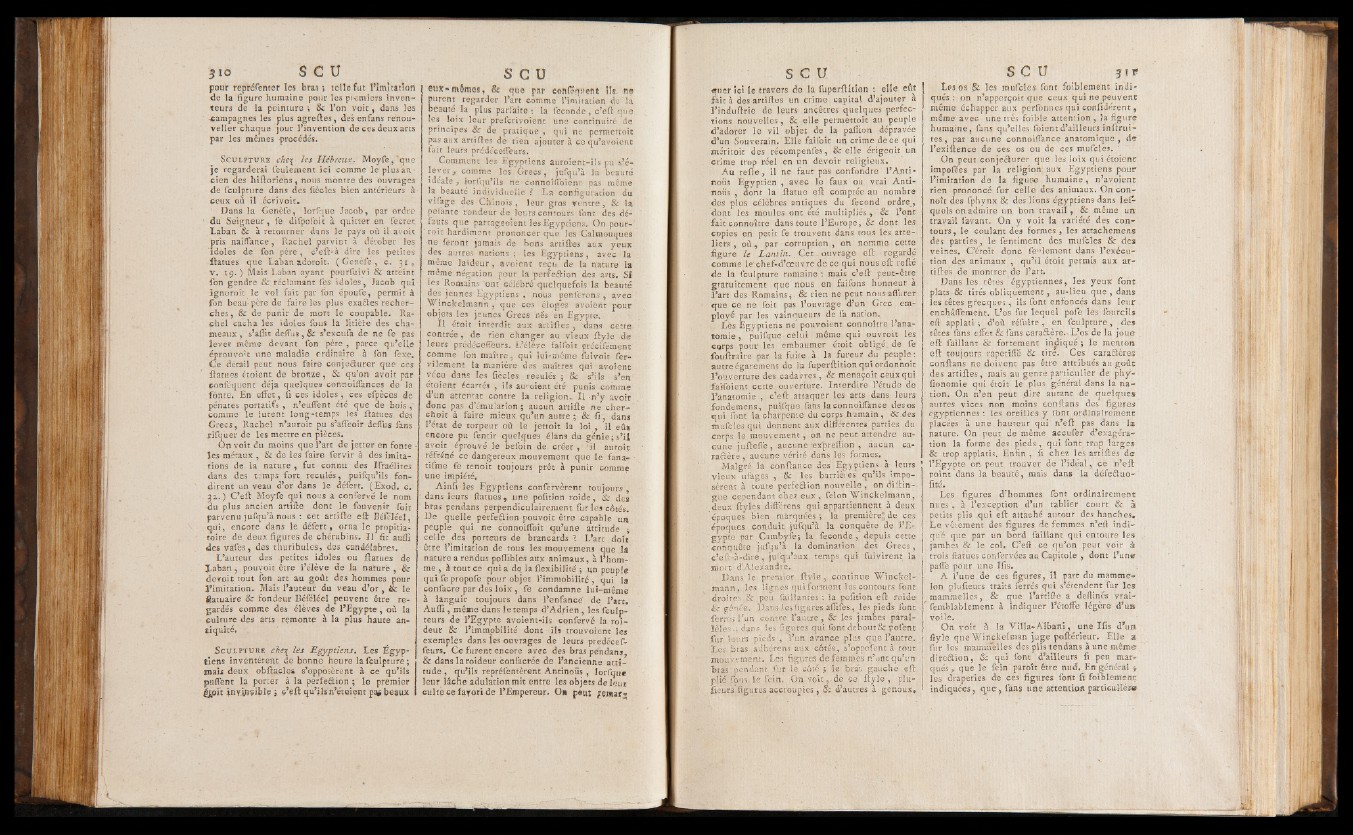
3 i o S C Ü
pour repréfenter les bras •, telle fut l’ imitation
de la figure humaine pour les premiers inventeurs
de la peinture ; & l’on voie , dans les
-campagnes les plus agrelies, des enfans rènou-
veller chaque jour l’ invention de ces deux arts
par les mêmes procédés.
Sculpture che\ les Hébreux. Moyfe,'que
je regarderai feulement ici comme le plus ancien
des hifloriens, nous montre des ouvrages
de fculpture dans des fiècles bien antérieurs à
ceux où il -écrivoit.
Dans la Genèfe, lorfque Jacob, par ordre
du Seigneur, fe difpofoit à quitter en fecret
Laban & à retourner dans le pays où il.avoit
pris naiflance, Rachel parvint à dérober les
idoles de fon père, c’efl-à dire les petites
flatues que Laban adoroit. ( Genèfe , c. 3 1 ,
v . 19. ) Mais Laban ayant pourfuivi & atteint
fon gendre & réclamant les idoles, Jacob qui
ignoroit le vol fait par fon époufe, permit à
fon beau-père de faire les plus exactes recherches,
& de punir de mort le coupable. Rachel
cacha les idoles fous la litière des chameaux
, s’aflit deflus, & s’ exeufa de ne fe pas
lever même devant fon père , parce qu’ elfe
éprouvo't une maladie ordinaire à fon fexe.
Ce détail peut nous faire conjecturer que ces
flatues etoient de bronze, & qu’on avoït par
çonféquent déjà quelques connoiffances de la
fonte. En effet, fi ces idoles , ces efpèc'es de
pénates portatifs , n’euflent été que de bois
comme le furent long-temps les fia tues ; des
Grecs, Rachel n’ auroic pu s’affeoir deflus fans
rifquer de les mettre en pièces.
On voit du moins que l’art de jetter en fonte -
les métaux , & de les faire fervir à des imitations
de la nature ,. fut connu des Ifraélites
dans des temps fort reculés, puisqu’ils fondirent
un veau d’or dans le défert. (Exod. c.
22.. ) C’eft Moyfe qui nous a confervé le nom
du plus ancien artifle dont le fouvenir foit
parvenu jufqu’à nous : cet artifle e fl Béféléel,
qui, encore dans le défert, orna le propitiatoire
de deux figures de chérubins. I l fit aufîi
des vafes, des thuribules, des candélabres.
L’auteur des petites idoles ou flatues de
Laban, pouyoit être l’élève de la nature, &
devoit tout fon art au goût des hommes pour
l ’imitation. Mais l’auteur du veau d’or , & le
ftatuaire & fondeur Béféléel peuvent être regardés
comme des élèves de l ’E gyp te, où la
culture des arts remonte à la plus haute antiquité.
' _
S c u l p tu r e che-[ les Egyptiens. Les Égyptiens
in ventèrent de bonne heure la fculpture ;
mais deux obflaclea s’opposèrent à ce qu’ ils
puflent la porter à la perfeétion ; le premier
gjpit invincible ; ç’eft qu’ ilsn’étqient p o te a u x
S C O
e u x -mêmes, St que par conféquent lis ne
purent regarder l’art comme l’imitation de la
beauté la plus parfaite : la fécondé, c’eft que
les loix leur preferivoienc une continuité de
principes & de pratique , qui ne permettoit
pas aux artifles de rien ajouter a ce qu’avoienc
fait leurs.prédéceffeurs.
Comment les Egyptiens auroient-ils pu s’élever^
comme les Grecs , jufqu’à la beauté
ideale, iorfqu’ ils ne connoiffoient pas même
la beaute individuelle ? La configuration du
vi(age des Chinois, leur.gros rentre, & la
pelante rondeur de leurs, cou tours font des dé^
fauts que partageoîent les Egyptiens. On pour-
' roit hardiment prononcer que lés Calmouques
ne feront jamais de bons artifles aux yeux
des autres nations | les Egyptiens, avec la
meme laideur, a voi en t reçu de la nature la
même négation pour la perfeflion des arts. SI
-les Romains ‘ont célébré quelquefois la beauté
des jeunes Egyptiens , nous penferons , avec
Vinçkelmann , que ces éloges avoieht pour
objets les jeunes Grecs nés en Egypte.
I l étoit interdit aux artifles , '•dans cette
contrée, de rien changer au vieux fly le de
leurs prédécefleurs. L’élève faifoit prccifëment
comme fon maître, qui lui-même fuivoit fer-
| vilement la manière dès maîtres qui avoienc
vécu dans Tes fiècles reculés ; & s’ ils s’ en
etoient écartés , ils auroientété punis comme
d’un attentat contre la religion.. Il -n’y avoit
donc pas d’émulation ; aucun artifle ne cher-
choit à faire mieux qu’un .autre ; & f i , dans
l’état de torpeur où le jettoit la loi , il eûa
encore pu fentir quelques élans du génie; s’ il
avoit éprouvé le befoin de créer, ‘il au roit
réfréné ce dangereux mouvement que le fana-
tifme fe tenoit toujours prêt à punir comme
une impiété,
Ainfi les Egyptiens confervèrent toujours,
' dans leurs flatues, une pofition roide, & des
bras pendans perpendiculairement furies côtés.
De quelle perfeétion pouvoit être capable u»
peuple qui ne connoiffoit qu’une attitude ;
celle des porteurs de brancards ? L’art doit
être l’imitation de tous les mouvemens que la
nature a rendus poflibles aux animaux, à l ’homme
, à tout ce qui a de. la flexibilité ; un peuple
qui fe propofe pour objet l’ immobilité , qui la
confacre par des loix , fe condamne lui-même
à languir toujours dans l’enfancé de l’art.
A ufîi, même dans le temps d’Adrien , les fculp-
teurs de l’Egypte avoient-ils conferve la roi-
deur & l’ immobilité dont ils trouvoient les
exemples dans les ouvrages de leurs predécef-
feurs. Ce furent encore avec des braspéndans,
& dans la roideur confacrée de l’ancienne attitude
, qu’ ils repréfentèrent Antinous , lorfque
leur lâche adulation mit entre les objets de Jour
culte ce favori de l’Ejnpereuj*. O» peut remar*
S C U
quer Ici le travers de la fuperflition ; elle eut
fait à des artifles un cripie capital d’ajouter a
l’ induflrie de leurs ancêtres quelques perfections
nouvelles, &. elle permettoit au peuple
d’adorer le v il objet de la pafïion dépravée
d’un Souverain. Elle faifoit un crime de ce qui
méritoit des récompenfes, & elle érigeoit un
crime trop réel en un devoir religieux.
Au re fie , il ne faut pas confondre l’An-ti»
nous Egyptien , avec le faux ou vrai Antinous
, dont la flatue efl comptée au nombre
des plus célèbres antiques du fécond ordre,,
dont les moules ônt été multipliés & l’ont
faitconnoître dans toute l’Europe, &: dont les
copies en petit fe trouvent dans tous les atte-
lie r s , où , par corruption , on nomme cette
figure le Lantin. . Cet _ ouvrage efl regardé
comme le'chef-d’oeuvre de ce qui nous efl refié
de la fculpture romaine : mais c’eft: peut-être
gratuitement que nous en faifons honneur a
l ’art des Romains; - & rien ne peut nous affurer
que ce ne foit pas l’ouvrage d’ un Grec employé
par les vainqueurs de fa nation.
Lès Egyptiens ne pouvoient connoître l-’ana-
tomie, puifque celui même qui ouvroit les
cqrps pour les embaumer étoit obligé, de fe
fouflraire par la fuite, à la fureur du peuple:
autre égarement de la fuperflition qui ordonnoit
l ’ouverture des cadavres, 8c menaçoit ceux qui
fa'ïfoient cett.e ouverture. Interdire l’étude de
l’ anatomie , c’eft: attaquer les arts dans leurs
fondemens, puifque fans laconnoiffance desos
qui font la charpente du corps humain, & des
mufclesqui donnent aux différentes parties du
corps lé mouvement, on ne peut attendre aucune
jufleflè , aucune rex'prefiion , aucun ca-
raélère, aucune vérité dans lés formes.
Malgré-'la confiance des'Egyptiens, à-leurs
vieux ufages , & les-barrières qu’ ils imposèrent
à toute perfeétion nouvelle , on diflingue
cependant chez eux , félon Winckelmann,
deux flyles diftérens qui appartiennent à deux
époques bien marquées; la première^ de ces
époques conduit jufqu’ à la conquête de J’E-
gypfe par Cambyfe; la fécondé , depuis cette
conquête jufqu’ à la domination des Grecs,
c’eft-â-dire, ju ("qu’aux temps qui fuiyirent la
mort d’Alexandre.
Dans le premier f ly le , continue Winclcel-
mann, les lignes qui forment les contours font
droites & peu {aillantes : la pofition efl: roide
Éc .gênée. Dans les figures affiles, les pieds, font
ferrés i ’ un contre l’autre, & les. jambes parallèles.,
dans les figures qui font debout & polènt-
fur leurs pieds | l ’un avance plus que l’autre» j
Les. bras .adherens aux côtés, s’oppofent à tout mouvement. Les figures de femmes n’ ont qu’ un j
bras pendant fur le côté’ ; le bras gauche eft
plié fous le fein. On v o it, de ce f ly l e , plu-
fieurs figures accroupies , & d’autres à genoux, '
S C U 31e
Les os 8c les mufcles font foîblement indiqués
: on n’apperçoit que ceux qui ne peuvent
même échapper aux perfonnes qui confidérent,
même avec une très foible attention , la figure
humaine, fans qu’elles foientd’ailleurs infimités
, par aucune connoiffance anatomique, de
l’ exiflence de ces os ou de ces mufcles. ‘
On peut conjeélurer que les loix qui etoient
impofées par la religion aux Egyptiens pour
l’ imitation de la figure humaine , n’avoient
rien prononcé fur celle des animaux. On con-
noît des fphynx & des lions égyptiens dans le s quels
on admire un bon trav a il, 8c même un
travail favant. On y voit la variété des contours,
le coulant des formes , les attachemens
des parties, le fentiment des mufcles & des
veines. C’étoit donc feulement dans l ’exécution
des animaux , qu’ il étoit permis aux artifles
de montrer de l’ art.
Dans les têtes . égyptiennes, les yeùx font
plats & tirés obliquement, au-lieu que , dans
les têtes grecques, ils font enfoncés dans leur
. enchaffement. L’os fur lequel pofe les fourçils
eft applâti ; d’où réfulte, en fculpture, des
têtes fans effet & fans caraétère.- L’os de la joue
efl faillant & fortement indiqué ; le menton
efl toujours rapetifle & tire. Ces caraélères
coriflans ne doivent pas être attribués au goût
des artifles, mais au genre particulier de phy-
fionomie qui étoit le plus général dans la nation.
On n’ en peut dire autant de quelques
autres vices non moins eonflans des. figures
égyptiennes: les oreilles y font ordinairement
placées à un e . hauteur qui n’ efl pas dans la
nature. On peut de même accufer d’exagération
la forme des pieds , qui font trop larges
& trop applatis. Enfin , fi chez les artifles de
’ l’Egypte on peut trouver dé l’ idéal, ce n’eftr
point dans la beauté, mais dans la défeéluo-
fité.L
es figures d’hommes font ordinairement
nues , à l’exception . d’ un tablier court & à
petits plis qui efl attaché autour des hanches*
Le vêtement des figures dè femmes n’eft indiqué
que par un bord faillant qui entoure les
pambes & le col. C’ eft ce qu’on peut voir à
trois ftatues confervées au Capitole , dont l ’une
paffe pour une Ifis. : - ' .
A rune.de ces figures, il part du mamme-
lon plufieurs traits ferrés qui s’étendent fur les
mammeli.es , & que l’artifte a deftinés vrai-
/ femblablement à indiquer l’ étoffe légère d’ ua
voile.
On voit à la Villa*Âlbani, une Ifis d’un
j ftyle que Winckelman juge poftérieur. Elle a
I
fur les mamniellès des plis tendans à une même
direélion, 8c qui font d’ailleurs fi peu marqués,
que le fein paroît être nucf. En général y
les draperies de ces figures font fr foiblemenç
1 indiquées, que-, fans une attention particullèî*