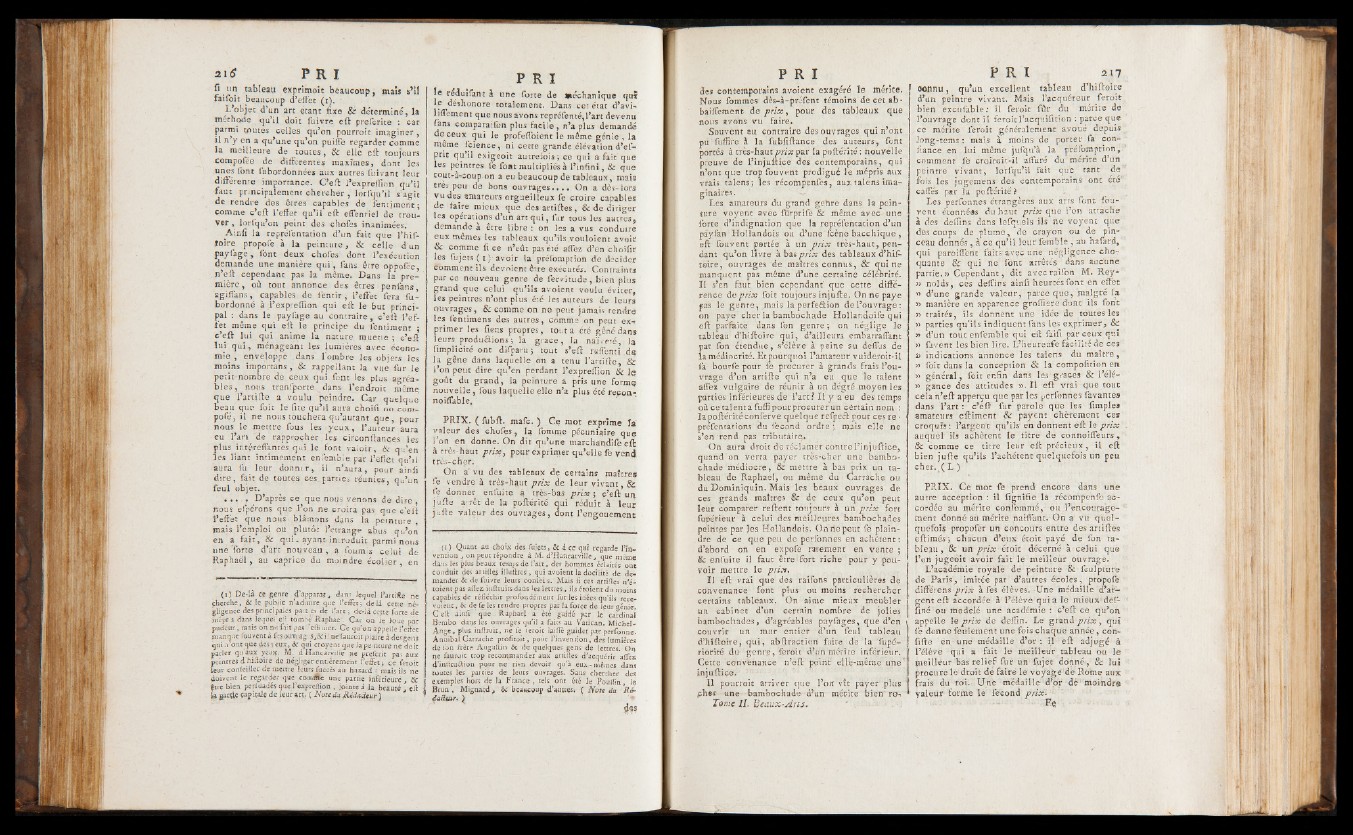
fi un tableau exprimoit beaucoup, maïs s’ il
fai foit beaucoup d’effet (i). •
L’objet d’un art étant fixe & déterminé, la
méthode qu’il doit fuivre eft prefcrite : car
parmi tontes celles qu’on pourroit imaginer ,
il n’y en a qu’une qu’on puiffe regarder comme
la meilleure de toutes, & elle eff toujours
compofée de differentes maximes, dont les
unes font lubordonnées aux autres luivant leur
différente importance. C’eft l ’exprefïion qu’ il
faut principalement chercher , lorfqu’il s’agit
de rendre des êtres capables de fentimerit ;
comme c’eft l’effet qu’il eft effenriel de trouver
, Jorfqufon peint des çhofes inanimées.1
Ainfi la reprélentation d’ un fait que l ’hif-
>oire propofe à la peinture, & celle d'un
payfage, font deux chofes dont l ’exécution
demande une manière qui , fans être oppofëe,
ji’ eft cependant pas la même. Dans la première,
où tout annonce des êtres penfens
Sgiffans, capables de ièntir; l’effet fera fu-
bordonné à l’expreflion qui eft le but princi- |
pal : dans le payfage au contraire, c’eft l’ ef- I
fet même qui eft le principe du fentiment ;
c’eft lui qui anime la nature muette ; c’eft
lui q u i, ménageant les lumières avec économie
, enveloppe dans l’ombre le$ objets les
moins importans , & rappellant la vue fur Je
petit-nombre de ceux qui font les plus agréab
le s , nous tranfporte dansi l’endroit même,
que l’artifte a voulu peindre. Car quelque
beau que foit le fite qu’ il aura çhoifi ou com-
pofé, il ne nous touchera qu’autant que, pour
nous le mettre fous les y e u x , l’auteur aura
eu l’art de rapproçher. les circonftançes lés
plus intéreffantes qui le font valoir, & qu’en
le s liant intimement enfemble par l’effet qu’ il
aura fu leur donner, il n’aura, pour ainfi
dire, fait de toutes ces. parcies réunies, qu’un
feul objet.
. . . . . D’après ce que nops venons de dire ,
nous efpérons que l ’on ne croira pas que c’eit
l’ effet que nous blâmons d$ns la peinture
mais l’emploi ou plutôt l’étrange abus qu’on
en a fa it, & q u i. ayant introduit parmi nous
une forte d’art nouveau, a foums celui de
Raphaël, au caprice du moindre é colier, en
( i) De-là ce genre d'apparat, dan- lequel l’artrfte ne
cherche, & le public n’adimre que l’effet; delà cette négligence
des principales patt es de l’art ; de-là cette forte de
mépirs dans lequel e't comSê Raphaç-. Car on le knie pair
pudeur, mais on ne fait pas .’ eftimer. Ce qu’on appelle-l’effet
manque Couvent à fesouvragv Sjôc i! ne fauioir plaire à des gens
qui a ’ont que des yeux, 3c qui croyçnt que la peinture ne doit
parler qu'aux yeux. M. d'Hancarville pe preferit pa> aux
peintres d hirtoire de négliger entièrement l’effet ; ce feroit
leur conleiller de mettre leurs lùccès au hazard - mais ils ne
doivent le regarder que comme une patrie inférieure , &
$tre bien persuadés que l’expredion , jointe à la beauté . eft
te gariie capitale de leur ^ t , ( Ilote du R 4da3eur )
le reduifant à une forte de méchanique quî
le déshonore totalement. Dans cet état d’avis
liffemenc que nous avons repréfenté,l’art devenu
fans comparaifon plus facile, n’a plus demande
de ceux qui Je profeffoient le même génie , la
même fçience, ni cette grande élévation d’ef-
prit qu’il exigeoit autrefois; ce qui a fait que
les peintres le font multipliés à l’ infini, 8c que
touNa-Æoup on a eu beaucoup de tableaux, mais
très peu de bons ou v ra g e s .,.. On a dès-lors
vu des amateurs orgueilleux fe croire capables
de faire mieux que desartiftes, & de diriger
les opérations d’ un art qui, fur tous les aucres,
demande a être libre : on les a vus conduire
eux mêmes les tableaux qu’ ils vouloient avoir
& comme fi ce n’ eût pas été affez d’ en choifir
les fujets ( 1 ) avoir la prélomption de décider
comment ils dévoient être exécutés. Contraints
parce nouveau genre de fervitude, bien plus
grand que celui qu’ ils avoient voulu éviter,
les peintres n’ont plus été les auteurs de leurs
ouvrages, & comme on ne peut jamais rendre
les fentimens des autres, comme on peut ex-*
primer les fiens propres, tout a été gêné dans
leurs productions ; la grâce, la naïveté, la
(implicite ont difparuj tout s’eft rGffenti ,dg
la gêne dans laquelle on a tenu l’artifte, 8c
l’on peut dire qu’en perdant l’expreffion 8c le
goût du grand, la peinture a pris une forme
nouvelle, fous laquelle elle n’a plus été répons
noiffable,
PRIX. ( fubft. mafe. ) Ce mot exprime la
valeur des chofes, la fomrae pécuniaire que
l ’on en donne. On dit qu’une marchandife eft
à très-haut p r ix , pour exprimer qu’elle fe vend
très-cher.
On a'vu des tableaux de certains maîtres
fe vendre à très-haut prix de leur vivant, &
le donner, enfuite à très-bas prix ; ç’eft un
jufte a'-rêt de la poftérité qui réduit à leur
jufte valeur des ouvrages, dont l’engouemenc
(1 ) Quant an choix des fujets, Sç à ce qui regarde l’in*
vencion f on peut répondre à M. d’Ha-ncarville que même
dans les plus beaux temps de l’art, des hommes éclairés one
conduit des ariiftes illuffres, qui avoient la docilité de demander
& de fuivre leurs confei s. Mais fi ces artiffes n’é-
toient.pas affez inftruitsdans les lettres, ils écoient du moins
capables de réfléchir profondément fur les idées qu’ils reçe-
voient, de fe les rendre propres par la force de leur génie.
C'eft ainfi’ que Raphaël a été guidé par le’ cardinal
Bembo dans les ouvrages qu’il a faits au Vatican. Michel-
An ge , plus inftr.uit, ne fe teroit laiffe guider par perfonne.
AnnibalGarrache profiroit, pour l’invention, des lumières
de fon frère Augullin 8c de quelques gens de lettres^ Ory
ne fauroit trop recommander aux ardites d’acquérir affez
d’initruûion pour ne rien devoir qu’à eux - mêmes dans
toutes les partiès de leurs ouvrages. Sans chercher des
exemples hors de la France , tels ont été le Poulfin, le
Brun , Mignard, 8c beaucoup d’autres, ( JYote du Ré~
datleur. )
P R I
des contemporains avoient exagéré ïe mérite.
Nous fommes dès-à-prefent témoins deçetab*
baiffement de p r ix , pour des tableaux que
nous avons vu faire.
Souvent au contraire des ouvrages qui n’ont
pu fuffire à la fubfiftance des auteurs, font
portés à très-haut prix par la poftérité : nouvelle
preuve de l’ injuitice des contemporains, qui
n’ont que trop fouvent prodigué le mépris aux ,
vrais talens; les récompenfes, aux talens imaginaires.
Les amateurs du grand gehre dans la peinture
voyent avéc fffrprifë 8c même avec une
forte d’ indignation que la repréfentation d’ un
payfan Hollandois ou d’une fcène bacchique ,
eft fouvent portée- à un prix très-haut, pendant
qu’on livre à bas prix des . tableaux d’hif-
toire, ouvrages de maîtres connus, & qui ne
manquent pas même d’une.certaine célébrité.
Il s’en faut bien cependant que cette différence
de prix foit toujours ïnjufte. On ne paye
pas le genre, .mais la perfeélion de l’ouvrage:
on paye cher la bambochade Hollandoife qui
eft parfaite dans fon genre ; on néglige le
tableau d’hiftoire qui, d’ailleurs embarraffant
par fon étendue, s’élève à peine su deffus de '
la médiocrité. Et pourquoi l ’amateur vuide.roit-il
fa bourfe pour fe procurer à grands frais l ’ouvrage
d’ un artifte qui n’a eu que le talent
affez vulgaire de réunir à un degré moyen les
parties inférieures de l’art? Il y a eu des temps
où ce talenta fuffi pour procurer un certain nom :
la poftérité conferve quelque refpeél pour ces re -
prefentations du fécond ordre ; mais elle ne
s’ en rend pas tributaire.
On aura droit de réclamer contre l’ injuftice,
quand on verra payer très-cher une bambo-
chade médiocre, & mettre à bas prix un tableau
de Raphaël, ou même du Garraçhe ou
du Dominiquin. Mais les beaux ouvrages de
ces grands maîtres & de ceux qu’on peut
leur comparer refirent toujours à un p rix fort
fupérieur à celui des meilleures bambochades
peintps par les Hollandois. On rie peut fe plaindre
de ce que peu de perfonnes en achètent :
d’abord on en expofe rarement en vente ;
8c enfuite il faut être fort riche pour y pouvoir
mettre le prix.
Il eft vrai que des raifons particulières dë
convenance font plus1 ou moins rechercher
certains tableaux. On aime mieux meubler
un cabinet d’un certain nombre de jolies
bambochades, d’agréables payfages, que d’en t
couvrir un mur entier d’un feul tableau
d’hiftoire, q ui, ab (Fraction faite de la Fiipé-
riorité du genre, feroit d’ un mérité inférieur.
Cette convenance n’eft point elle-même une'
injuftiçe, •
Il pourroit arriver que l’on vît pâÿer plus '
pher une bambochade d’un mérite bien r0i
Tome II. Beaux-Arts. ' .
P R X 217
connu, qu’un excellent tableau d’hiftoire
d’un peintre vivant. Mais l’acquéreur feroit
bien excufable: il feroit fûr du mérite de
l’ouvrage dont il feroit l’acquifition : parce que
^ce mérite feroit généralement avoué depuis
long-tems : mais à moins de porter fa confiance
en lui même jufqu’à la préfomption,
comment fe croîroit-il affuré du mérite d’ un
peintre vivant, lorfqu’ il fait que tant de
fois les jugemens des contemporains ont été
caffés par la poftérité?
Les perfonnes étrangères aux arts font don-
vent étonnées du haut prix que l’on attache
à des defiins dans lefqueîs ils ne voyent que
des coups de plume, de crayon ou de pinceau
donnés , à ce qu’ il leur feinbîe , au hafard,
qui paroiffent faits avec une négligence chor
qtiante & qui ne font arrêtés dans aucune
partie.» Cependant, dit avecraifon M. Rey*
» nolds, ces deffins. ainfi heurtés font en effet
» d’une grande valeur, parce que, malgré la
» manière en apparence groffiere dont ils font
» traités, ils donnent une idée de toutes les
» parties qu’ils indiquent fans les exprimer, &
» d’ un tout enfemble qui eft faifi par ceux quî
» fa vent lesbien lire. L’heureufe facilité de ces
» indications annonce lès talens du maître,
» foit dans la conception & la cômpofition en
» général, foit enfin dans lés*grâces & l’élé—
» gance des attitudes ». I l eft vrai que tout
cela n’ eft apperçu que par les perfonnes favantes
dans l ’art : c’eft fur parole que les (impies
amateurs eftiment & payent chèrement ces
croquis: l’argënt qu’ ils en donnent eft le prix
auquel ils achètent le titre dé connoiffeurs,
& comme ce titre leur eft précieux, il eft
bien jufte qu’ ils l’achètent quelquefois un peu
ch e r .^ L )
PRIX. Ce mot fe prend encore dans une
autre acception : il fignifie la récompenfe accordée
au mérite confommé,-ou l’ encourage-'
ment donné au mérite naiflant. On a vu quelquefois
propofer un concours entre des artiftes
eftimés; chacun d’eux étoit payé de fon tableau,
6c un prix étoit décerné à celui que
l’on jugeôit avoir fait Je meilleur ouvrage.
L’académie royale de peinture 8c feulpiure
de Paris, imitée par d’autres écoles, propofe
différens prix à fes élèves. -Une médaille d’argent
eft accordée à l’élèvé qui a le mieux1 défi-
fine ou modelé uné académie : c’eft ce qu’on
appelle le prix de deffin. Le grand p r ix , qui
fe donne feulement une fois chaque année, con-
fifte en une médaille d’o r : il eft adjugé à
i’élèvë qui a fait lé meilleur tableau ou le
meilléur Bas relief (lir un -lu jet donnée, & lui
procuré lé droit de faire le vbÿâ^è'de Rome aux
frais du roi. Une médaille-'d’pr dè 'moindre
yaleur formé le fécond prix