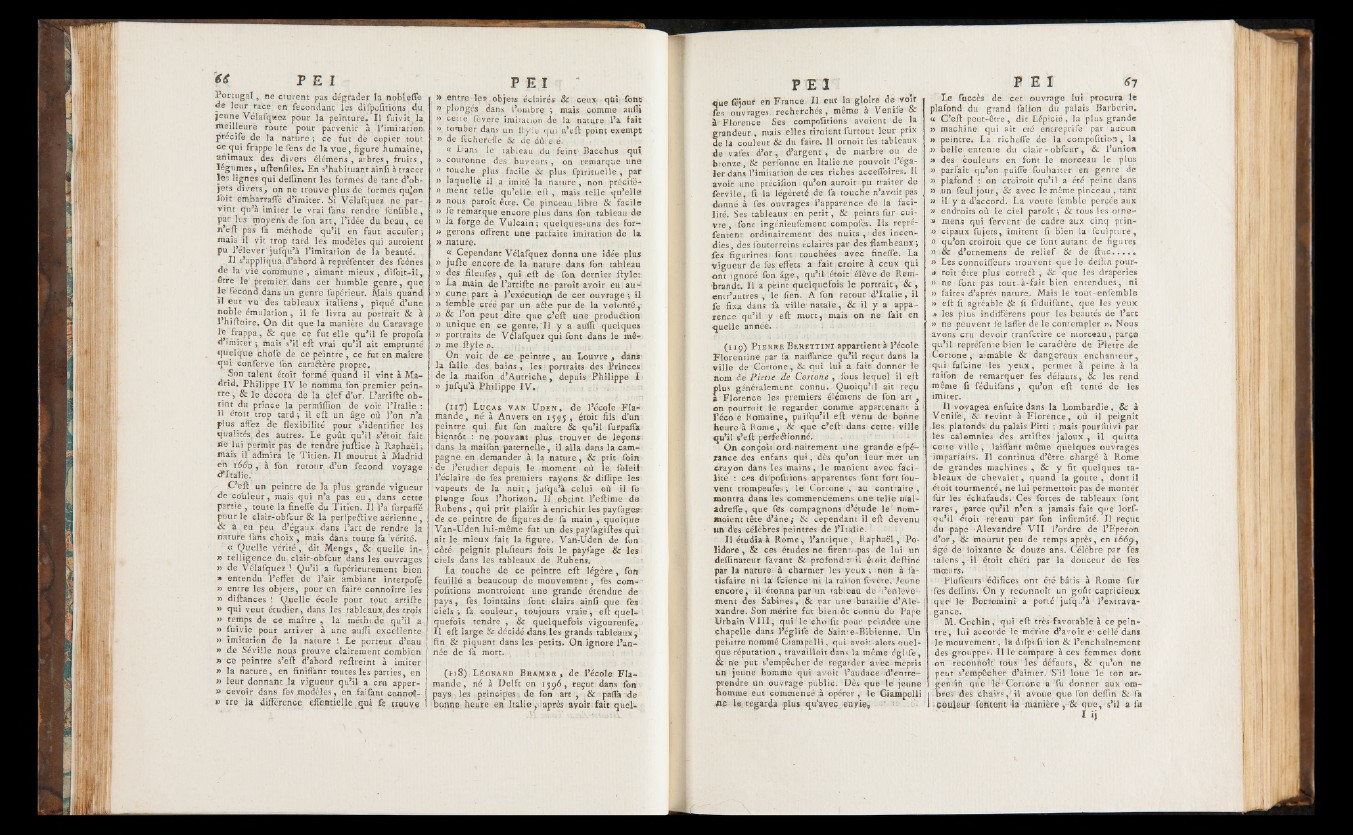
P ortu gal, ne crurent pas dégrader la nobleffe
de leur race; en fécondant lès di'fppfitiôns du,
jeune Vélafquez pour la peinture. I l fuivft ja .
iiieilleure route pour parvenir à . l'imitation,
précife de la natüre *, ce - fut dè copier tout
ce qui frappe le (ens de la vu e , figure humaine,
animaux des divers élémens, arbres, fruits,
légumes, uftenfiles. En s’habituant ainfi à tracer
les lignes qui deflinent les formes de tant d’ob-,
pets aiveVs, on ne trouve plus dé formés qu^on
loit embarraffé d’imiter. Si Vélafquez ne parvint
qu’à imiter le vrai fans, rendre fenfible,
par les moyens de fon art, l ’ idée du beau, ce
n’eft pas Ta méthode qu’il en faut accufer ;
mais il yit trop tard les modèles qui auroient
pu l’élèver jufqu’ à l’imitation de la beauté. ,
U.s’appliqua d’abord à repréfenter des fcènes
de la vie.commune', aimant mieux, difoit-il,
etre le premier, dans cet humble genre, que
le fecôna dans un genre fupérieur. Mais quand
il eut vu des tableaux italiens , piqué d’une
noble émularion, il fe livra au portrait & à 1 hiftoire. On dit que la manière du Caravage
^ frappa, & que ce fut elle qu’il fe propofa
d’ imirer y mais s’ il eft vrai qu’ il ait emprunté
quelque chôfe de ce peintre, ce fut en maître
qui conferve Ton cara&ère propre.
Son talent étoit formé quand il vint à Madrid.
Philippe IV le nomma fon premier peintre
, & le décora de la c le f d’or. L’artifte obtint
du prince la permllïion de voir l’ Italie :
f* étoit trop tard ', il eft un âge où l’on n’a
plus alfez de flexibilité pour s’identifier les
qualités, des autres. Le goût qu’ il s’étoit fait
lui permet pas de tendre juftice,à Raphaël y
mais il admira le Titien. Il mourut à Madrid
en 1660, à fon retour d’un fécond voyage
d’Italie.1
- .C’eft un peintre de la plus grande vigueur
de couleur, mais qui n’a pas eu , dans cette
partie , toute la fineffe du Titien. I l l’a furpaffé
pour le clair-obfcur & la perfpeéiive aerienne,
& à veu peu. d’égaux dans l ’art de rendre la
nature fans choix ,,mais dàns.toure fa vérité.
Quelle vérité , dit Mengs, Sc; quelle in-
y> télligence du clair-obfcur dans les ouvrages
» de Vélafquez ! Qu’il a fupérieurement bien
» entendu l ’effet de l’air ambiant interpofé
» entre les objets, pour en faire connoître les
» diftances ! Quelle école pour tout arrifte
» qui veut étudier, dans les tableaux,des trois
» temps de ce maître , la méthode qu’il a
» fuivie pour arriver à une aufîi excellente
» imitation de la nature '. Le porteur d’eau
» de Séville nous prouve clairement combien
» ce peintre s’eft d’abord reftreint à imiter
» la nature, en finiffant toutes les parties, en
» leur donnant Ja vigueur qu’ il a cm apper-
» cevoir dans fes modèles, en faifant connoî- 1
*> tre la différence effemielle tqui fe trouve
» entre les objets éclairés & ceux -q üi font
, ^ plongés dans l’ombre ; mais comme anfli
| cette, févere imitation de la nature: l’a fait
• » tomber dans un ftyle qui n’eft point exempt
| » de fécherefle & de dûrewé.;
« Dans le tableau d u . feint' Bacchus qui
» couronne des buveurs, on remarque une
. » touche plus facile & plus, fpirituelle , par
» laquelle il a imité la nature, non préçifé-
» ment telle qu’elle, eft , mais telle qu’ elle
» nous paroît être. Ce pinceau .libre & facile
: » fe remarque encore plus dans fon tableau de
» la forge de Vulcain; quelques-uns des for-
» gérons offrent une parfaite imitation de la
» nature.
« Cependant Vélafquez donna une idée plus
. » jufte encore de la nature dans fon tableau
» des fileufes, qui eft de fon dernier ftyle:
» La main de l’artifte ne paroît avoir ëu.au-
. » cune part à l’exéçutiqji de cet ouvrage •, il
» femble créé par un ade pur de la volonté,
» & l ’on peut dire que ç’eft une produélion
» unique.en ce genre. Il y a aufli quelques
» portraits de Vélafquez qui font dans le mê-
» me ftyie ».
On voit de ce peintre, au. Louvre , dans
la falle des. bains , le s : portraits des Princes
dé j à maifon d’Autriche, depuis Philippe I
» jufqu’à Philippe IV . :
(117) Lucas van Ùden, de l’école F lamande,
né à Anvers en 1595 , étoit fils d’un
peintre qui fut fon maître & qu’ il furpaffa
; biçntôt :: ne;pouya»t plus, trouver de leçons
s dans- la maifon paternelle, il alla dans la campagne
en demander à la nature, & prit foin
• de l’étudier depuis le moment où le foleil
l’éclaire de fes premiers rayons & diflipe les
vapeurs de la nuit, .jufqu’à celui où il fe
plonge fous l’horizon. Il .obtint, l’eftime de
Rubens , qui prit plaifir à enrichir; les payfagesï
de ce-peintre de figures de * fa main , quoique
Van-Uden lui-même fut un des payfagiftes qui
ait le mieux fait la figure^ Van-Uden de fon
côté peignit plufieurs fois le payfage & les
ciels dans les tableaux de Ruben9.
La touche de ce peintre eft légère , fon
feuillé a beaucoup de mouvement, fes com- '
pofitions montroient une grande étendue de
pays, fes lointains font, clairs ainfi que fes
! ciels -, fa couleur, toujours v raie , eft quel- :.
quefois tendre , & quelquefois vigoureufe.
I l eft large & décidé dans les grands tableaux ÿ
fin & piquant dans les petits. On ignore l’année
de fa mort.
(1*18) Léonard Bramer , de l’école Flamande,
né à Delft en 1596, reçut dans fon
pays., les principes 1 de fon art , & pafïà de
bonne heure fÉh Italie y : après avoir , fait quel«.
que fëjour eh France. I l eut la gloire de voir
fes ouvrages.'recherchés, même à Venife &
à Florence Ses compofitions avoient de la
grandeur , mais elles tiroient furtout leur prix :
de la couleur & du faire. Il ornoit fes tableaux ;
de vafes. d’or , d’argent:-, de marbre ou de
bronze, & perfonne en Italie ne pouvoit l’éga- j 1er dans l’ imitation de ces riches acceffoires. Il ■
avoit une précifion qu’on auroit pu traiter de ;
fe rv ile , fi la légèreté de fa touche n’avoit pas
donné à fes ouvrages l’apparence de la facilité.
Ses tableaux en petit, & peints fur cuiv
r e , font ingénieufement compofés. Ils repré-
fentent ordinairement des nuits , j des incendies,
des fouterreins éclairés par des flambeaux y
fes figurines; font touchées , avec fineffe. La
vigueur de fes effets a fait , croire à ceux qui
ont ignoré Ton âgé , qu’ il étoit’ élève de Rembrandt.
Il a peint quelquefois le portrait , & ,
entr’autres , le lien. A fon retour d’I ta lie , il
le fixa dans fa ville- natale, & il y a apparence
qu’ il y eft mort, mais on ne fait en
quelle année.
(119) Pierre Berettini appartient à l’école
Florentine par fa naiffance qu’ il reçut dans la
v ille de Cortone!, & qui lui a fait donner le j
nom de Pietre de Cortohe , Tous lequel il eft
plus généralement connu. Quoiqu’ il ait reçu
a Florence les premiers élémens de fon art , ;
on pourroit le regarder comme appartenant à j
l’éco è Romaine, puifqu’ il eft- venu de bonne ;
heure à Rome,- & que c’ eft: dans cetter v ille j
qu’il s’eft perfeélionné. ;
On çonçoit:ord.nairement line grande efpé-î
rance des enfans q u i, dès qu’on leur met un
crayon dans les mains, le manient avec facilité
: ces difpofitions apparentes font fort l’ou-
vent trompeufes, le Cortone , au contraire1,
montra dans les commencemens une telle mal-
adreffe , que fés compagnons d?étude l e f nom-
moient tête d’âne ; Sc cependant il eft devenu
tm des célèbres •peintres de l’ Italie.
I l étüdia à Rome, l’antique, Raphaël, Po-
lidore, & ces études ne firent'*pas de lui un
deffinateur favant & profond j;1 il éioit dcftiné
par la nature à charmer les yeux -, non à fa-
tisfaire ni la fcïence ni la raiion févère. Jeune
encore; il-étonna par un tableau dé^l’ enlévè-
ment des Sabines, par une bataille d’Alexandre.
Son mérite fût bientôt connu du Pâpë
Urbain V I I I , q u i■ le chotfic poür peindre une
çhâpelle dans l’églifè de Sain^e-Bibienne. Un
peintre nommé Ciampelli, qui avoit alors quelque
réputation , travailloit dans la même églife,
& ne put s’empêcher de regarder avec mépris
un jeune homrtie qui avoit l’audace •d’éntrérendre
un ouVrage public. Dès q u e 'le jeune
omme eut commencé à opérer , le Ciampelli
41e • 1@. regarda plus qu’avec en y içv - oi
Le
(accès de cet' ouvrage lui procura le
plafond du grand fallon du palais Barberin.
« C ’eft peut-être, dit Lépicié, la plus grande
» machine qui ait été entreprife par aucun
» peintre. La richeffe de la compofition , la
.» belle entente du c la ir -o b fcu r , & l ’union
» des couleurs en font le morceau le plus
» parfait qu’on puiffe fouhaiter en genre de
» plafond : on croiroit qu’ il a été peint dans
» ,un feul jour, & avec le même pinceau , tant
» il y a d’accord. L a voûte femble pércée aux
» endroits où le ciel paroît *, & tous les orne-
» mens qui fervent de cadre aux cinq prin-
» cipaux fujets, imitent fi bien la fculpture,
» qu’on croiroit que ce font autant de figures
» & d’ornemèns de relief & de fine..........
» Les connoiffeurs trouvent que le dellin pour-
a rot t être plus côrreéb, & que les draperies
» ne font pas tout-à-fait bien entendues, ni
» faites d’après nature.. Mais le tout-enfemble
» eft fi agréable ik fi féduifant, que les yeux
* les plus indifferens pour les beautés de l’ arc
» ne peuvent fe laffende le contempler ». Nous
avons cru devoir tranferire ce morceau, parçe
qu’ il :repréfente bien le caraélère de Pietre de
Cortone ; aimable & dangereux enchanteur ,
qui fafeine les y e u x , permet à peine à la
raifon de remarquer fes défauts, & les rend
même fi féduïfans , qu’on eft tenté de les
imiter.
Il voyagea enfuite dans la Lombardie, & à
Venife, ik revint à Florence, où il peignit
,les plafonds du palais Pitti : mais pouriuivi par
les calomnies des artiftes jaloux , il quitta
cette v i l l e , laiffant même quelques ouvrages
imparfaits. I l continua d’être chargé à Rome
de grandes machines , & y fit quelques tableaux
de chevalet, quand la goûte , dont il
étoit tourmenté, ne lui permettoit pas,de monter
Air les échafauds. Ces fortes de tableaux font
rares , parce qu’ il n’en a jamais fait que lorf-
qu’ il étoit retenu par fon infirmité. Il reçut
du pape ‘Alexandre V I I l’ordre de l’Eperon
d’o r , & mourut peu de temps après, en 1660y
âgé de foixante & douze ans. Célèbre par fes
talens , étoit chéri par la douceur de fes
moeurs.
Plufiéurs édifices ont été bâtis à Rome fur
Tes deffins. On y reconnoît un goût capricieux
qijëî lé Boriiomini a porté■’ jufqu’ à l’extrava-
. gance.
M. Cochin, qui eft très-favot,able à ce peîn-*-
tre, lui accorde le mérite d’ avoir e> celle dans
Je mouvement, la dilpefi ion & l’ enchaînement
des grouppef. I l le compare à ces femmes dont
on reconnoît tous les défauts, & qu’on ne
peut s’empêcher d’aimer. S’il loue^îe ton ar-
gen:!ift que lé Cortone a Tu donner aux ombres
des Chairs y il avoue que fon deffm & fa
couleur Tentent la manière, & que, s’ il a fu