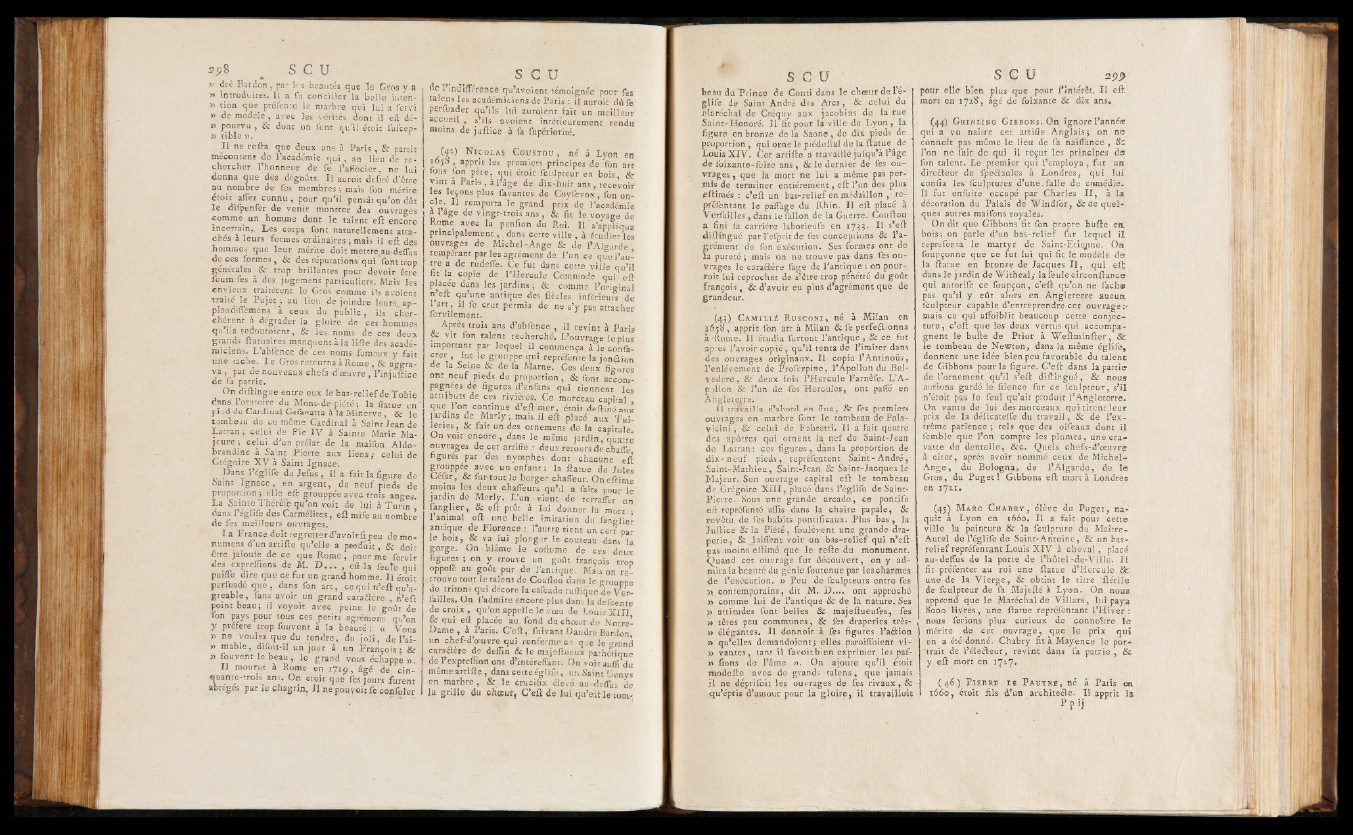
» dre Bar don, par 1rs beautés que le Gros-y a
» introduites. Il a lu concilier la belle inten-
y> tion que pré 1er.te le marbre qui lui a fervi
» de modèle , avec les vérités dont .il efl dé-
» pourvu , & dont on fent qu’il écoit lufcep-
» tible ».
I l ne refta. que deux ans à Paris , & partit
mécontent de l'academie ~q_ui, an lieu de rechercher
l ’honneur de fe . l’affocier, ne lui
donna que des dégoûts. Il auroit déliré d'être
au nombre de" Tes membres -, mais fon mérite
ctoit affez connu, pour qu'il pensât qu'on dût
le difpenfer de venir montrer des ouvrages
comme un. homme dont le talent eft encore
Incertain. Les corps font naturellement attachés
à leurs formes ordinaires ; mais il eft des
hommes que leur mérite doit mettre au-deffus
de ces formes, & des réputations qui font trop
generales & trop brillantes pour devoir être
foum fes à des jugemens particuliers. Mais les
envieux traitèrent le Gros comme ils avoient
traite le Pujet *, au lieu de joindre leurs^ap-
plaudiffemens à ceux du public, ils cherchèrent
à dégrader la gloire de ces hommes
q u ils redoutoient, & les noms de ces deux
grands ftatuaires manquent à là lifte des académiciens.
L'abfence de ces noms fameux y fait
une tache. Le Gros retourna à Rome , & aggrava
, par de nouveaux chefs-d'oeuvre,Tinjuftice
de fa patrie.
On diftingue entre eux lé bâs-reliefdeTobie
dans l’oratoire du Mont-de-piété; la flatue_en'
pï-d du Cardinal Calànatta à la Minerve, & le
tombeau de ce même Cardinal à Saint Jean de
Xatran ; celui de Pie IV à Sainte Marie Majeure
; celui d’un prélat de la maifon Aldo-
brandine à Saint Pierre aux liens; celui de
Grégoire X V à Saint Ignace.
Dans l’égiife du Jefus , il a fait la figure de -
Saint Ignace, .en argent, de neuf pieds de
proportion ; elle eft grouppée arec trois anges.
La Sainte Thérèfe qu’on voit de lui à Turin
dans l’églife des Carmélites, eft mile au nombre
de fes meilleurs ouvrages.
La France doïtregretterd’avoirfipeu de mo-
numens d’ un artifte qu’ elle a produit, & doit
être jalouié de ce que Rome f pour me fervir
des expreffions de M. D . . . , eft la feule qui
puifle dire que ce fut un grand homme. Il droit
periuadé q u e , dans fon art, ce qui n’eft qu’a-
greable, fans avoir un grand caraâère , r.’eft
point beau; il voyoit avec peine le goût de
fon pays pour tous ces petits agrémeris qu’on
y préféré trop fou vent à la beauté: a Vous
» ne voulez que du tendre, du jo l i, de l’ai-
» mable, difoit-il un jour à un François; &
» iouvent le b^eau , le grand vous échappe ».
I l mourut à Rome en 17 19 , âgé de cinquante
trois ans. On croit que fes jours furent
abrégés par le chagrin, I l nepouyoitfe confoler
ne l’ indifférence'qu’avoient témoignée pour Tes
talens les académiciens de Paris : il auroit dû fe
perfuader qu’ ils lui auroienc fait un meilleur
accueil , s’ ils avoient intérieurement rendu
moins de juftice à fa fupériorité.
C42*) N icolas Goustou , né â Lyon en
1658, apprit les premiers principes de fon art
fous fon père, qui étoit fculpteur en bois, &
vint à Paris, à l ’âge de dix-huit ans, recevoir'
les leçons plus favantes de Coyfevox, l’on on-
S » 11 remporta l e grand prix de l’académie
a l âge de vingt-trois ans , & fit 1e voyage de
Rome avec, la penfion du Roi. 11 s’appliqua
principalement, dans cette ville , à étudier les
ouvrages de Michel-Ange & de l’AJgarde
tempérant par les agrémens de l ’ un ce que l’autre
a de rudeffe. Ce fut dans cette v ille qu’il
fit la copie de l ’Hercule Commode qui eft
placée dans les jardins ; & comme l’original
n eft qu’ une antique des.fiècles inférieurs de
l’art, il fe crut permis de ne s’y pas attacher
fervilement.
Après trois ans d’abfence , il revint â Paris
& v it fon talent recherché. L’ouvrage le plus
important par lequel il commença à le confa-
crer , fut le grouppe qui repréfente la jonâton
de la Seine & de la Marne. Ces deux figures
ont neuf pieds de proportion , & font accom-
pagnees.de figures d’enfans qui tiennent les
attributs de ces rivières. Ce morceau capital
que l’on continue d’eftimer, étoit deftiné aux
jardins de Marly; mais il eft placé aux Tuileries,
& fait un des ornemens de la capitale.
On v oir encore , dans lè même jardin, quatre
ouvrages de cet artifte : deux retours de chaffe
figurés par 'des nymphes dont chacune eft
grouppée avec un enfant ; la ftatue de Iules
Célar, & fur-tout le berger chaffeur. On eftime
moins les deux chaffeurs qu’ il a faits pour le
jardin de Msrly. L’un vient de terrafler un
fanglier, & eft prêt s lui donner la mort -
l ’animal eft une belle imitation du fanglier
antique de Florence : l'autre tient un cerf par
le bois, & va lui plonger le couteaii dans la
gorge. On blâme Je coftume de ces deux
figures ; on y trouve un goût français trop
oppofe au goût pur de l’antique. Mais on retrou
ve tout le talent de Couftou dans le grouppe
de tritons qui décore la cafcade ruftique de Ver-
failles. On l’admire encore plus dans la defeente
de croix , cjù’on appelle le voeu de Louis X III
& qui eft placée au fond du choeur de Notre-
Dame , à Paris. C ’e ft, fuivant Dandré Bardon,
un chef-d’oeuvre qui renferme ce q .ie le grand
caraâère de deffin & le majeftueux pathétique
de l’ expreffion ont d’intéfeffar.t. On voit au (fidu
même a rtifte, dans cette églife, un Saint Denys
en marbre , & le crucifix élevé au-deffus de
la grille du ehgeurj C ’eft de lui qu’eü le tombeau
du Prince de Conti dans le choeur de l’églife
de Saint André des Arcs, & celui du
Maréchal de Créquy aux jacobins de la rue
Saint-Honoré. I l fit pour la ville de Lyon , la
fig tire en bronzé de la Saône, de dix pieds de I
proportion , qui orne le piédeftal de la ftatue de
Louis X IV . Cet artifte a travaillé jufqu’ à l’âge
de foixante-feize ans , & le dernier de Tes ouvrages
, que la mort ne lui a même pas permis
de terminer entièrement, eft l'un des plus
jeftimés : c’eft un bas-relief en médaillon , re-
pfefentant le partage du Rhin. I l eft placé à
Verfailles , dans le fallon de la Guerre. Couftou
a fini fà carrière laborieufe en 1*733. I l s’eft
idiftingué par l’efprit de fes conceptions & l’agrément
de fon exécution. Ses formes ont de
la pureté ; mais on ne trouve pas dans fes ouvrages
le caraâère fage de l'antique •- on pourvoit
lui reprocher de s’être trop pénétré du goût
françois , & d’avoir éu plus d’ agrément que de
grandeur.
. (43) Camillé Rusconi, né à Milan en
1650, apprit fon art à Milan & fe perfeâionna
à -Rome. Il étudia furtout l’antique * & ce fut
après l’avoir cop i é , qu’ il tenta de l’ imiter dans
des ouvrages originaux. Il copia l’Antinoüs,
l ’enlèvement de Prolerpine, l’Apollon du Bel-
v e d e r e d e u x fois l’Hercule Farnèfe,. L’A-
pollqn & l ’ un de -fes Hercules, ont parte en
Angleterre.
I l travailla d’abord en fluc, & fes prémiers
ouvrages en marbre font le tombeau de Pala- i
v ic in i, & celui de Fabretti. Il a fait quatre
des apôtres qui ornent la nef de Saint-Jean
de Latran: ces figures, dans la proportion de
dixt neuf pieds, repréfentent Saint-André,
Saint-Mathieu, Saint-Jean & Saint-Jacques le
Majeur. Son ouvrage capital efl le tombeau
de Grégoire X I I I , placé dans l’églife de Saint-
Pierre. Sous une grande arcade, ce pontife
efl; repréfenté aflis dans la chaire papale, &
révêtu de fes habits pontificaux. Plus bas , la
Juftice & la Piété, foulèvent une grande draperie,
& Jaiffent voir un bas-relief qui n’efl
pas moins eftimé que le refie du monument.
Quand cet ouvrage fut découvert, on y admira
la beauté du génie foutenue par les charmes
de l’ exécution. » Peu de fculpteurs entre fes
3> contemporainsj dit M. D.,.. ont approché
» comme lui de l’antique & de la nature. Ses
» attitudes font belles & majeflueufes, fes
>3 têtes peu çommunes, & fes draperies très-
» élégantes. I l donnoit à fes figures l’aâion
» qu’ elles demandoient 5 elles paroiffoient v i-
» vantes, tant il favoitbien exprimer les paf-
» fions de l’âme ». On ajoute qu’ il étoit.
modefte avec de grands talens, que jamais
jl ne déprifoit les ouvrages de les rivaux, &
qu’épris d’amour pour la g lo ire, il trayaUloit
pour elle bien plus que pour l’ intérêt. I l efl
mort en 1728, âgé de foixante & dix ans.
(44) Grinlïng Gibbons. On ignore l’année
qui a vu naître cet artifte Anglais} on ne
connolt pas même le lieu de fa naiffance , &
l ’on ne fait de qui il reçut les principes de
fon talent. Le premier qui l’employa, fut un
direâeur de fpeâacles à Londres, qui lui
confia les fculptures d’une, falle de comédie.
Il fut enfuite occupé par Charles I I , à la
décoration du Palais de Windfor, & de quelques
autres maifons royales.
On dit que Gibbons fit fon propre bulle en.
bois -, on parle d'un bas-relier fur lequel il
repréfénta le martyr de Saint-Etienne. On
foupçonne que ce fut lui qui fit le modèle de
la ftatue en bronze de Jacques I I , qui efl
dans le jardin de NVitheal,* la feule circonftance
qui autorife ce foupçon, c’eft qu’on ne fâche
pas qu’il y eût alors en Angleterre aucun
fculpteur capable d’entreprendre cet ouvrage:-
mais ce qui affoibjit beaucoup cette conjecture,
c’eft que les deux vertus qui accompagnent
le bulle de Prior à Weftminfter, &
le tombeau de Newton, dans la même églife,
donnent une idée bien peu favorable du talenc
de Gibbons pour la figure. C ’eft dans la partie
de l’ornement qu’ il s’eft diftingue, & nous
aurions gardé le filence fur ce fculpteur, s’ il
n’était pas le feul qu’ait produit l’Angleterre.
On vante de lui des morceaux qui tirent leur
prix de la délicateffe du travail , & de l’extrême
patience ; tels que des oifeaux dont il
femble que l’on compte les plumes, une cra»
vatte de dentelle, & c . Quels chefs-d’oeuvre
à citer, après avoir-nommé ceux de Michel-
A n g e , du Bologna, de l’Algarde, de le
Gros, du Puget ! Gibbons eft mort à Londres
en 1721.
(45) Marc Chabry, élève du Puge t, naquit
à Lyon en 1660. I l a fait pour cette
v ille la peinture & la fculpture du Maîrre-
Autel de l’églife de Saint-Antoine, & un bas-
relief fepréfentant Louis X IV à che val , placé
au-deffus de la porte de l’hôtel-de-Ville. I l
fit préfenter au roi une ftatue d’Hercule &
une de la V ie rg e , & obtint le titre ftérile
de fculpteur de fa Majefté à Lyon. On nous
apprend que le Maréchal de Villars, lui paya
8000 livre s, une ftatue repréfentant l’H ive r :
nous ferions plus çurieux de çonnoître ls
mérite de cet ouvrage, que le prix qui
en a été donné. Chabry fit à Mayence le portrait
de l’é leâ eu r , revint dans fa patrie, &
y eft mort en 1717.
(46) Pierre le P au tr e , né à Paris ea
1660, étoit fils d’ un archiieâe. Il apprit la
F p i j