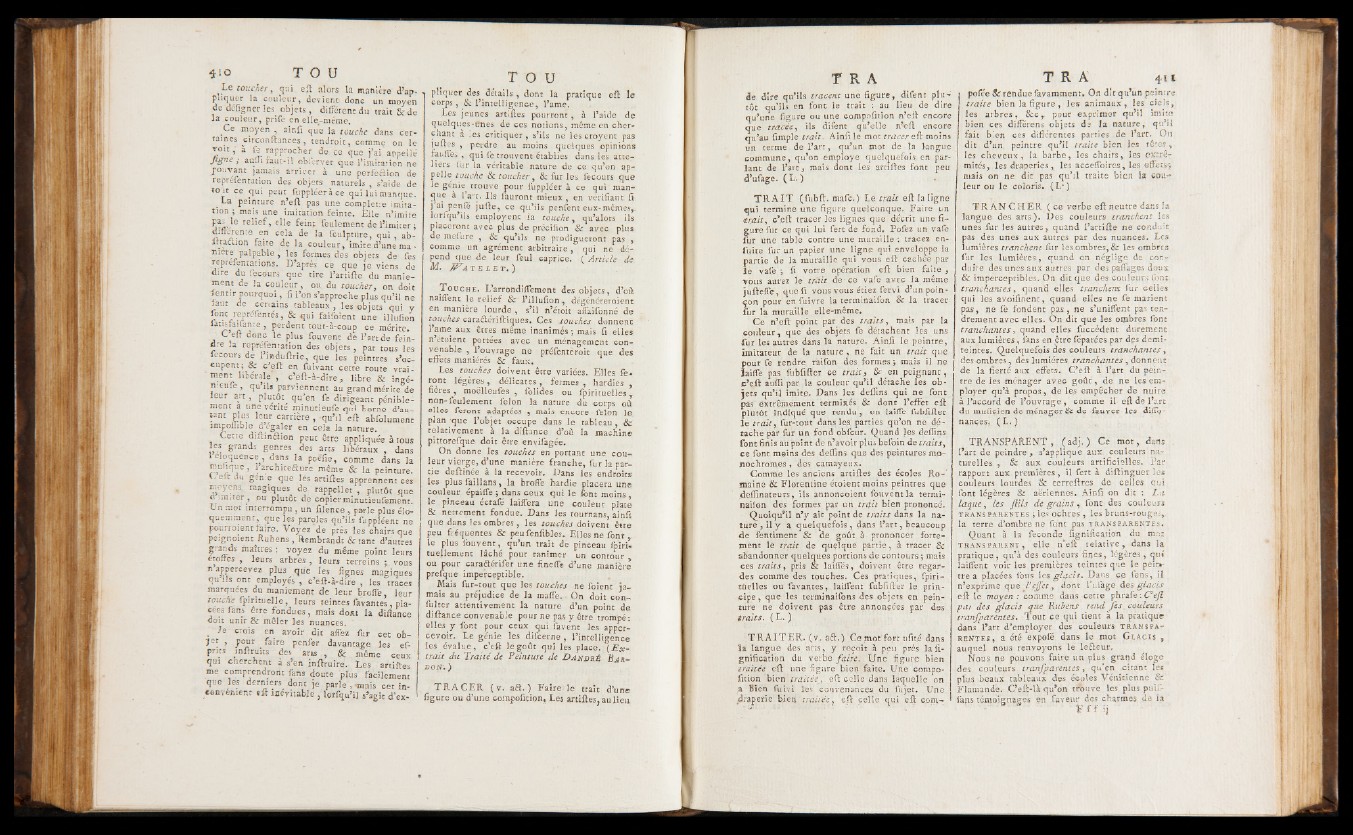
Le toucher, qui. eft alors la manière d’appliquer
la couleur, devient donc un moyen
de defigner les objets , différent du trait & de
la .couleur, prife en elle-même.
Ce moyen , ainfi que la touche dans Certaines
circonftances, tendroit, comme on le
v o i t , a fe rapprocher de ce que j’ai appelle
JlS ne i aum faut-il oblerver que l ’ imitation ne
pouvant jamais arriver à une perfection de
reprefentation des objets naturels , s’aide de to it ce qui peut fuppléer à ce qui lui manque.
La peinture n’eft pas une complexe imitation
; mais une imitation feinte. Elle n’ imite
!wr-^e re^e^’ e^e feulement de l’imiter ;
différente en cela de la fculptiire, qui , ab-
itraélion faite de la couleur, imite d’une ma •
tuere palpable, les formes des objets de fes
repréfentations. D’après ce que je viens de
dire du fecours que tire l ’artifte du maniement
de la couleur, ou du toucher, on doit
ientir pourquoi, fi l ’on s’approche plus qu’ il ne j
faut de certains tableaux , les objets qui y
font repréfentés, & qui faifoient une illufion
latisfaifante, perdent tout-à-coup ce mérite.
C eit donc le plus fouvent de l’ art de feindre
la reprefentation des objets , par tous les
lecours de liwduftrie, que les peintres s’occupent;
& c’eft en fuivant cette route vraiment
libérale , c’eft-à-dire , libre & ingé-
nieufe , qu’ils parviennent au grand mérite de
leur a r t , plutôt qu’ en fe dirigeant péniblement
a une vérité minutieufe qui borne d’au-
tant plus leur carrière , -qu’ il eft abfolument
ampoiiible d égaler en cela la nature.
Cette diffinflion peut être appliquée à tous
les grands genres des arts libéraux , dans
1 éloquence , dans la poëfie,. comme dans la
muhque, 1 architeaure même & la peinture.
^ eit du gen:e que lés artiftes apprennent ces
moyens, magiques de rappeller , plutôt que
ci imiter , ou plutôt de copierminutieufement.
Un mot interrompu , un filer.ee , parle plus éloquemment,
que les paroles qu’ils fuppléent ne
pourraient faire. Voyez de près les chairs que
peignoient Rubens , Rembrandt & tant d’autres
grands maîtres : voyez du même point leurs
étoffes , leurs arbres, leurs terreins ;. vous
n appercevez plus que les lignes magiques
qu ils ont employés , c ’eft-à-dire , les traces
marquées du maniement de leur broffe, leur
touche fpirituelle, leurs teintes favantes, placées
fans être fondues, mais doist la diffance
doit unir & mêler les nuances.
. CT^ S en avoir dit affez fur cet obj
e t , pour faire penfer davantage les ef-
pnts inftruits des ans , & même ceux'
qui cherchent à s’en inftruirè. Les artiftes '
me comprendront fans doute plus facilement
que les derniers dont je parle , -mais cet inconvénient
eft inévitable , lorfqu’il s’agit d’ex- *
pîiquer des détails , dont la pratique eft le
corps, & l’intelligence, l’ame.
Les jeunes artiftes pourront , à l’aide de
quelques-ffnes de ces notions, même en cherchant
a ces critiquer, s’ ils ne les croyent pas
juftes , perdre au moins quelques opinions
ratifies , qui fe trouvent établies dans les atte-
lièrs fur la véritable nature de ce qu’on appelle
touche & toucher, & fur les fecours que
le genie trouve pour fuppléer à ce qui man-
çjue à l'art, Ils l’auront mieux , en vérifiant fi
j ai penfé jufte, ce qu’ ils penfent eux-mêmes,..
lorfqu’ ils eniployent ia touche, qu’alors ils
placeront avec plus de précilion & avec plus-
de melure , & qu’ ils ne prodigueront pas ,
comme un agrément arbitraire, qui ne dépend
que de leur feul caprice. ( Article de M. ZP'a t e l e t. )
^Touche. L’arrondiflement des objets, d’où
naiffent le relief & l’illufion , dégénéreroient
en manière lourde , s’ il n’étoit affaifonné de
-touches caraclériftiques. Ces touches donnent
l’ame aux êtres même inanimés ; mais fi elles
n’etoient portées avec un ménagement convenable
, l’ouvrage ne préfentèroit que des
effets maniérés & faux*
Les touches doivent être variées. Elles fe ront
légères, délicates, fermes , hardies ,
^erf s j moëlleufes , lolides ou Ipirituelles y
non-feulement félon la nature du corps où
elles feront adaptées , mais encore félon le
plan que l ’objet occupe dans le tableau, &
relativement à la diftance d’où la machine
pittorefque doit être envifagée.
On donne les touches en portant une couleur
vierge, d’une manière franche, fur la partie
deftinée à la recevoir. Dans les endroit»
les plus faillans, la broffe hardie placera une
couleur épaiffe ; dans ceux qui le font moins ,
le pinceau écrafé laiffera . une couleur plate
& nettement fondue. Dans les tournans, ainfi
que dans les ombres , les touches doivent être
peu fréquentes & peu fenfibles. Elles ne font v
le plus fouvent, qu’un trait de pinceau fpirii
tuellement lâché pour ranimer un contour
ou pour caraétérifer une fineffe d’une manière
prefque imperceptible.
Mais fur-tout que les touches ne foient jamais
au préjudice de la inaffe. On doit con-
fulter attentivement la nature d’ un point de
diftance convenable pour ne pas y être trompé:
elles y font pour ceux qui favent les apper-
cevoir. Le génie les difeerne , l’ intelligence
les évalue, c’ eft le goût qui les place. ( E x trait
du Traité de Teinture de D andrê Bar~
don. )
T R A C E R ( v . a£L) Faire>le trait d’une
figure ou d’une compofition. Les artiftes, au lieu
de dire qu’ ils tracent une figure, difent plutôt
qu’ils en font le trait : au lieu de dire
qu’ une figure ou une compofition n’eft encore
que tracée, ils difênt qu’elle n’‘eft encore
qu’au fimple trait. Ainfi le mot tracer eft moins
un terme de l’art, qu’ un mot de la longue
commune, qu’on employé quelquefois, en parlant
de l’ art, mais dont les artiftes font peu
d’ufage. ( L .) .
T R A I T (fubft. mafe.) Le trait eft la ligne
qui termine une figure quelconque. Faire un
trait c’ .eft tracer les lignes que. décrit une figure
fur ce qui lui fert de fond. Pofez un vafe
fur une table contre une muraille : tracez en-
fuite fur un papier une ligne qui enveloppe la
partie de la muraille qui vous eft cachee par
îe vafe ; fi votre opération eft bien faite ,
vous aurez le trait de-ce vafe avec la même
juftefle, que fi vous vous étiez fervi d’ un poinçon
pour en fuivre la terminaifon & la tracer
fur la muraille elle-même.
Ce n’eft point par des traits, mais par la j
^couleur, que des objets fe détachent les uns j
fur les autrés dans la nature. Ainfi le peintre,
imitateur de la nature , ne fait un trait que
pour fe rendre raifon des formes ; mais il ne 1
laiffe pas fubfifter ce trait, & en peignant,
c ’eft aufli par la couleur qu’il détache les objets
qu’ il imite/ Dans les deffins qui ne font
pas éxtrênjement terminés & dont l’effet eft
plutôt indiqué que rendu, on laiffe fubfifter
le trait, fur-tout dans les parties qu’on ne détache
par fur un fond obfcur. Quand Jes deffins
font finis au point de n’avoir pliisbefoin de traits,
ce font moins des deffins qu.e des peintures monochromes
, des camayeux.
Comme les anciens artiftes des écoles Ro-'
«laine & Florentine étpient moins peintres que
deflinateurs, ils annoncoient fouvent la terminaifon
des formes par un trait bien prononcé.
Quoiqu’ il n’y ait point de traits dans la natu
re , il y a quelquefois, dans l’art, beaucoup
dé fentiment & de goût à prononcer fortement
le trait de quelque partie, à tracer &
abandonner quelques portions de contours ; mais
ces traits, pris êc laiffés, doivent être regardes
comme des touches. Ces pratiques, fpiri-
îüelles ou favantes, laiffent fubfifter le princ
ip e , que les terminaifons des objets en peinture
ne doivent pas être annoncées par des
traits. ( L. )
T R A I T E R , (v . aft.) Ce mot'fort tifité dans
la langue des arts, y reçoit à peu près la lignification
du verbe faire. Une figure bien
traitée eft une figure bien faite. Une compofition
bien traitée, eft celle dans laquelle on
a Bien fuivi les convenances, du fujet. Une
draperie bien traitée, eft pelle qui eft corn-.
pofée & rendue favamment. On dit qu’un peintre
traite bien la figure , les animaux, les ciels,
les arbres, & c r pour exprimer qu’ il imite
bien ces différens objets de la nature, qu’ il
fait bien ces différentes parties de l’art. On
dit d’un peintre qu’ il traite bien les têtes,
les chev eux , la barbe, les chairs, les extrémités,
les draperies, les acceffojres, les effets*;
mais on ne dit pas qu’ il traite bien la coupleur
ou le coloris. (L ‘ )
T R A N C H E R ( ce verbe eft neutre dans la
langue des arts). Des couleurs tranchent les
unes fur les autres, quand l’artifte ne conduit
pas des unes aux autres par des nuances. Les
lumières tranchent fur les ombres, & les ombres
fur les lumières, quand on néglige de conduire
des unes aux autres par des paffages doux
& imperceptibles.-On dit que des couleurs font
‘ tranchantes, quand elles tranchent fur celles
qui les avoifinent, quand elles ne fe marient
pas, ne fe fondent pas, ne s’ unifient pas tendrement
avec elles. Oh dit que les ombres font
tranchantes, quand elles fuccèdent durement
aux lumières, fans en être féparées par dgs demir
teintes. Quelquefois des couleurs tranchantes,
des ombres, des lumières tranchantes, donnent
de la fierté aux effets. C’eft à l’art du peintre
de les ménager avec g o û t, de ne les employer
qu’à propos, de le.s empêcher de nuire
à l ’accord de l’ouvrage , comme il eft de l’art
du mufiçien de ménager & de f^uyer les difiq-
nançes, ( L, )
TR AN SPA R EN T , ( a d j.) Ce mot, dans .
l’art de peindre, s’applique aux couleurs nar
turelles , & aux couleurs artificielles. Par
rapport aux premières, il fert à diftinguer les
couleurs lourdes & terreftres de celles qui
font légères & aeriennes. Ainfi on dit : Lu
laque, les fiils de grains , font des couleurs
transparentes ; les ochres , les bruns-rouge.?,,
la terre d’ombre ne font pas transparentes.
Quant à la fécondé lignification du mot
transparent, elle n’ eft re lativ e , dans la
pratique, qu’ à des couleurs fines, légères , qui
laiffent voir les premières teintes que le peintre
a placées fous les glacit. Dans ç.e fens, il
n’exprime que T effet, dont Lutage des glacis
eft le moyen ; comme dans cette phrafe : C3ejl
pat des glacis que Rubens rend Jès, couleurs
tranfparentes. Tout ce qui tient à la pratique
dans l’art d’employer des couleurs transparentes,
a été expofé dans le mot Glacis 3
auquel nous renvoyons le leéleur.
Nous ne pouvons faire un plus grand éloge
des couleurs tranfparentes, qu’en citant les
plus beaux tableaux des écoles Vénitienne 8c
Flamande. ,C’eft-là qu’on trouve les plus puifi-
laps témoignages en faveur des charmes de la
F i l ij