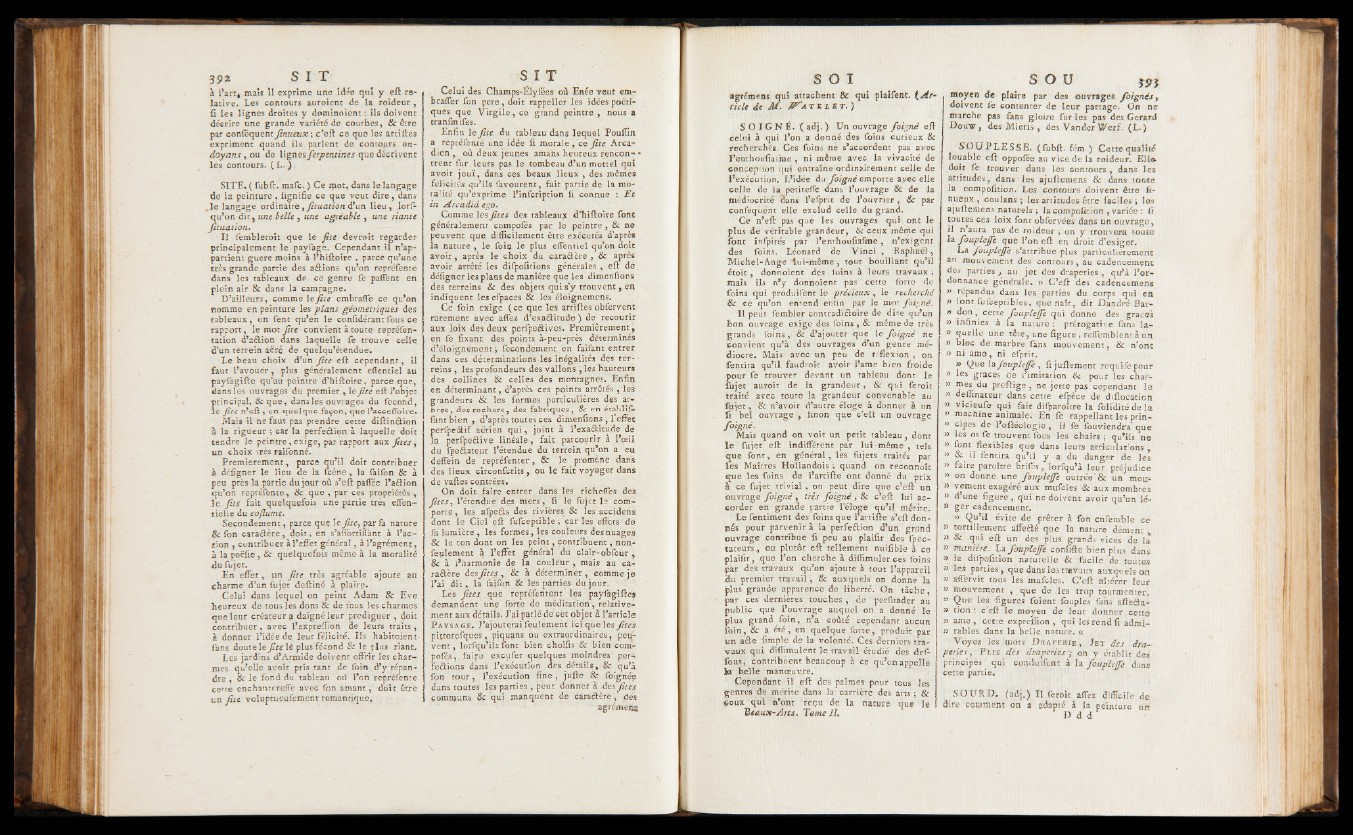
à l’art:* maïs il exprime une idée qui y eft relative.
Les contours auroient de la roideur,
fi les lignes droites y dominoient : ils doivent
décrire une grande variété de courbes, & être
par conféquent finueux ; c ’eft ce que les arciftes
expriment quand ils parlent de contours on-
doyans , ou de lignesJzrpentincs que décrivent
les contours. ( L . )
SITE. ( fubft. mafe. ) Ce mot, dans le langage
de la peinture , lignifie ce que veut d ire, dans
.le langage ordinaire ,fituation 4*un lieu , lorf-
qu’on d it, une belle , une agréable , une riante
fituation.
I l fembleroit que le fite devroit regarder
principalement le payfage. Cependant il n’appartient
guere moins à l’hiftoire , parce qu’une
très grande partie des aérions qu’on repréfente
dans les tableaux de ce genre fe paffent en
plein air & dans la campagne.
D’ailleurs, comme \efite embrafle ce qu’on
nomme en peinture les plans géométriques des
tableaux, on fent qu’en le confidérantfous ce
rapport, le mot fite convient à toute repréfen-
tation d’ sérion dans laquelle fe trouve celle
d’un terrein aëré de quelqu’étendue.
Le beau choix d’un fite ell: cependant, il
faut l’ avouer, plus généralement eflentiel au
payfagifte qu’au peintre d’hiftoire, parce que,
dans les ouvrages du premier , le fite eft l’objet
principal, & q ue, dans les ouvrages du fécond,
le fite n’ eft , en quelque façon, que l’acceffoire.
Mais il ne faut pas prendre cette diftinérion
à la rigueur -, car la perfeérion à laquelle doit
tendre le peintre, exige, par rapport aux f ite s ,
un choix très raifonné.
Premièrement, parce qu’il doit contribuer
à défigner le lieu de la fcène, la faifbn & à
peu près la partie du jour où s’ eft paflfée l’aélion
qu’on repréfënte, & que , par ces propriétés-,
le fite fait quelquefois une partie très effen-
tielle du çoftume.
Secondement, parce quç le fite, par fa nature
& fon caracière, doit, en. s’afiorti fiant à l’action
, contribuer à l’effet général, à l’agrément,
à la poëfie, & quelquefois même à la moralité
du fujet.
En effet, un fite très agréable ajoute au
charme d’un fujet deftiné à plaire.
Celui dans lequel on peint Adam & Eve
heureux de tous les dons & de tous les charmes
que leur créateur a daigné leur prodiguer , doit
contribuer, avec Pexprefiion de leurs traits,
à donner l’ idée de leur félicité. Us habitoient
fans doute le fite lê plus fécond & le plus riant.
Les jardins d’Armide doivent offrir les charmes
qu’elle avoit pris tant de foin d’ y répandre
, & le fond du tableau où l’on repréfente
certe enchanterefle avec fon amant, doit être
un fite voluptueufement romantique.
Celui des Champs-Êlyfées où Enée veut em-
brafler fon pere, doit rappeller les idées poétiques
que V i r g ile , ce grand peintre , nous a
tranfmifes.
Enfin le fite du tableau dans lequel Pouflin
a repréferwé une idée fi morale , ce fite Arca-
dien , où deux jeunes amans heureux rencon- ■
trent fur leurs pas le tombeau d’ un mortel qui
avoit jou i, dans ces beaux lieux , des mêmes
félicités qu’ ils favourent, fait partie de la moralité
qu’exprime l’ infcription fi connue : E t
in Arcadiâ ego-
Comme les fites des tableaux d^hiftoire font
généralement compofés par le peintre , & ne
peuvent que difficilement être exécutés d’après
la nature , le foin le plus eflentiel qu’on doit
avoir, après le choix du caraétère , & après
avoir arrêté les difpofitions générales , eft de
défigner les plans de manière que les dimenfions
des terreins & des objets qui s’y trouvent, en
indiquent les efpaces & les éloignemens.
Ce foin exige (ce que les artiftes obfervent
rarement avec affez d’exaélitude ) de recourir
aux loix des deux perfpeérives. Premièrement,
en fe fixant des points à-peu-près déterminés
d’éloignement *, fecondement en faifant entrer
dans ces déterminations .les inégalités des ter- •
reins , les profondeurs des vallons , les hauteurs
des collines & celles des montagnes. Enfin,
en déterminant, d’après ces points arrêtés , les
grandeurs 8c les formes particulières des arbres,
des rochers, des fabriques, & en établit
fant bien , d’après toutes ces dimenfions , l’effet
perfpe&if aërien q u i, joint à l’exaéritude de
la perfpeérive linéale, fait parcourir à l’oeil
du fpe&ateur l’étendue du terrein qu’on a eu
deffein de repréfenter, & le promène dans
des lieux circonfcrits , ou le fait voyager dans
de vaftes contrées.
On doit faire entrer dans les richefles des
fite s , l’étendue des mers, fi le fujet le comporte,
les afpeéls des rivières^ & les accidens
dont le Ciel eft fufceptible -, car les effets de
fa lumière , les formes, les couleurs des nuages
& le ton dont on les peint, contribuent, non-
feplement à l ’effet général du clair-obfcur ,
& à l’harmonie de la couleur , mais au ca-
raélère àes f i te s , & à déterminer, comme je
l’ai d i t , la faifon & les parties du jour.
Les fites que repréfentent les payfagiftes
demandent unç forte de méditation, relativement
aux détails. J’ai parlé de cet objet à i’article
Paysage. J’ajouterai feulement ic i que les fites
pittorefques, piquans ou extraordinaires, peuvent
, îorfqu’ ils font bien choifis & bien compofés,
faire exeufer quelques moindres per*
feâions dans l’exécution des détails, 8c qu’à
fon tou r , l’exécution fin e , jufte 8c foîgnée
dans toutes les parties , peut donner à des fites
çomnjuns & qui manquent de caraélère, dés
agrément
âgrémens qui attachent & qui plaifent. ( A r ticle
de M . P '* TE LE T.)
S O I G N É.. ( adj. ) Un ouvrage foigné eft
celui à qui l ’on a donné des foins curieux &
recherchés. Ces foins ne s’accordent pas avec
l’ enthoufiaime , ni même avec la vivacité de
conception qui entraîne ordinairement celle de
l’ exécution. L’ idée du foigné emporte avec elle
celle de la petitefle dans l’ouvrage 8c de la
médiocrité dans l’efprit de l’ouvrier j 8c par
conféquent elle exclud celle du grand.
Ce n’ eft pas que les ouvrages qui, ont le
plus de véritable grandeur, & ceux mêtùe qui
font infpirés par l’enthoufiafme, n’ exigent
des foins. Léonard de V in ci , Raphaël,
Michel-Ange lui-même, tout bouillant qu’ il
é to it, donnoient des foins à leurs travaux;
mais ils n’ y donnoient pas cette force de
foins qui produifent le précieux, le recherché
& ce qu’on entend enfin par le mot foigné.
Il peut fembler contradiéioire de dire qu’ un
bon ouvrage exige des foins , & même de très
grands foins ,• & d’ajouter que le foigné ne
convient qu’ à des ouvrages d’un genre médiocre.
Mais avec un peu de réflexion , on
fentira qu’ il faudroit avoir l’aine bien froide
pour fe trouver devant un tableau dont le
fujet auroit de la grandeur, & qui feroit
traité avec toute la grandeur convenable au
fu je t, 8c n’avoir d’autre éloge à donner à un
fi bel ouvrage * finon que c’eft un ouvrage
foigné- ' _ .
Mais quand on voit un petit tableau, dont
le fujet eft indifférent par lui-même , tels
que font, en général, les fujets traités par
les Maîtres Hollandois ; quand on reconnoîc
que les foins de l’ artifte ont donné du prix
à c e fujet trivial , on peut dire que c’eft un
ouvrage foigné , très foigné , & c’eft lui accorder
en grande partie l ’éloge qu’il mérite.
Le fentiment des foins que l’artifte s’eft donnés
pour parvenir à la perfeérion d’un grand
ouvrage contribue fi peu au plaifir des fpec-
tateurs., ou plutôt eft tellement nuifible a ce
plaifir, que l’ on cherche à diflimuler ces foins
par des travaux qu’on ajoute à tout l’appareil
Hu premier trav a il, & auxquels on donne la
plus grande apparence de liberté. On tâ ch e ,
par ces dernières touches , de perfuader au
public que l’ouvrage auquel on a donné le
plus grand foin, n’a coûté cependant aucun
loin, & à été, en quelque forte, produit par
un aéle fimple de la volonté. Ces derniers travaux
qui diflimulent le travail étudié des def-
fous, contribuent beaucoup à ce qu’on appelle
ka belle manoeuvre.
Cependant il eft des palmes pour tous les
genres de mérite dans la carrière des arts •, &
ceux qui n’ont reçu de la nature que le
Veaux-Ares. Tome II,
moyen de plaire par des ouvrages foignés9
I doivent fe contenter de leur partage. On ne
marche pas fans gloire fur les pas des Gérard
D o uw , des Mieris , des Vander Werf. (L. )
S O U P L E S S E , (fubft. fétn ) Cette qualité
louable eft oppofée au vice de la roideur. Elis-
doit fe trouver dans les contours , dans les
attitudes, dans'les ajuftemens & dans toute
la eompofition. Les contours doivent être fi-
nueux , coulans ; les attitudes être faciles -, les
ajuftemens naturels *, la eompofition , variée : fi
toutes ces loix font obfervées dans un ouvrage,
il n aura pas de roideur ; on y trouvera toute
la foupleffc que l’on eft en droit d’exiger.
La fouplejfe s’attribue plus particuliérement
au mouvement des contours, au cadencement
des parties, au jet des draperies, qu’ à l’ordonnance
générale. » C’eft des cadencemens
» répandus dans les parties du corps qui en
» font fufceptibles, que naît, dit Dandré Bar-
» don, cette fouplejfe qui donne des grâces
» infinies à la nature : prérogative fans l.a-
» quelle une tête, une figure, reffembient à un
» bloc de marbre fans mouvement, 8c n’ont
! » ni ame, ni efprir.
» Que la fouplejfe , fijuftement requifepour
» les grâces de l’imitation 8c pour les char-
» mes du preftige , ne jette pas cependant le
» deflinateur dans cette efpèce de diflocation
» vicieufe qui fait difparoître la foliclité de la
» machine animale. En fe rappellant les prin-
» cipes de l’oftéologie , il fe fou viendra que
» les os fe trouvent fous les chairs; qu’ ils ne
» font flexibles que dans leurs articulations ,
» & il fentira qu’ il y a du danger de les
» faire paroître brifés, lorfqu’ à leur préjudice
» on donne unq fouplejfe outrée'& un moir-
» ventent exagéré aux mufcles & aux membres
» d’une figure , qui ne doivent avoir qu’un lé-
» ger cadencement.
» Qu’ il évite de prêter à fon enfentble ce
» tortillement affeété que la nature dément ,
» 8c qui eft un des plus grands vices de la
» manière. La fouplejfe confifte bien plus dans
» la difpofition naturelle & facile de toutes
» les parties , que dans les travaux auxquels on
» affervit tous les mufcles. C’eft altérer leur
» mouvement , que de .les trop tourmenter.
» Que les figures foient fouples fans affeéla-
» tion : c ’eft le moyen de leur donner cette
» ame , cetce expreflion , qui les rend fi admi-
» râbles dans la belle nature. «
Voyez les mots Draperie, Jet des draperies
, Plis des draperies ; on y établit des
principes qui conduifent à la fouplejfe dans
cette partie,
S O U R D , (adj.) I l feroit affez difficile de
dire caraiïient on a adapté à la peinture un
D d d