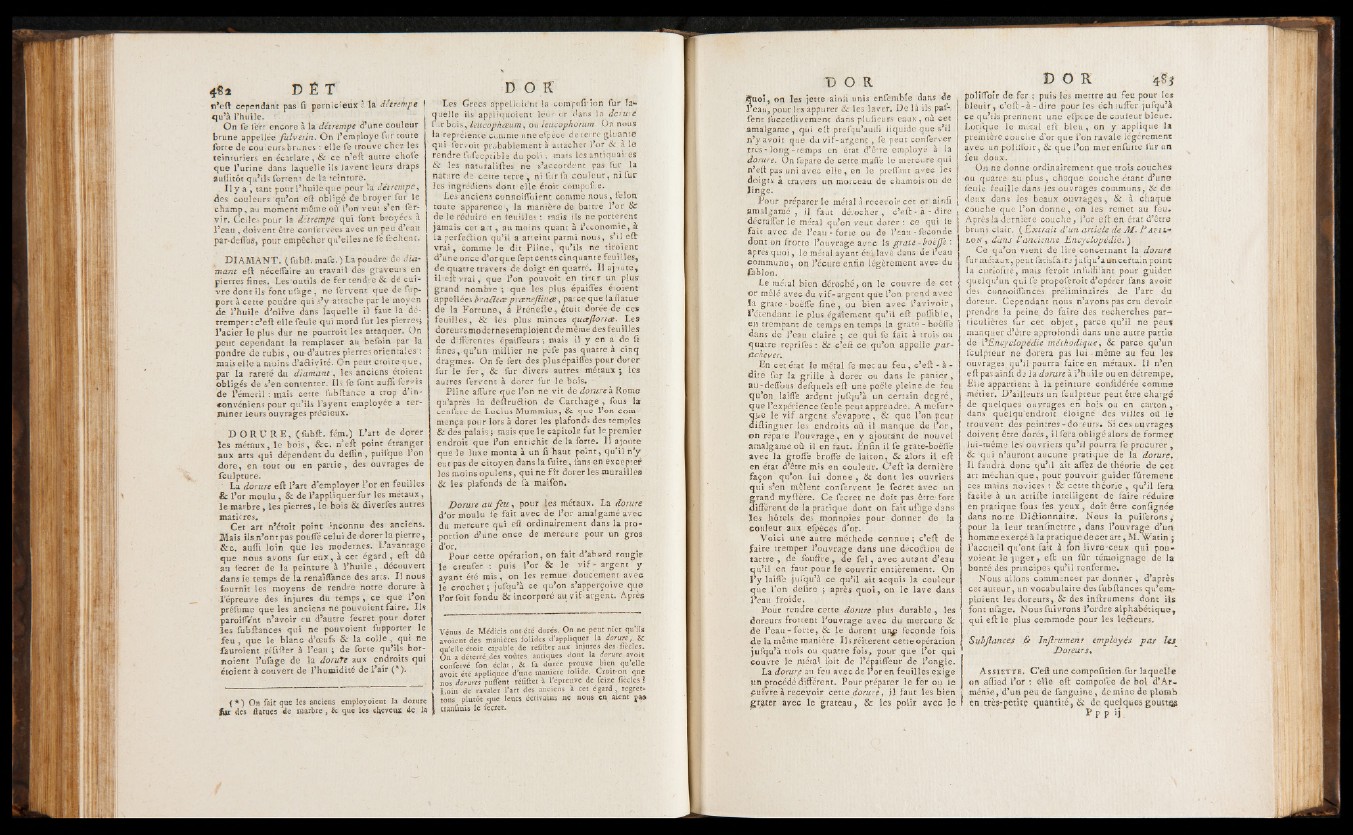
ti’ eft cependant pas fi pernicieux à la détrempe j
qu’à l’huile. '
On fe ierr encore à la détrempe d’ une couleur
brune appellée fulverin. On l’ employe fur toute
forte de couleurs brunes : elle fe trouve chez les
teinturiers en écarlate, & ce n’eft autre chofe
que l’ urine dans laquelle ils lavent leurs draps
auflitôt qu’ ils forcent de la teinture.
. Il y a , tant pour l’huile que pour Ta détrempe,
des couleurs qu’on eft obligé de broyer fur le
champ, au moment même où l’ on veut s’en fer-
vir. Celles pour la détrempe qui font broyees a
l ’eau , doivent être coniéryées avec un peu d’eau
par-deffus, pour empêcher qu’elles ne fe iechent.
DIAM ANT. ( fubft. mafc. ) La poudre de diamant
eft néceffaire au travail des graveurs en
pierres fines. Les'outils de fer tendre & dé cuivre
dont ils font ulage , ne fervent que de rapport
à cette poudre qui s’y attache par le moyen
de l’huile d’olive dans laquelle il faut la détremper
: c’eft elle feule qui mord lur les pierres»
l ’acier le plus dur ne pourroit les attaquer, ün
peut cependant la remplacer au befoin par la
pondre de rubis , ou-d’autres pierres orientales :
mais elle a moins d’aâivité. On peut croire cjuè,
par la rareté du diamant, les anciens etoient
obligés de s’en contenter. Ils fe font aufïi fervis
de l ’émeril : mais cette fubftance a trop d’ in-
«onvéniens pour qu’ils l’ayent employée a terminer
leurs ouvrages précieux.
D O R U R E , (fubft. fém.) L’art de dorer
les métaux, le bois, & c . n’eft point étranger
aux arts qui dépendent du deflin , puil’que 1 on
dore, en tout ou en partie, des ouvrages de
iculpture. . -
La dorure eft l ’art d’employer l’or en feuilles
& l’or moulu , & de l’appliquer fur les métaux,
le marbre, les pierres, le bois & diverfes autres
matières. . v /
Cet art n’étoît point inconnu des anciens.
Mais ils n’ont pas pouffé celui de dorer la pierre,
& c . auili loin que les modernes. L’avantage
que nous avons fur eu x , à cet égard , eft dû
au fecret de la peinture à l’huile ;. découvert
dans le temps de la renaïffance des arts. Il nous
fournit les moyens de rendre notre dorure a
l ’épreuve des injures du temps, ce que l’on
prélume que les anciens ne pouvoienf faire. Us
paroiffVnt n’avoir eu d’autre fecret pour dorer
le s fubftances qui ne pouvoienf fupporter le
feu , que le blanc d’oeufs & la c o lle , qui ne
fauroient réfifter à l’eau ; de forte qu’ ils .bor-
noient l’ ufage de la doriéfe aux endroits qui
étoient à couvert de l ’humidité de l’air (*).
( * ) On fait que les anciens employoient la dorure
fxxr des liâmes de marbre, U que les cheveux de la
Les Grecs a’ppelkJént la compofrion fur la»-
quelle ils appliquaient leur or dans la dciwe
fur bois, l'eücopheeum, ou ieùcophorum. On nous
la représente comme une elpèce deterre gluante
qui iérvoit probablement à attacher l’or & à le
rendre fufccpcible du poli : mais les antiquaires
& les naturaliftes ne s’accordent pas fur la
nature de cette terre , ni fur fa couleur, ni fur
les ingrédient dont elle étoit ebinpofce.
Les anciens connoiffoient comme nous, félon
toute apparence , la manière de battre 1 or &
de le réduire en feuilles : mais ils ne portèrent
jamais cet a r t , au moins quant à i’economie, à
la perfeéiion qu’il a atteint parmi nous, s‘ ’il eft
v ra i, comme le dit Pline, qu’ ils ne tiroient
d’ une once d’orque fept cents cinquante feuilles,
de quatre travers de doigt en quarré. Il ajoute^
il eft v ra i, que l’ on pouvoir en tirer un plus1
grand nombre ; que les plus épaiffes étoient
appelées bracleoe praeneftinee, parce que laftatue
de la Fortune, à Prénefte, étoit dorée de ces
feuilles, & les plus minces qucejlonæ. Les
doreurs modernes emploient de même des feuilles
de différentes épaiffeurs mais il y en a de ft
fines, qu’ un millier ne pèfe pas quatre à cinq
dragmes. On fe fert des plus épaiffes pour dorer
fur le fer , & fur divers autres métaux ; les
autres fervent à dorer fur le bcis.
Pline affure que l’on ne vit de dorure à Rome
qu’après la deftruâion de Carthage , fous la
cenfure de Lucius Mummius, & que l’on commença
pour lors à dorer les plafonds des temples
& des palais ; mais que le capitole fut le premier
endroit que l’on enrichit de la forte. Il ajoute
que le luxe monta à un fi haut point, qu’il n’y
eut pas de citoyen dans la fuite, fans en excepter
les moins opulens, qui ne f ît dorer les murailles
& les plafonds de fa maifon.'
Dorure au f e u , pour les métaux. La dorure
d’or moulu fe fait avec de l’or amalgamé avec
du mercure qui eft ordinairement dans la proportion
d?une once de mercure pour un gros
d’or. '
Pour cette opération, on fait d’abord rougir
le creufet : puis l’or & le v if - argent y
ayant été mis, on les remue doucement avec
le crochet; jufqu’à ce qu’on s’apperçoive que
l’orfoit fondu & incorporé au vif-argent. Après
Vénus de Médicis ont-été dorés. On ne peut nier qu’ils
avoient des manières folides d’appliquer la d orure&c
„„•clic étoit capable; de réfifter aux injures des-ficelé..
On a déterré _des voûtes antiques dont la dorure avoit
confervé fon é clat, Je, fa durée prouve bien qu’elle
avoir été appliquée d’une manière folide. Groit-on que
nos dorures pufent réfifter à l’épreuve de ieize fièdes î
ILo in de ravaler l’art des anciens à cet égard, regret-
tons plutôt que leurs écrivains ne nous en aient g a»
tianfmis le fecret.
quoi, on les jette ainfi unis enfemble dans de
l ’ eau, pour les appurer & les laver. De là ils pal-,
fent lucceflivenient dans plu Leurs eaux, où cet
amalgame, qui eft préfqu’aulïi liquide que s’ il
n’y avoit que du v if-a rg en t, fe peut conferver
très - long - temps en état d’être employé à la
dorure, ün fépare de cette malle le mercure qui
n’eft pas uni avec e lle , en le preffant avec les
doigts à travers un morceau de chamois ou de ■
linge.
Pour préparer le métal à recevoir cet or airifi
amalgamé , il faut dérocher , c’eft - à - dire .
décraffer le métal qu’on veut dorer: ce qui le J
fait avec de l’eau - forte ou de l’ eau-fécondé
dont on frotte l’ouvrage avec la grave -boéjfe :
après quoi, le métal ayant été lavé dans de l’ eau
commune, on l’écure enfin légèrement avec du
gabion.
Le métal bien déroché, on le couvre de cet
or mêlé avec du vif-argent que l’on prend avec
ia grâce-boëffe finé , ou bien avec l’ avivoir ,
S’étendant le plus également qu’ il eft pofïibie,
en trempant de temps en temps la grâce - boëffe
dans de l’ eau claire ; ce qui fe fait à trois ou
quatre reprifes : & c’eft ce qu’on appelle parachever.
.En cet état le métal fe met au fe u , c’eft - à -
dire fur la grille à dorer ou dans le panier ,
au-deflous defquels eft une poêle pleine de feu
qu’on laiffe ardent jufqu’à un certain degré,
que l’expérience feule peut apprendre. A mefur?
que fe v if argent s’évapore, & que l’on peut
diftinguer les endroits où il manque de l’o r ,
on répare l’ouvrage, en y ajoutant de nouvel
amalgame où il en faut. Enfin il 1e grate-boëffe
avec la grofle broffe de laiton, &: alors il eft
en état d’ être mis en couleur. C’eft la dernière
façon qu’on lui donne , & dont les ouvriers
qui s’en mêlent confervent le fecret avec un
grand myftère. Ce fecret ne doit pas être- fort
différent de la pratique dont on fait ufage dans
les hôtels des monnoies pour donner de la
couleur aux efpèçes d*or.
Voici une autre méthode connue ; c’ eft de
faire tremper l’ouvrage dans une décoétion de
tartre , de fouffre, de f e l , avec autant d’eau
qu’ il en faut pour le couvrir entièrement. On
l ’y laiffç jufqu’à ce qu’ il ait acquis la couleur
que l ’on délire ; après quoi , on le lave dans
l ’eau froide.
Pour rendre cette dorure plus durable , les
doreurs frotceoc l’ouvrage avec du merçure &
de l’eau - forte, & le dorent une fécondé fois
de la même manière. Us Réitèrent cette opération
jufqu’à trois ou quatre fois, pour que l’or qui
couvre le n^écal fpit de l’épaifleur de l’ongle.
La dorurp an feu avec de l’ or en feuilles exige
un procédé différent. Pour préparer le fer ou le
pu ivre à recevoir c.ett e dorure-, jl faut lesbien
gr^tejr avec le grateau, & les polir avcç le
polîffoîr de fer ; puis les mettre au feu pour le*
bleuir, c’e f t -à - dire pour les échauffer jufqu’à
ce qu’ ils prennent une elpcce de couleur bleue.
Lorfque le métal eft b leu , on y applique la
première couche d’or que l’on ravale légèrement
avec un polilfoir, & que l’on met enfuite fur un
feu doux.
On ne donne ordinairement que trois couches
ou quatre au plus , chaque couche étant d’une
feule feuille dans les ouvrages communs, ik. de
deux dans les beaux ouvrages, & à chaque
couche que l’on donne, on les remet au feu.
Après-ia dernière couche, l’or eft en.état d’être
bruni clair. ( Extrait d’un article de M . P avu,-
lon , dans V ancienne Encyclopédie.')
Ce qu’on vient de lire concernant la dorure
fur métaux, peut facisfaire jufqu’ a un certain point
la cunofué, mais fieroit infuftifant pour guider
quelqu’ un qui fe propoferoit d’opérer fans avoir
des connoiflances. préliminaires de l’ arc du
doreur. Cependant nous n’avons pas cru devoir
prendre la peine de faire des recherches particulières
fur cet ob jet, parce qu’il ne peu*
manquer d’ être approfondi dans une autre partie
de Ÿ Encyclopédie méthodique, & parce qu’ un
fculpteur ne dorera pas lui-même au feu les
ouvrages qu’il pourra faire en métaux. Il n’en
eft pas ainfi de la dorure à l’huile ou en détrempe.
Elle appartient à la peinture confidérée comme
métier. D’ailleurs un fculpteur peut être chargé
de quelques ouvrages en bois ou en carton,
dans quelqu’endroic éloigné des villes où fe
trouvent des peintres-doreurs. Si ces ou vrage^
doivent être dorés, il fera obligé alors de former
lui-même lès ouvriers qu’ il pourra fe procurer,
& qui n’auront aucune pratique de la dorure,
Ii faudrà donc qu’ il ait affez de théorie de cet
art méchanique, pour pouvoir guider fûremenc
ces mains novices : &r cette théorie , qu’ il fera
facile à un artifte intelligent de faire réduire
en pratique fous les y eu x , doit être confignée
dans notre Diélionnaire. Nous la puiferons,
pour la leur tranftnettre, dans l’ouvrage d’un
homme exerçé à la pratique de cet art, M. Wàtin :
l’accueil qu’ont fait à Ion livre-eeux qui pou-
yoient le -juger, eft un fûr témoignage de la
bonté des principes qu’ il renferme.
Nous allons commencer par donner , d’après
cet auteur, un vocabulaire des fubftances qu’em?
ploient les doreurs, 8c des inftrumens dont iis
font ufage. Nous fuivrons l’ordre alphabétique,
i qui eft le plus commode pour les le&eurs.
Svbjïancep & Jnjlrumenr employés par les
• D oreurs•
A ssiette. C’eft une compofitîon.fur laquelle
on allied l’or : elle eft compofée de bol d’Arménie,
d’un peu de fanguine, demine de plomb
çn tpès-petitç quantité, & de quelques gouttss