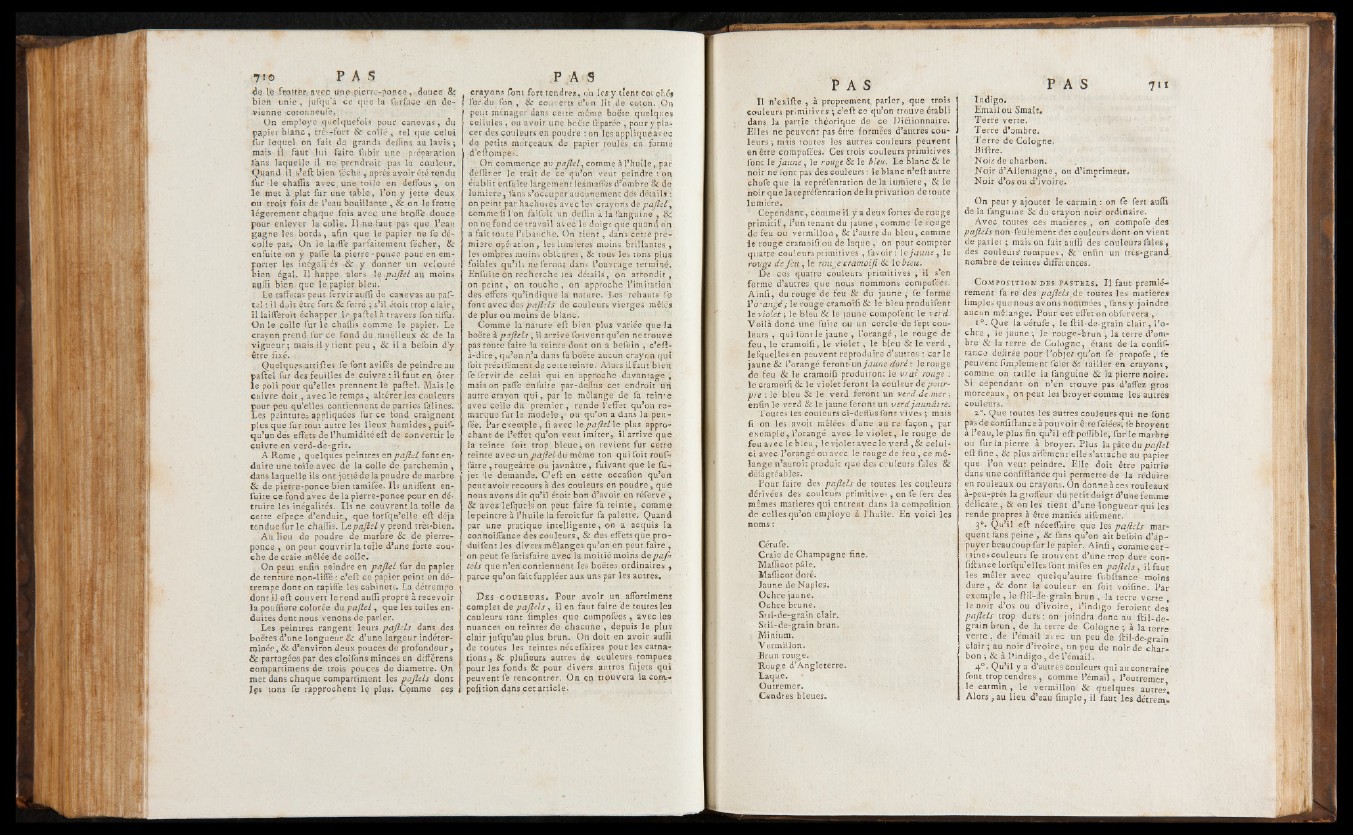
Re ljç ft;oHer; .avp.c unp- piefrçrponea, . douce &
bien unie, jufcju’à cc qiié la fur face cën Revienne
cotonneufe,;
On employé quelquefois pour canevas, du
papier blanc , trcWfort & collé , tel que celui
fur lequel on fait de grands deflins au lavis ;
mais il faut lui faire liibir une-préparation
i’ans laquelle il ne/prendroit pas la couleur.
Quand il s?eft bien léché , après avoir été tendu
fur le chaflis avec , une toile en deffous , on
le- tnec a ..plat fur une table:, l ’on y jette deux
ou trois fois de l’eau bouillante , & on le frotte
îégerenien-t chaque fois avec une brofle douce
pour enlever la colle. Il-ne-laut pas que l’eau
gagne les bords, afin que le papier ne fq décolle
pas. On le la.fl’e parfaitement féçher, &
en fuite on y pafle la pierre-ponce pour en emporter
les inégalités & y donner un velouté
bien égal. Il happe alors 1 e pajlel au moins
aufli bien que le papier bleu,1
Le taffetas peut fervir aufli de canevas au pastel
: il doit çtre fort & ferré ; s’ il étoic trop clair,
il laifleroit échapper l>\pafte,l à travers fon tiflu.
On le colle fur le chaflis comme le papier. Le
crayon prend fur cè fond du moelleux & de la
vigueur ; mais il y tient peu, & il a befoin d’y
être fixé. v~
Quelques.avtiftes fe font avifés de peindre au
p a fiel fur des feuilles de cuivre : il faut en ôter
le poli pour qii’ elles prennent le paftel. Mais le
çuivre doit.,- avec le temps ; altérer les-couleurs
pour peu qu’ellçs contiennent de parties falines.
Les peinture* appliquées fur ce fond craignent
plus que fur tout autre les lieux humides, puif-
qu’un des effets de l’humidité eft de convertir le
çuivre en verd-de-gris.
A Rome, quelques peintres en pajlel font enduire
une toile avec de la colle de parchemin ,
dans laquelle ils ont jetté de la poudre de marbre
& de pierre-ponce bien tamifèe. Il> unifient en-
fuite ce fond avec de la pierre-ponce pour en détruire
lès inégalités. Ils ne couvrent la toile de
cette efpece d’ enduit, que lorfqta’elle efl: déjà
tendue fur le chaflis. Lepajlel y prend très-bien.
Au lieu dg poudre de marbre & de pierre-
ponce , on peut couvrir la toile d’ yne forte couche
de craie mêlée de .colle.
On peut enfin peindre en pajlel fur du papier
de tenture non-lifle : c’eft ce papier peint en détrempe
dont on tapifie les cabinets. La détrempe
dont il efl couvert le rend aufli propre à recevoir
la pouffiere colorée du p a jle l, que les toiles enduites
dont nous venons de parler.
Les peintres rangent leurs pajlels dans des
boëtes d’ une longueur 8c d’une largeur indéterminée,
& d’environ deux pouces de profondeur ,
Sç partagées par des cloifons minces en différens
compartimens de trois pouces de diamètre. On
met dans chaque compartiment les pajlcls donc
s tons fp rapprochent le plus. Comme ce?
. crayons font fort tendres, on les y tient coi chéf
f fur du fon , & couverts .d’un lit de coton. . On
peut inénager dans ceitè même boëte quelques
cellules , ou avoir une bcëte féparée , pour y placer
des couleurs en popdre : on les applique av ec
de petits mo'rçeaux de papier roulés en formé
d’eftompes.
On çommençe au p ajlel, comme à l’huile, par
deffir.er lé. trait de cè qu’on veut peindre : on
établit enfuite largement lesmaltes d’ombre 8c de
lumière, fans s’occuper aucunement des détails :
on peint par hachures avec les crayons de pajlel,
comme fi l'on failoic'un deflin à la fanghine , 8c
on ne.fond ce travail avec le doigt que quand on
a fait toute l’ébàuche. On t ien t, dans cette première
opération , les lumières moins brillantes ,
les ombres moins oblcùrès, & tous les tons plus
foihles qu’ ih noieront dans l’ouvrage terminé.
Enfuite on recherche les détails, on arrondit,
on peint, on touche , on approche l’ imitation
des effets qu’ indique la nature. Les rehauts fe
font avec des pajlels de couleurs vierges mêlés
de plus ou moins de blanc.
Comme la nature efl brëri plus variée que la
boëte à pajlels, il arrive fouvent qu’on ne trouve
pas toute faite la teinte dont on à befoin , c’eft-
à-dire, qu’ on n’a dans fa bo*ëte aucun crayon qui
loit précilement de cette teinte. Alors il faut bien
fe fervir de cèlui qui en approche davantage,
mais on pafle enfuite par-deflus cet endroit un
autre crayon qui,, par le mélange de fa teinte
avec celle du premier , rende l’effet qu’on remarque
fur le modèle ou qu’ on a dans la pen-
fée. Par exemple, fi avec le pajlel\e plus appro**
chant de l’effet qu’on veut imiter, il arrive que
’ la teinte foie trop bleue, on revient fur cette
teinte avec' unpajlel àu. même ton qui foit rouf-;
fâtre , rougeâtre ou jaunâtre, fuivant que le fu-r
jec 'le demande. C’ eft en cette occafion qu’on
peut avoir recours à des couleurs en poudre, que
nous avons dit qu’ il étoic bon d’avoir en réferve ,
& âves lefqucls on peut faire fa teinte, comme
le peintre à l’huilé la feroitfur fa palette. Quand
par une pratique intelligente, on a acquis la
connoiflance des couleurs, & des effets que. pro-
■ duifent les divers mélangés qu’on en peut faire ,
on peut fe fatisfaire avec la moitié moins de paf->
tels que n’ en contiennent îes boëtes ordinaires ,
parce qu’on fait fuppléer aux uns par les autres.
Des couleurs. Pour avoir un aflortiment
complet de pajlels , il en faut faire de toucesles
couleurs tant fimples que compofées, avec les
nuances ou teintes de chacune , depuis le plus
clair jufqu’au plus, brun. On doit en avoir aufli
de toutes les teintes néceflaires pour les carnations,
& plufieurs autres de couleurs rompues
pour les fonds & pour divers autres fujets qui
peuvent fe rencontrer. On eq tiouvera la com.-
poficion dans cet article.
P A S P A S
Il n’exifte , à proprement, parler, que trois
couleurs primitives ; c’eft ce qu’on trouve établi
dans la partie théorique de ce l)i&ipnnaire.
Elles ne peuvent pas être formées d’autres couleurs
; mais toutes les autres couleurs peqvent
en être compofées. Ces trois couleurs primitives
font le ja une , le rouge 8c le bleu. Le blanc 8c le
noir ne font pas des couleurs: le blanc n’eft autre
chofe que la repréfentation de la lumière, & le
noir que la repréfentation de la privation de toute
lumière. -
Cependant, comme il y a deux fortes de rouge
primitif, l’un tenant du jaune , comme le rouge
de feu ou vermillon, & l’autre du bleu, comme
le rouge cramoifi ou de laque , on peut compter
quatre-couleurs primitives , lavoir: le ja u ne , le
rougi de J eu, le rouge-cramoiji 8c le bleu.
De ces quatre couleurs primitives , il s’en
forme d’autres que nous nommons compofées.
Ainfi, du rouge de feu & du jaune; fe forme
Yo'angé; le rouge cramoifi & le bleu produifent
1 eviolet ; le bleu & le jaune compofent le verd.
Voilà donc une fuite ou un cercle de fept couleurs
, qui lont le jaune , l’ùrangé, le rouge de
feu , le cramoifi, le v io le t , le bleu & le verd ,
lefquelles en peuvent reproduire d’autres : carie
jaune & l’orangé feront-un jaune dorég le rouge
de feu & le cramoifi produiront le vrai] rouge ;
le cramoifi & le violet feront la couleur de pourpre
: lé bleu 8c le verd feront un verd de mer ;
enfin le verd 8c le jaune feront un vérd jaunâtre.
Toutes les couleurs ci-deflus font vives ; mais
fi on les avoit mêlées d’une au re façon, par
exemple, l’orangé avec le v io le t, .je rouge de
feu avec le b leu, le violet avecle verd ,& celui-
ci avec l ’orangé ou avec le rouge .de feu , ce mélange
n’auroi: produit que des cculeurs fales &
dé (agréables.
Pour faire des pajlels de toutes les couleurs
dérivées des couleurs primitives, on fe fert des
mêmes matières qui entrent dans la compofition
de celles qu’on employé à l’huile. En voici les
noms :
Cérufe.
Craie de Champagne fine.
Mafficot pâle.
Maflicot doré.
Jaune de Naples.
Ochre jaune.
Ochre brune.
Snl-dë-grain clair.
Stil-de-grain brun.
Minium.
Vermillon.
Brun rouge. '
Rouge d’Angleterre.
Laque.
Outremer.
Cendres bleues.
711
Indigo.
Email ou Smalt,
Terre verte.
Terre d’ombre.
Terre de Cologne.
Biftre. ;
Noi.f de charbon.
Noir d’Allemagne, ou d’imprimeur.
Noir d’os ou d’ivoire.
On peut y ajouter le carmin : on fe fert aufli
de la fanguine 8c du crayon noir ordinaire.
Avec toutes ces matières.., on compofe des
pajlels non-feulement des couleurs dont on vient
de parler ; maison fait'auffi des couleurs laies ,
des couleurs rompues, & enfin un très-grand
; nombre de teintes différentes.
Composition des pastels. I l faut premièrement
fa re des pajlels àe toutes les matières
fimples que nous avons nommées , fans y joindre
aucun mélange. Pour cet effet on obfervera ,
i ° . Que la cérufe , le ftil-de-grain cla ir, l’o-
chre , le jaune •, l'e rouge-brun , la terre d’oni-
bre & la terre de Cologne, étant de la confié
tance defirée pour l’objer qu'on fe propofe , fe
peuvent Amplement feier & tailler en crayons,
comme oh taille la.fanguine & la pierre noire.
Si dépendant on n’en trouve pas d’aflez gros
morceaux, on peut les broyer comme les autre»
Couleurs. ‘ .
2°. Que toutes les autres couleurs qui ne fonc
pas deconfiflance à pouvoir être fciées; fe broyènt
à l’eau, le plus fin qu’ il efl poffible, fur le marbre
ou fur ia pierre à broyer. Plus la pâte du pajlel
efl fine, & plus aifément elle s’attache au papier
que l’on veut peindre/EUe doit être paitrie
dans une confrftance qui permette de la réduire
en rouleaux ou crayons. On donne à ces rouleaux
à-peu-près lagtofleur du petit doigt d’une femme
délicate, & on les tiént d’une longueur qui les
rende propres à être maniés aifement.
3°. Qu’il efl néceffaire que les pajlels marquent
fans peine , & fans qu’on ait befoin d’appuyer
beaucoup fur le papier.. Ainfi, comme cer-
t aines couleurs fe trouvent d’ une trop dure con-
fiftance lorfqifelles font mifes en pajlels il faut
les mêler avec quel qu’autre fubftance moins
dure, 8c dont la couleur en foit voifine. Par
exemple , le ftil-de-grain brun , -la terre verte ,
le noir d’os ou d’ivoire, l’indigo feroient des
pajlels trop durs : on- joindra donc au ftil-de-
grain brun , de la terre de Cologne ^ à la terre
verte . de l’émail avec un peu de ftil-de-grain
j clair; au noir d’ivoire, un peu de noir de charbon
; & à l ’ indigo , de l’émail.
4°. Qu’il y a d’autres couleurs qui au contraire
font.trop tendres , comme l’émail, l’outremer
le carmin , le vermillon & quelques autres5
Alo rs , au lieu d’eau fimple, il faut les détrem*