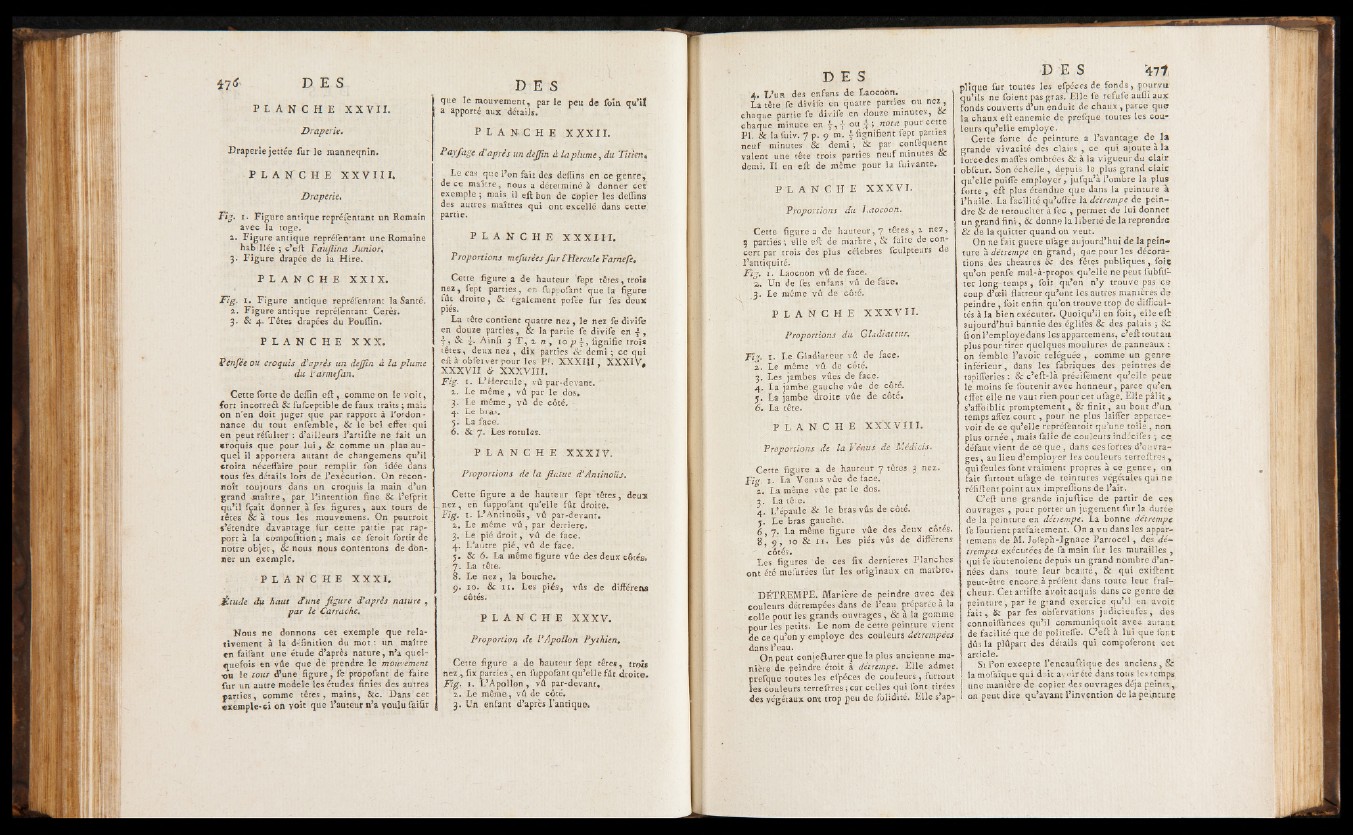
P L A N C H E X X V I I .
Draperie,
Draperie jettée fur le manneqnin.
P L A N C H E X X V I I I .
Draperie.
Fig. i- Figure antique représentant un Romain
avec la toge.
a. Figure antique repréfentant une Romaine
habillée ; c’ eft Faufiina Junior.
3. Figure drapée de là Hire.
P L A N C H E X X I X .
Fig. 1. Figure antique repréfentant la Santé.
a. Figure antique reprélenrant Cerès.
3. & 4. Têtes drapées du Pouffin.
P L A N C H E X X X .
Fenjee ou croquis d'après un dejjin à la plume
du Pàrmefan.
Cette forte de dellin eft , comme on le v o it,
fort incorreél & fufceptible de faux traits ; mais
on n’en doit juger que par rapport à l’ordonnance
du tout enfemble, 8c le bel effet qui
en peut réfui ter : d’ailleurs l’artifte ne fait un
troquis que pour lu i , & comme un plan auquel
il apportera autant de changemens qu’ il
croira néceffaire pour remplir fon idée dans
tous fes détails lors de l’exécution. On recon-
noît toujours dans un croquis la main d’ un
grand maître, par l ’intention fine & l’ efprît
qu’ il fçait donner à fes figures, aux tours de
têtes oc à tous les mouvemens. On pourroit
s’étendre davantage lur cette partie par rapport
à la compofition ; mais ce feroit fortir de
notre ob jet, 8c nous nous contentons de donner
un exemple.
P L A N C H E X X X I .
Étude du haut dune figure d*après nature ,
par le Carrache.
Nous ne donnons cet exemple que relativement
à la définition du mot : un maître
en faifant une étude d’après nature, n’a quelquefois
en vûe que de prendre le mouvement
tju le tour d’ une figure, fe propofant de Faire
fur un autre modèle les études finies des autres
parties, comme têtes , mains, &c. Dans cet
exemple-ci on voit que l’ auteur n’a youlufaifir
que le mouvement, p arle peu de foin qu’ il
a apporté aux détails.
P L A N .C H E X X X I I .
Payfagc d'après un dejjin à la plume, du Titien«
Le cas que l’ on fait des deffins en ce genres
de ce maître, nous a déterminé à donner cet
exemple ; mais, il eft bon de Copier les deffins
des autres maîtres qui ont excellé dans cette,
partie.
P L A N C H E X X X I I I .
Proportions mefurèes furîHercule Farnefe,
Cette figure a de hauteur fept têtes, trois
nez, fept parties, en fuppofant que la figure
fût droite, 8c également pofee lur fes deux
piés.
La tête contient quatre n e z , le nez fe divile
en douze parties, & la partie fe divife en ~ ,
f , & ?• Ainfi 3 z n , 16 p \> fignifie trois
têtes, deux nez , dix parties & demi ; ce qui
efià obfeiver pour les Pi. X X X I I I , X X X IV .
X X X V I I & X X X V I II .
Fig. 1. L’Hercule , vû par-devant.
z. Le même , vû par le dos,
3. Le même, vû de côté.
4. Le bras.
5. La face.
o. 8c 7. Les rotules.
P L A N C H E X X X I V .
Proportions de la fiutue d’Antinous.
Cette figure a de hauteur fept têtes deux
.n e z , eh fuppofant qu’elle fût droite.
Fig. 1. L’ Antinous, vû par-devant.
z. Le même v û , par derrière.
3. Le pié droit, vû de face.
4. L’autre pié, vû de face.
5. & 6. La même figure vûe des deux côté»,
7. La tête.
8. Le nez , la bouche.
9. 30. & 11 . Les piésj vûs de différens
côtés.
P L A N' C H E X X X V .
Proportion de VApollon Pythien,
Cette figure a de hauteur fept têtes, trois
nez., fix parties ", en fuppofant qu’elle fût droite.
Fig- iV L’Apollon, vû par-devant.
z. Le même, vû de côté.
3-. Un enfant d’après l ’antique.
4. L ’ un des enfans de Laocoôn.
La tête fe divife en quatre parties ou nez ,
chaque partie fe divife en douze minutes, 8c
chaque minute en 7 , y ou y ; nota pour cette
PI. 8c lafuiv. 7 p. 9 m. ^fignifient fept parties
neuf minutes & demi ; 8c par conféquent
valent une tête trois parties neuf minutes &
demi. Il en efl de même pour la luivante.
P L A N C H E X X X V I .
Proportions du l.aocoon.
Cette figure a de hauteur, 7 têtes, z nez,
3 parties*, elle eft de marbre, & faite de con-
cert par trois des plus célébrés fculpteurs de
l ’antiquité.
Fig. 1. Laocoon vû de face.
z . Un de fes enfans vû de face.
, .3 . L e m êm e v û d e côté.
P L A N C H E X X X V I I .
Proportions du Gladiateur.
Fig. 1. Le Gladiateur vû de face.
z. Le même vû de côté.
3. Les jambes vûes de face.
4 . La jam b e,g a u ch e v û e d e côte.
5. La jambe droite vûe de côté.
6. La tête.
P L A N C H E X X X V I I I .
Proportions de la Vénus de Méd-icis.
Cette figure a de hauteur 7 têtes 3 nez.
Fitr. 1. La Venus vûe de face.
а . La m êm e v û e par le dos.
3. La tête. A ,
4 . L’épaule & le bras v û s d e côté.
5. Le bras gauche.
б , 7. La même figure vûe des deux côtes.
8 , 9 , 10 & 11. Les piés vûs de différens
' côtés.
L es fig u res d e ces fix d ern ieres P la n ch es'
ont été m efu rèes lur le s o rig in a u x en m arbre.
DÉTREMPE. Manière de peindre avec des
couleurs détrempées dans de l ’eau préparée à la
colle pour les grands ouvrages , & a la gomme
pour les petits. Le nom dé cette peinture vient
de ce qu’on y employé des couleurs détrempées
dans l’eau.
On peut conjeélurerque la plus ancienne manière
de peindre étoit à détrempe. Elle admet
prefque toutes les efpéces de couleurs , furtout
les couleurs terreftres *,car celles qui font tirées
des végétaux ont trop peu de folidité. Elle s’applîque
fur toutes les efpéces de fonds, pourvu
qu’ ils ne foient pas gras. Elle fe refufe aufli aujp
fonds couverts d’ un enduit de chaux , parce que
la chaux eft ennemie de prefque toutes les couleurs
qu’elle employé.
Cette forte de peinture a l’avantage de la
grande vivacité des clairs , ce qui ajoute à la
force des malfes ombrées & à la vigueur du clair
| oblcur. Son échelle , depuis le plus grand clair
qu’elle puiffe employer, jufqu’ à l ’ombre la plus
forte , eft plus étendue que dans la peinture à
l’huile. La facilité .qu’offre la détrempe de peindre
& de retoucher à fec , permet de lui donner
un grand fini-, & donne la liberté de la reprendre
8c de la quitter quand on veut.
On ne fait guère ufage aujourd’hui de la peinture
a détrempe en grand, que pour les décorations
des théâtres Sc des fêtes publiques, foie
qu’on penfe mal-à-propos qu’elle ne peut fubfil-
ter long temps, foit qu’on n’y trouve pas ce
coup d’oeil flatteur qu’ont les autres manières de
peindre , foit enfin qu’on trouve trop de difficultés
à la bien exécuter. Quoiqu’ il en foit, elle eft
aujourd’hui bannie des égliles & des palais ; 8c
fi on l’employe dans les appartenons, c’eft tout au
plus pour tirer quelques moulurés de panneaux :
on femblc l’avoir reléguée , comme un genre
inférieur, dans les fabriques des peintres de
tapifferies : 8c c’ eft-là précifément qu’ elle peut
le moins fe louteniravec honneur, parce qu’ en
effet elle ne vaut rien pour cet ufage. Elle pâlit,
s’affoiblit promptement. 8c fin it, au bout d’ un
temps affez cou r t, pour ne plus laiffer appevee-
voir de ce qu’elle repréfentoit qu’une to ile , non
plus ornée , mais falie de couleurs indccifes i ce
défaut vient de ce que , dans ces fortes d’ouvrag
e s , au lieu d’employer les couleurs t-erreftres ,
qui feules font vraiment propres à ce genre , on
fait lurtout ufage de teintures végétales qui ne
réfiftent point aux imprelîions de l’air.
C’eft une grande injuftîce de partir de ces
ouvrages , pour porter un jugement fur la durée
de la peinture en détrempe. La bonne détrempe
fe Toutient parfaitement. On a vu dans les appar-
temens de M. Jofeph-Ignace Parrocel, des dé~
trempes exécutées de fa main fur les murailles ,
qui le loutenoierit depuis un grand nombre d’ années
dans toute leur beauté, & qui exiftent
peut-être encore,àpréfent dans toute leur fraîcheur.
Cet artifte a voit acquis dans ce genre de
peinture, par le grand exercice qu’ il en avoic
fa it , 8c par fes obfervations judicieufes, des
connoiffances qu’ il communiquoit avec autant
de facilité que de politefle. C’ eft à lui que font
dûs la plûpart des détails qui compoferont cct
article.
Si l’on excepte l’encauftique des anciens , &
la mofaïque qui doit avoir été dans tous les temps
une manière de copier des ouvrages déjà peints,
on peut dire qu’avant l ’ invention de la peinture