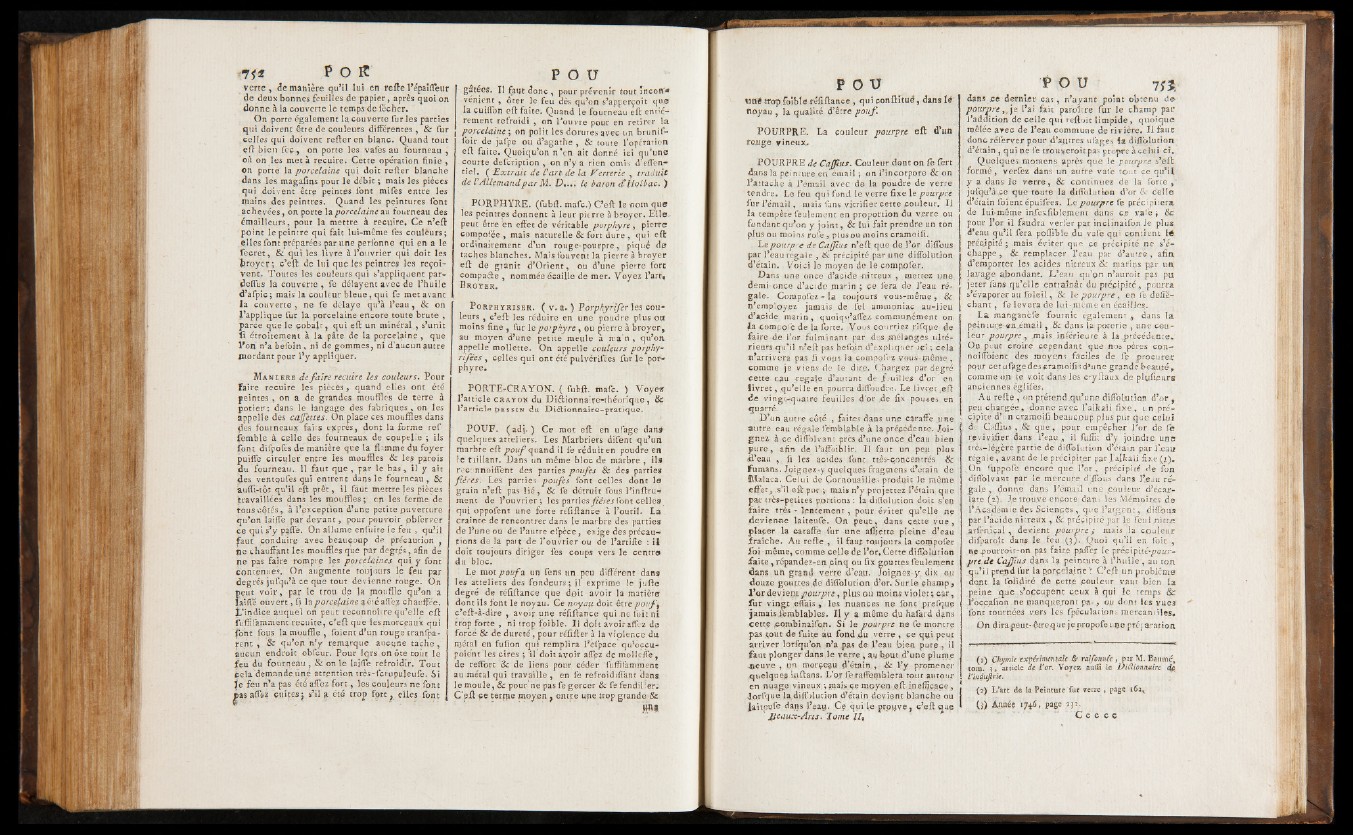
»7f* P O R v e r te , de manière qu’il lui en refte l’épaîffçur
de deux bonnes feuilles de papier, après quoi on
donne à la couverte le temps de fécher.
Gn porte également la couverte fur ies parties
qui doivent être de couleurs différentes , & fur
.celles qui doivent refter en blanc. Quand tout
çft bien f e ç , on porte les vafes au fourneau ,
oii on les meta recuire, Cette opération finie ,
on porte la porcelaine qui doit refter blanche
dans les magafins pour le débit ; mais les pièces
qui doivent êtrp peintes font mifes entre les
mains des peintres. Quand les peintures font
. achevées, on porte la porcelaine au fourneau des
émailleurs, pour la mettre à recuire. Ce n’eft
point le peintre qui fait lui-même les coulèurs;
elles font préparées par une perfonne qui en a le
fecret, & qui les livre à l’ouvrier qui doit les
broyer; c’eft de lui que Içs peintres les reçoivent.
Toutes les couleurs qui s’appliquent par-
deffus la couverte , fe délayent avec de l’huile
d’afpic; mais la couleur bleue, qui fe met avant
la couverte , ne fe délaye qu’ à l’eau, & on
l ’applique fur la porcelaine encore toute brute ,
parce que le çobajr, qui çft un minéral , s’unit
l i étroitement à la pâte de la porcelaine , que
l'oii n’a befoin , ni de gommes, ni d’aucun autre
mordant pour l’y appliquer.
Man ière défaire recuire les couleurs. Pour
faire recuire les piècès^ quand elles ont été
peintes , on a de grandes moufïles de terre à
potier’ ; dans.le langage des fabriques , on les
appelle des cajfettes. On place ces moufïles dans
des fourneaux faits exprès, dont la forme re f
lemble à cçlle des fourneaux de coupejîe ; ils
font difpofés de manière que la flamme du foyer
puiffe circuler entre les moufïles & les parois
du fourneau.. 11 faut que , par le bas , il y ait
des ventqufes qui entrent dans le fourneau , &
aufli-tpt qu’ il eft prêt, il faut mettre les pièges
travaillées dans les moufïles ; cp les ferme de
touscqtés , à l’exception d’ ung petite puverture
qu’on laiffe par deyant, pour pouvoir pbferver
ce qui s’y p^ffe. On allume enfuire le feu , qu’ il
faut conduire avec beauçoup de précaution ,
ne chauffant les moufïles que par degrps j afin de
ne pas faire rompre les porcelaines qui y font
cqntènues. On augmente toujours le feu par
degrés jufqu’ à ce que tout devienne rouge. Ôn
peut v o ir , par le trou de fa papuffle qu’on a
laiffe ouvert, fi la porcelaine aéré affe.z chauffée,
t ’ indice auquel on peut r'econnoître qu’elle eft
fuffifamment recuite, c ’eft que les morceaux qui
l’ont fous la mqufïle , foient d’un rouge tranfpa-
rent , & qu’on n’y remarque aucune tache,
aucun endroit obfcur. Pour Iqrs on ôte tout le
feu du fourneau ? & on le laiffe refroidir. Tout
irela demande une attention très-ferupujeufe. Si
Je feu n^a pas été affez fo r t , les couleurs ne font
pasaffâz çilftesj s’ il a été trop fprt^ elles font
P O U
gâtées. Il £aut donc, >our prévenir tout ïncou*
venjent , ôter le feu dès qu’on s’apperçoit que
la çuilTon eft faite. Quand le fourneau eft entièrement
refroidi , on l ’ouvre pour en retirer la
porcelaine ; on polit les dorures avec un brunif-
foir de jafpe ou d’agathe , & toute l’opération
eft fa ite. Quoiqu’on n ’ en ait donné ici qu’une
courte delcription , on n’y a rien omis d’effen-
tiel. ( E x trait de Vart de la Verrerie , traduit
de VAllemandpar M. P . .. , U baron d'Holbac. )
. PORPHYRE, (fubft. mafe.) C’eft le nom que
les peintres donnent à leur pierre à broyer. Elle-
peut être en effet de véritable porphyre, pierre
compofée , mais naturelle & fort dure , qui eft
ordinairement d’un rouge-pourpre, piqué de
taefies blanches. Mais fouvent la pierre à broyer
eft de granit d’Orient, ou d’une pierre fore
compaéïe , nommée écaille de mer. Voyez l’are,
Broyer,
P orphyriser. ( v. a. ) Vorphyrifer les couleurs
, c’eft les réduire en une poudre plus ou
moins fine , fur le porphyre , ou pierre à broyer,
au moyen d’une petite meule a ira n , qu’on
appelle mollette. On appelle couleurs porphy-
rifées, celles qui ont été pulvërifées fur le porphyre.
PORTErCRAYON. ( fubft. mafe. ) V o y e t
l ’attiçle crayon du Diétionnaipe-théorique, &
l’article dessin du Diélionnaire-pratique.
POUF. (adj. ) Ce mot eft en ufage dan$
quelques atteliers. Les Marbriers difent qu’ un
marbre eft p ouf quand il fe réduit en poudre en
le tiillanr. Dans un même bloc de marbre , ils
rèconnoiffent des parties poufes & des parties
fières. Les parties poufes font celles dont la
grain n’eft pas l i é , 8c fe détruit fous l ’ inftru*
ment de l’ouvrier; les parues fières font celles
qui oppofent une forte réfiftance à l’outil. La
crainte de rencontrer dans le marbre des parties
de l’une ou de l’autre efpèce, exige des précau-«
fions de la paît de l’ouvrier ou de l’artifte : U
doit toujours diriger fes coups vers le centre»
du bloc.
Le mot pouf a un fens un . peu différent dans
les atteliers des fondeurs; il exprime !e jufte
degré de réfiftance que doit avoir la matière
dont ils font le noyau. Ce noyait doit être p ouf «
c’eft-à-dire , avoir une réfiftance qui ne foie ni
trop forte , ni trop fpible. Il doit avoir aflcz dp
forcé & de dureté, pour réfifter à la violence du
métal en fufion qui remplira l ’efpace qufoçcu-
poiéntles cires ; il doit avoir affez dp mollefle,
de reffbrt 8c de liens pour céder fuffifanmienc
au métal qui travaille , en fe refroidiflant dans
Je moule, & pour ne pas fe gercer & fe fendiller;
C p ft ce ternie moyen. entre upe trop grande &
P i
titré trop faible réfiftance , qui conftitué, dans lé
noyau , la qualité d’être pouf.
POURPRE. La couleur pourpre eft d’un
rouge vineux.
POURPRE de Cafflus. Couleur dont on fe fart
dans la peinture en émail ; on l’ incorpore & o n
l’attache à l ’émail avec de la poudre de verre
tendre. Le feu qui fond le verre fixe le pourpre
fur l’émail, mais fans vitrifier cette couleur. Il
la tempère feulement en proportion du verre ou
fondant qu’on y joint, & lui fait prendre un ton
plus ou moins rô le , plus ou moins cramoifi.
Lé pourpre de Cajjius n’eft que de l’ or diffous
par l’ eau régale , & précipité par une diffolution
d’étain. Voici le moyen de le compiler.
Dans une once d’acide rwitreux , mettez une
demi-once d’acide marin ; ce fera de l’eau régale.
Compofez - la toujours vous-même , 8c
n’employez jamais de fel ammoniac au-lieu
d’acide marin,, quoiqu’afle/. communément on
la composé de la forte. Vous courriez jrifqpe de
faire de l’or fulminant par dss .mélanges ultérieurs
qu'il n’eft pas bèfoin d’expliquer-içî -, cela
n’arrivera pas fi vops la .compofez .vous-même ,
comme je viens de le dir.e. Chargez par degré
cette eau rregale d’ autant de /juillet d’or en
livret , vqu’elle en pourra ffiffbudro. Le livret .eft
de vingt-quatre feuilles d’or de fix pouees en
quarré.
D ’un autre côté , faites dans une caraffe vune,
autre eau régale fèmblable.a la précédente. Joignez
à,ce diffolvant près d’ une once d’eau bien
pure, afin de l’affoiolir. Il faut un pep plus
d ’eau , fi les acides fonc tuès-qoncemrés &
Fumans. Joigpez^y quelques fragpiens d’ étain de
fVIalacâ. Celui de Cornouailles produit le même
effet> .s’il eft pur-; mais n’y projettez l’étain que
par très-petites portions : la diffolution doit s?en
faire très - lentement, pour éviter qu’elle ne
.devienne laiteufe. On peut, dans çette yue ,
placer la caraffe fur une affecte pleine d’ eau
fraîche. Au refte , il faut toujours la composer
foi même, comme celle de l’or. Cette diffolution
faite , répandez-en. cinq ou fix gouttes feulement
dans un grand verte d’eau. Joignez-y„ dix ou
douze gouptes de diffolution d’or. Sur le champ ,
l ’or devient pourpre, plus ou moins violet; car,
lur vingt eflais, les nuances ne font prefqup
jamais Semblables. Il y a même du hafard dans
cette rCO.mbinaiCon. Si le pourpre n,e fe montre
pas,tout de fuite âù fond du verre , ce q yi peut
arriver lorfqu’on n’a pas de l’eau bien purç, il
faut plonger dans le v erre, aub.out d’une plume
jtieuve , un morceau d’étain,, & l’y promener
quelque® inftans. L’or fe raffeipblçra tout autour
en nuage, vineux i ma|s çe moyen oft inefficace,
dorique la diflblution d?étain devient blanche ou
Jaiteufe dans l’eay. Cç qui le prouve» c’.eft que
Beaux-Arts. Tome //,
dans .ce dernier c a s , n’ayant point obtenu de-
pourpre , #je l’ai fait paroître fur le champ par
l’addition de celle qui reftoit limpide, quoique
mêlée avec de l’eau commune de rivière. Il fauc
donc réferver pour d’autres ufages ta diffolution
d’étain , qui ne fe trouweroitpas propre à celui-ci.
Quelques raoraens aptfs que le pourpre s’eft
formé, verfez dans un. autre vafe tout ce qu’ il
y a dans le verre, & continuez de la forte,
jufq-u’à ç e que toute la diffolution d’or & celle
d’étain foient épuifées. Le pourpre fe précipitera
de lui-même infes-fiblement dans ce v,a!e ; &
pour l’or il faudra verfer par inclinaifon le plus
d’eau qu’il fera pofïible ,du vafe qui contient lé
précipité ; mais éviter que ,ce .précipité ne s’échappe
, & remplacer l’eau par d’autre, afin
d’ emporter les acides nitr.eux 8c marins par un
lavage abondant. L ’eau qu’on n’auroit pas pu
jeter ïans qu’elle .entraînât du précipité, .pourra
s’évaporer au foie i l , & le pourpre , en l’edeffé-
ch an t, fe lèvera de lui- meme en écailles.
La manganèfe fournit également , dans la
peimuçe-enjémail, 8c dans La poterie , une couleur
pourpre, mais inférieure à la précédente*
On peut, croire cependant que no» pères con-
noiffoienc des moyens faciles de fp procurer
pour cet ufagedescrapaoifisd*une grande beauté,
comme on le v.oit dans les cryftâux de plufieurs
an.cien nés. églifes*
Au refte , on prétend.qu’ une diffolution d’or
pep chargée » -donne ave.c l’ allcali fix e , un précipité
d’un cramoifi beaucoup plus pur que celui
de Càflius , ,8c que , pour empêcher Tor de Ce
revivifier dans l’eau ,, il foffit d’ y joindre une
très-légère partie de diffolution d’ étain pa-r î ’eau:
régaie, avant de le précipiter par falkali fixe (x).
sOn fiippofe encore que l’o r , précipité de fon
diffolvant par le mercure diffous dans l’^ru régale
, donn.e da.çxs l’émail une jçouleur d’écarlate
(x). J.e trouve encore dau > les Mémoires de
l’Académie des Scienpffs, que l ’argent, diffous
par l’acide nitreux , & précipité par le feul nitre
arféniçal , devient pourpre y mais la couleur
difparoît dans le feu (^). Quoi qu’il en foit ,
Rje-pourroitron pas faire paffer le précipité-/mwr-
pred e Cajfius dans la peinture .à i’ huile , au ton
qu’ il prend fur la porcelaine ? C’eft un problème
dont la lblidité de pette „couleur vaut bien la
.peine que s’occupent ceux à qui Je temps &c
rôçcafion ne manqueront p^>_, ou dont les vue»
font tournées vers Les fpécularrons mercaniiles#
On diraient-étre^que je pro.pofe une préfa’ ation
( i) Ckymie expérimentale & raifannée , par M. Baume,
tom. i 3 article de l'or. Voyez aulfi le Dictionnaire de
l'itidujtrie.
(a*) L ’àrt de la Peinture fur verre , page i6av
(j) Année 1746, page 232,
C c c c c