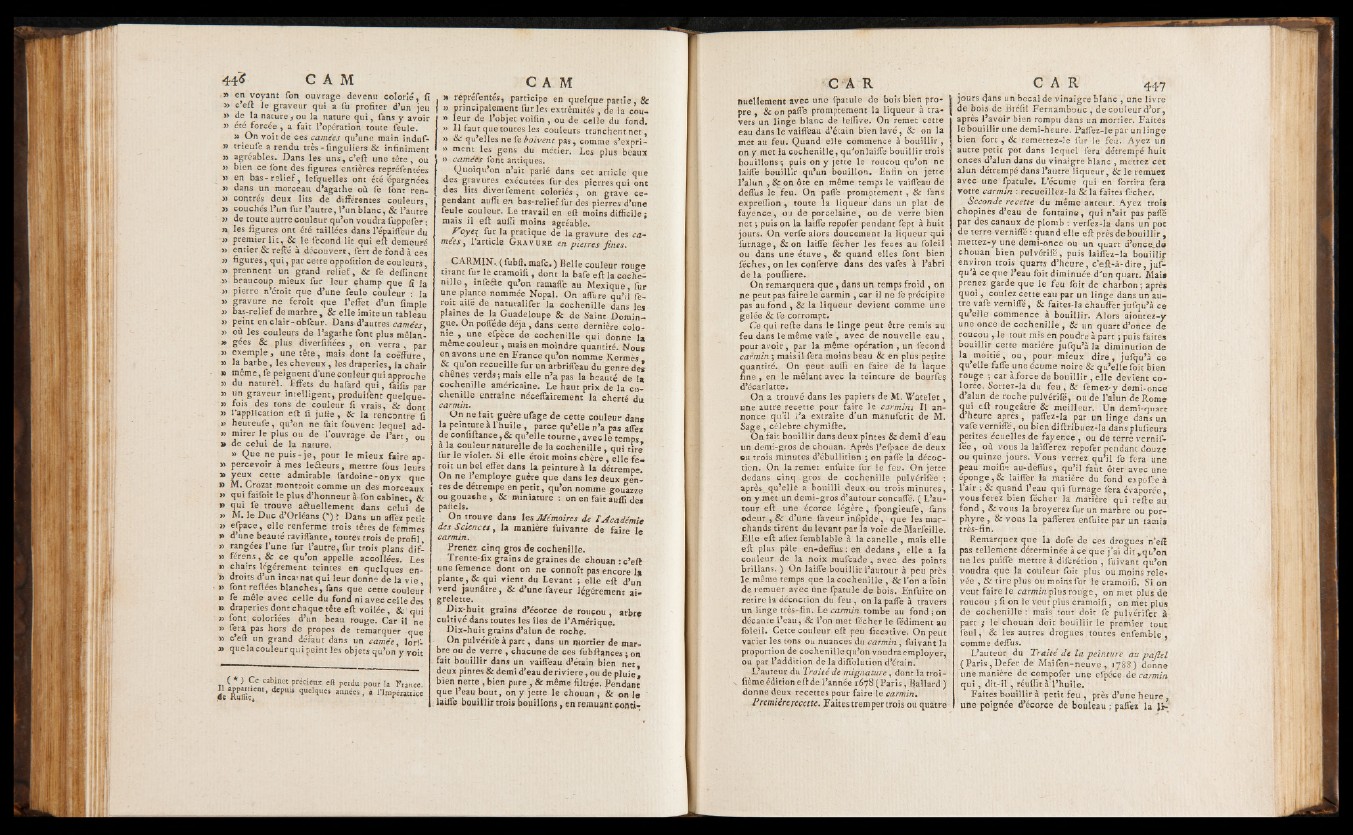
» en voyant Ton ouvrage devenu colorié, fi
» e’eft le graveur qui a fu profiter d’ un jeu
» de la nature>ou la nature q ui, fans y avoir
» été forcée , a fait l’opération toute feule.
» On voit de ces campes qu’une main induf*
» trieufe a rendu très-finguliers & infiniment
» agréables. Dans les uns, c’eft une tê te , ou
» bien ce l'ont des figures entières repréfentées
» en b a s - r e lie f, lefquelles ont été épargnées
» dans un morceau d’agathe où fe font ren-
» contrés deuit lits de différentes couleurs
» couchés l’un fur l’autre, l’ un blanc, & l’autre
» de toute autre couleur qu’on voudra fuppofer :
a les figures ont été taillées dans l’épaiffeur du
» premier l i t , & le fécond lit qui eft demeuré
» entier & refte à découvert, fert de fond à ces
» figures, q u i, par cette oppofition de couleurs
» prennent un grand re lie f, & fe delfinent
» beaucoup mieux fur leur champ que fi la
» pierre n’ctoit que d’une feule couleur : la
» gravure ne feroic que l ’effet d’ un finiple
» bas-relief de marbre, & elle imite un tableau
» peint enclair-obfcur. Dans d’autres camées
» où les couleurs de l ’agathe font plus mêlan-
» gées & plus diverfifiëes , on v e r ra , par
» exemple, une tê te , mais dont la coèffure
» la barbe, les cheveux, les draperies, la chair
a même, fe peignent d’une couleur qui approche
» du naturel. Effets du hafard q u i, faifis par
» un graveur intelligent, produifent quelque-
» fois des tons de couleur fi vrais, & dont
» l’application eft fi jufte , & la rencontre fi
» heureufe, qu’on ne fait fouvênt lequel ad-
» mirer le plus ou de l’ouvrage de l’art ou
a de celui de la mature.
a Que ne p u is - je , pour le mieux faire ap-
» percevoir à mes leffeurs, mettre fous leurs
» yeux cette admirable fardoine-onyx que
» M. (iro/ar roontroit comme un des morceaux
» qui failoit le plus d’honneur à- fon cabinet, &
» qui fe trouve usuellement dans celui de
» M. le Duc d’Orléans (*) ’ Dans un affei petit
» efpace, elle renferme trois têtes de femmes
» d’une beauté raviflante, toutes trois de profil
» rangées l’une fur l’autre, fur trois plans dif-
» férens, & ce qu’on appelle aceollées. Les
» chairs légèrement teintes en quelques en-
» droits d’ un incarnat qui leur donne de la vie
» font reliées blanches, lins que cette couleur
» fe mêle avec celle du fond ni avec celle des
» draperies dont chaque tête eft voilée, & qui
» font coloriées d’un beau rouge. Car il ne
» fera. pas hors de propos de remarquer que
» c’ eft un grand défaut dans un camée, lorfl
m quelacouleurqui peint les objets qu’on y voit
( * ) C e cabinet précieux eft
Il appartient, depuis quelques
de Ruffiç,
perdu pour la France,
années, à l ’Impératrice
» rèprefentes, participe en quelque partie, &
» principalement furies extrémités , de la cou-
» leur de l’objet voifin , ou de celle du fond.
» I l faut que toutes les couleurs tranchentnet,
. » & qu’elles ne fe boivent pas, comme s’expri-
» ment les gens du métier. Les plus beaux
J » caméffs font antiques.
Quoiqu’on n’ait parlé dans cet article que
des gravures exécutées fur des pierres qui ont
des lits diverfement coloriés , on grave cependant
aufli en bas-relief fur des pierres d’une
feule couleur. Le travail en eft moins difficile ;
mais royei il eft aufti moins agréable. mées, fur la pratique de en la gravure l’article Gravure pierres fines.
des ca
CARMIN, (fubft.mafc.) Belle couleur rouge
tuant fur le cramoifi , dont la bafe eft la cochenille
, tnfeâe qu’on ramaffe au Mexique, fur
une plante nommée Nopal. On affure qu’ il fe.
roit ailé de naturalifet la cochenille dans les
plaines de la Guadeloupe & de Saint Domin-
gue. On pofféde déjà, dans cette dernière colonie
, une efpèce de cochenille qui donne la
même couleur , mais en moindre quantité. Nous
en avons une en France qu’on nomme Kermès
& qu’on recueille fur un arbrifieau du genre des
chênes verds ; mais elle n’ a pas la beauté de la
cochenille américaine. Le haut prix de la cochenille
entraîne néceffairement la cherté du carmin.
On ne fait guère ufage de cette couleur dans
la peinture à l’huile , parce qu’elle n’a pas aflez
de confiftance, & qu’elle tourne, avec le temps
à la couleur naturelle de la cochenille , qui tiré
lur le violet. Si elle étoit moins chère , elle fe -
roit un bel effet dans la peinture à la détrempe.
On ne Remployé guère que dans les deux genres
de détrempe en petit, qu’on nomme gouazze
ou gouache , & miniature : on en fait auffi des
paüels.
On trouve dans les Mémoires de ïAcadémie
des Sciences, la manière fuivante de faire le carmin.
Prenez cinq gros de cochenille.
Trente-fix grains de graines de chouan : ç’eft
une femence dont on ne connoît pas encore la
plante , & qui vient du Levant - elle eft d’un
verd jaunâtre, & d’une faveur légèrement ai*»
grelette.
Dix-huit grains d’écorce de rouçou , arbre
cultivé dans toutes les îles de l’Amérique.
Dix-huit grains d’alun de rochp.
On pulvérife à part, dans un mortier de mar*.
bre ou de verre , chacune de ces fubftgnces ; on
fait bouillir dans un vaifleau d*écain bien net
deux pinres & demi d’ eau deriviere, ou de pluie4
bien nette , bien pure , & même filtrçe. Pendant
que l’eau bout, on y jette le chouan , & on le
laifle bouillir trois bouillons, en remuant çoncinuellement
avec une fpatule de bois bien pro- J
pre , & on parte promptement la liqueur à tra- |
vers un linge blanc de lelîive. On remet cette
eau dans le vaifleau d’étain bien lavé, & on la
met au feu. Quand elle commence à bouillir ,
on y met la cochenille, qu’onlaifle bouillir trois
bouillons^; puis on y jette le roucou qu’on ne
lairte bouillir qu’ un bouillon. Enfin on jette
l ’alun , & on ôte en même temps le vaifleau de
deflus le feu. On parte promptement, & fans
expreffion , toute la liqueur dans un plat de
fayence, ou de porcelaine, ou de verre,bien
net -, puis on la lairte repofer pendant fept à huit
jours. On verfe alors doucement Ja liqueur qui
fumage, & on lairte fécber les feces au foleil
ou dans une étuve, & quand elles font bien
féches, on les conferve dans des vafes à l’abri
de là pouftiere.
On remarquera que , dans un temps froid , on
ne peut pas faire le carmin , car il ne fe précipite
pas au fond , & la liqueur devient comme une
gelée & fe corrompt.
Ce qui refte dans le linge peut être remis au
feu dans le même vafe , avec de nouvelle eau,
pour avoir, par la même opération , un fécond
carmin ; mais il fera moins beau & en plus petite
quantité. On peut aufli en faire de la laque
n n e , en le mêlant avec la teinture de boiirfeç
d’écarlatte.
On a trouvé dans les papiers de M. Wa te le t,
une autre recette pour faire le carmini II annonce
qu’il i’a extraite d’un manuferit de M.
S age , célébré chymifte.
On fait bouillir dans deux pintes & demi d’eau
un demi-gros de chouan. Après l ’efpace de deux
ou trois minutes d’ébullition ; on parte la décoction.
On la remet enfuite fur le feu. On jette
dedans cinq gros de cochenille pulyériféè ;
après qu’ ellé a bouilli deux ou trois minutes,
on y met un demi-gros d’autour concafle. ( L’autour
eft une écorce légère, fpongieufe, fans
odeur , & d’ une faveur infipide, que les marchands
tirent du levant par la voie de Marfeille.
Elle eft aflez femblable à la canelle , mais elle
eft plus pâle en-deflus : en dedans, elle a la
couleur de la noix mufeade , avec des points
brillans. ) On laifte bouillir l’autour à peu près
le même temps que la cochenille , & l’on a foin
de remuer avec une fpatule de bois. Enfuite on
retire la décoction du feu , on la pafle à travers
un linge très-fin. Le carmin tombe au fond ; on
décante l’eau, & l ’on met fécher le fédiment au
foleil. Cette couleur eft peu ficcative. On peut
varier les tons ou nuances du carmin, fuiyant la
proportion de cochenille qu’on voudra employer,
ou par l’addition de la diflolution d’étain.
L’auteur du Traité de mignature, dont la troi-
- fième édition eft de l’année 1678 ( Paris, ^allard )
donne deux recettes pour faire le carmin.
Première recette. Faites tremper trois ou quatre
jours dans un bocal de vinaigre blanc , une livre
de bois de Biéfil Fernambouc, de couleur d’o r ,
après l’ avoir bien rompu dans un mortier. Faites
lebouillir une demi-heure. Paflez-le par un linge
bien fort , & remettez-]e fur le feu. Ayez un
autre petit pot dans lequel fera détrempé huit
onces d’alun dans du vinaigre blanc , mettez cet
alun détrempé dans l’autre liqueur, & le remuez
avec une fpatule. L’écume qui en fortira fera
votre carmin : recueillez-la 8c la faites fécher.
Seconde recette du même aateur. Ayez trois
chopines d’eau de fontaine, qui n’ait pas pafle
par des canaux de plomb : verfez-Ia dans un pot
de terre vernifle : quand elle eft près de bouillir ,
mettez-y une demi-once ou un quart d*once_do
chouan bien pulvérife, puis laiffez-la bouiilir
environ trois quarts d’heure, c’eft-à-dire, juf-
qu’a ce que l’eau foit diminuée d’ un quart. Mais
prenez garde que le feu feit de charbon; après
q uoi, coulez cette eau par un linge dans un autre^
vafe vernifle, & faites-la chauffer jufqu’ à ce
qu’e lle commence à bouillir. Alors ajoutez-y
une once de cochenille , 8c un quart d’once de
roucou ,.le tout mis en poudre à part ; puis faites
bouillir cette matière jufqu’à la diminution de
la moitié, ou, pour mieux d ire , jufqu’à ce
qu’elle fafle une écume noire 8c qu’elle foit bien
rouge ; car ajorce de bouillir , elle devient colorée.
Sortez-la du feu , 8c femez-y demi-once
d’alun de roche pulvérife, ou de l ’alun de Rome
qui eft rougeâtre & meilleur. Un demi-quart
d’heure après, paflez-Ia par un linge dans un
vafe vernifle, ou bien diftribuez-la dans plufieurs
petites écuelles de fayence , ou de terre vernif-
fée , où vous la laiflerez repofer pendant douze
ou quinze jours. Vous verrez qu’ il fe fera une
peau moifie au-deflus, qu’il faut ôrer avec une
éponge,& laifler la matière du fond expofée à
l’air ; & quand l’eau qui fumage fera évaporée,
vous ferez bien fécher la matière qui refte au
fond , & vous la broyerez fur un marbre ou porphyre
, & vous la paflerez enfuite par un tamis
très-fin.
Remarquez que la dofe de ces drogues n’eft
pas tellement déterminée à ce que j ’ai dit „qu'on
11e les puirte mettre à diferétion , fuivant qu’on
voudra que la couleur foit plus ou moins relevée
, & tire plus ou moins fur le cramoifi. Si on
veut faire le carminplus rouge, on met olusde
roucou ; fi on le veut plus cramoifi, on met plus
de cochenille : mais tout doit fe pulvérifer à
part ,• lé chouan doit bouillir le premier tout
fe u l, 8c les autres drogues toutes enfemble ,
comme deflus.
L’auteur du Traité de la peinture au paftel
( P aris,De fer de Maifon-neuve , 1788) donne
une manière de compofer une elpéce de carmin
q u i , d it - il, réuflit à l’huile.
Faites bouillir à petit feu , près d’ une heure ,
une poignée d’écorce de bouleau ; partez la 1K