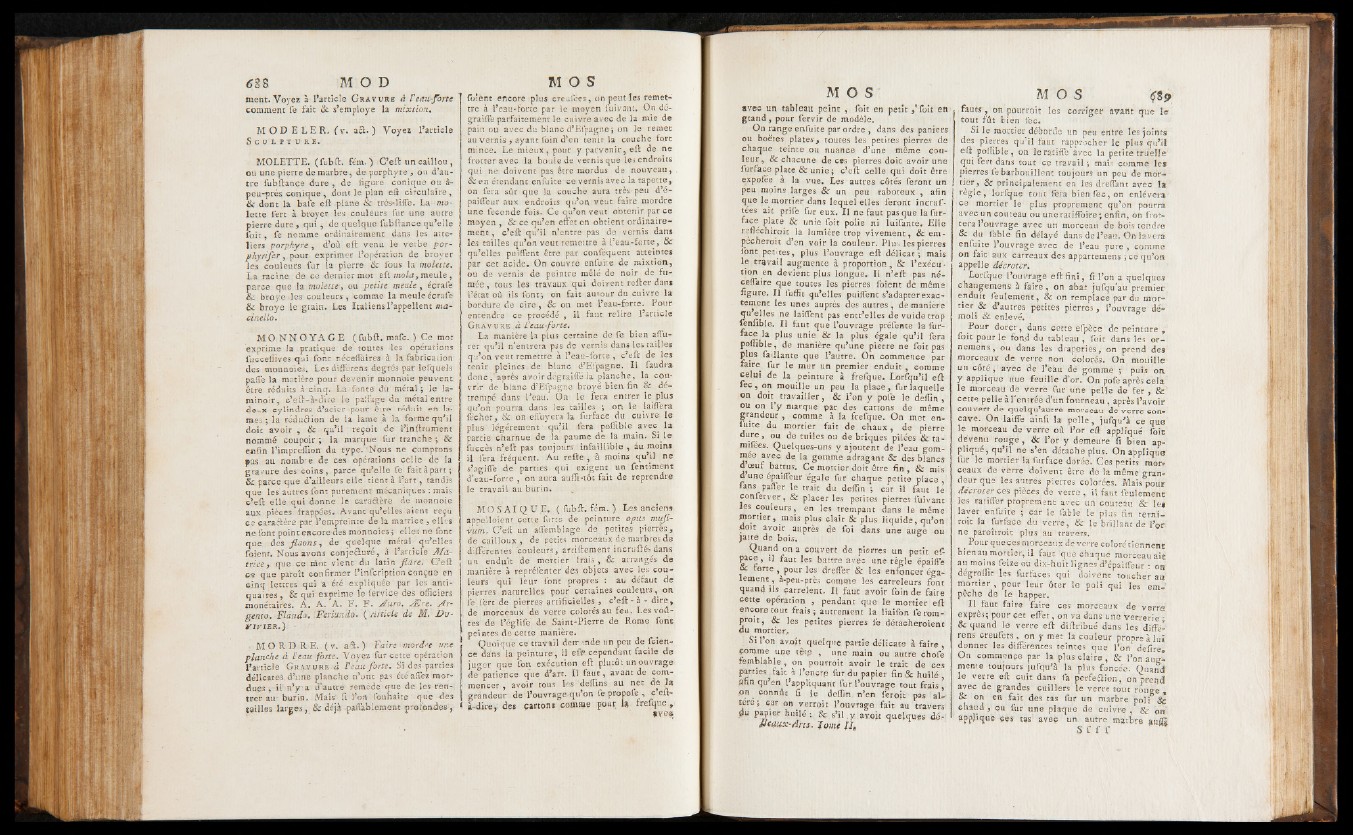
m M O D
ment. Voyez à l’article Gravure à t eau-forte
comment fe fait & s’employe la mixtion•
M O D E L E R , ( v. a8t . ) Voyez l’article
5 c u l î T Ü RE.
MOLETTE, (fubft. fém.) C’eft un caillou,
ou une pierre de marbre, de porphyre , ou d’autre
fubftance dure , de figure conique ou à-
peu-près conique, dont le plan eft circulaire ,
8c dont la bafe eft plane & très-lifie. La molette
fert à broyer les couleurs fur une aucre
pierre dure , q u i, de quelque fubftance qu’elle
io i t , fe nomme ordinairement dans les atte-
liers porphyre , d’où eft venu le verbe por-
phyrifer, pour exprimer l’opération de broyer
les couleurs fur la pierre & fous la molette,
La racine de ce dernier mot eft mola, meule ,
parce que la molette , ou petite meule, écrafe
6 broyé les couleurs , comme la meule écrafe
8c broyé le grain. Les Italiens l ’appellent ma-
cin.ei.lo.
M O N N O Y A. G E ( fubft. mafc. ) Ce mot
exprime la pratique de toutes -les opérations
luccefiives qui font néceflaires à la fabrication
des monnoies. Les différens degrés par lefquels
pafle la matière pour devenir monnoie peuvent
être réduits à cinq. La fonte dii métal ; le laminoir,
c’eft-à-dire_ le paflage du métal entre
deux cylindres d’acier pour être réduit, en lames
; la réduction de la lame à la forme qu’ il
doit avoir , & qu’ il reçoit de l’inftrumenc
nommé coupoir ; la marque fur tranche -, &
enfin l’imprefïion du type. :Nous ne comptons
pas au nombre de ces opérations celle de la
gravure des coins, parce qu’elle fe fait à part ;
& parce que d'ailleurs e lle tiènr à l’a r t , tandis
que les autres (ont purement mécaniques : mais
c’eft elle qui donne le caractère de monnoie
aux pièces frappées. Avant qu’elles aient reçu
ce caractère par l ’empreinte de la matrice , elles
ne font point encore des monnoies s elles ne font
que des fa o n s , de quelque métal qu’elles
foient. Nous avons conjecture, a l’ article Matrice,
que ce mot vient du latin flâre. C’ eft
ce que paroît confirmer l’ infcription conçue en
cinq lettres qui a été expliquée par les antiquaires,
& qui exprime le fervîce des officiers
monétaires. A . A. A. F . F . jfuro. Ære. f r -
gento. Flando. Feriundo. [ Article de M. JDu-
VIVIER. )
r M O R D R E , ( v . aft.) Faire mordre une
planche à Veau forte. Voyez fur cette opération
l’ article Gra.v u re-'à Veau forte. Si des parties
délicates d’une planche n’ont pas été aftez mor»
dues, il n’y a o’autré' remède que de les rentrer
au- burin. Mais- fi l’on fouhaite que des
tailles larges, & déjà paflabiement profondes-,
M O S
fuient encore plus creufées, on peut les remettre
à l’eau-force par le moyen fuivant. On dé-
graifïe parfaitement le cuivre avec de la mie de
pain ou avec du blanc d’Efpagne ; on le remet
au v ernis , ayant loin d’en tenir la couche fort
mince. Le mieux, pour y parvenir, eft de ne
frotter avec la boule de vernis que les endroits
qui ne doivent pas être mordus de nouveau,
& en étendant enfuite -ce vernis avec la tapette,
on fera sûr que la couche aura très peu d’é-
paifleur aux endroits qu’on, veut faire mordre
une fécondé fois. Ce qu’on veut obtenir par ce
moyen , & ce qu’ en effet on obtient ordinairement,
c’ eft qu’ il n’entre pas de vernis dans
les tailles qu’on veut remettre à l’eau-forte, &
qu’elles puiffent être par conféquent atteintes
par cet acide- On couvre enfuite de mixtion,
ou de vernis de peintre mêlé de noir de fumée
, fous les travaux qui doivent refter dans
l’état où ils font; on fait autour du cuivre la
bordure de cire , & on met l’eau-forte. Pour
entendre ce procédé , il faut relire l’article Gravure^ £ eau -fo r te.
La manière la plus certaine de fe bien aflu-
rer qu’ il n’entrera pas de vernis dans les tailles
qu’on veut remettre à l’eau-forte , c’eft de les
tenir pleines de blanc d’Efpagne. Il faudra
donc, après avoir dé.graiffe la planche, la cou-
; vrir de blanc d’Efpagne broyé bien fin & détrempé
dans l’eau. On le fera entrer le plus
qu’on pourra dans les tailles ; on le laiffera
fécher, & on eftuyera la furface du cuivre le
plus légèrement ■ qu’ il fera poflible avec la
partie charnue de la paume de la main. Si le
fticeès h’eft pas toujours infaillible , au moins
il fera fréquent. Au refte , à moins qu’ il ne
' s’agifie de parties qui exigent un fentiment
d’eau-force , on aura aufli-tôt fait de reprendre
; le travail au burin.
MO S A Ï Q U E , ( fubft. fém. ) Les anciens
appelloient cette forte de peinture o p u s muf-
vùm. C’eft un aftemblage de petites pierres,
de cailloux , de petits morceaux de marbres de
differentes' couleurs, arciftement in.cruftés dans
un enduit de mortier frais, & arrangés de
manière à repréfenter des objets avec les couleurs
qui leur font propres : au défaut de
pierres ■ naturelles pour certaines couleurs, on
le fort de pierres artificielles , c’eft - à - dire,
de morceaux de verre colores au feu. Les voûtes
de l’égîife de Saint-Pierre de Rome font
peintes de cette manière.
Quoique ce travail deir mde un peu de fcien-
ce dans la peinture, il eiff.cependant facile de
juger que fon exécution eft plutôt un ouvrage
de patience que d’art. Il fau t, avant de commencer
, avoir tous les deflins au net de la
grandeur de l’ ouv rage-qu’on fe propofe , c eft-
i à-dire, des çartons comme pour la frefque 9
M O S
avec un tableau peint , foit en petit ,*foit en
gtand, pour fervir de modèle.
On range enfuite par ordre , dans des paniers
ou boëtes plates, toutes les petites pierres de
chaque teinte ,ou nuance d’une même coule
u r , & chacune de ces pierres doit avoir une
furface plate & unie ; c’eft celle qui doit être
expofée^ a la vue. Les autres côtés feront un
peu moins larges 8c un peu raboteux , afin
%ue Je>mortier dans lequel elles feront incruf-
tees ait prife fur eux. I l ne faut pas que lafur-
face plate^ & unie foit polie ni luifante. Elle
renechiroit la lumière trop vivement, & em-
pêcheroit d’ en voir la couleur. Plus les pierres
font(petites, plus l’ouvrage eft délicat; mais
le travail augmente à proportion, & l’exécution
en devient plus longue. Il n’eft pas né-
ceffaire que toutes les pierres foient de même
figure. I l fuffit qu’elles puiflent s’adapter exactement
les unes auprès des autres , de manière
qu’elles ne laiflent pas entr’elles de vuidetrop
fenfible. Il faut que l’ouvrage préfente la fur-
face la plus unie & la plus égale qu’ il fera
poflible, de manière qu’une pierre ne foie pas
plus faillante que l’autre. On commence par
faire fur le mur un premier enduit , comme
celui de la peinture à frefque. Lorfqu’il eft
fe c , on mouille un peu la place, fur laquelle !
on doit^ travailler, & l’on y pofe le defiin ,
ou on l’y marque par des cartons de même
grandeur , comme à la frefque. On met en-
fuite du mortier fait de chau x , de pierre
dure, ou de tuiles ou de briques pilées & ta-
mifées. Quelques-uns y ajoutent de l’eau gommée
avec de la gomme adragant & des blancs 4 <£uf battus. Ce mortier doit être fin , & mis
dune epaifleur égale fur chaque petite place,
fans palier le trait du deffin ; car il faut le
conferver, & placer les petites pierres fuivant
les couleurs, en les trempant dans le même
mortier, mais plus clair 8c plus liquide, qu’on
doit avoir auprès de foi dans une auge ou
jatte de bois.
Quand on a couvert de pierres un petit ef-
pace, U faut les battre avec une règle épaifle
& fo r te , pour les drefler & les enfoncer également,
à-peu-près comme les carreleurs font
quand ils çarrelent. Il faut avoir foin de faire
cette opération , pendant que le mortier eft
encore tout frais; autrement la liaifon ferom-
proit, & les petites pierres fe détacheroienc
du mortier.
Si l’on avoït^ quelque partie délicate à faire ,
çomme une têrg , une main ou autre çhofe
femblable , on pourroit avoir le trait de ces
parties .fait 3 l’energ fur du papier fin & huilé ,
Afin qu’ en l’ appliquant fur l’ouvrage tout frais
.on connût fi le deflin, n’ en ferdit pas altéré;
car on verroit l’ouvrage fait au travers
pu papier huilé: & s’ il.y. av.oit quelques dér
Meaux-Arts. Joute lï»
M O S
fauts , on pourroit les corriger avant que le
tout fût bien fec.
Si le mortier déborde un peu entre les joints
des pierres qu’ il faut rapprocher le plus qu’ il
eft poflible, on le ratifie avec la petite truelle
qui fert dans tout ce travail ; mais comme les
pierres le barbouillent toujours un peu de mortier*
& principalement en les dreflant avec la
rég lé , lorfque tout fera bien fec , on enlèvera
ce mortier le plus proprement qu’on pourra
avec un couteau ou une ratifloire ; enfin, on frottera
l’ouvrage avec un morceau de bois tendre
& du fable fin délayé dans de l’ eau. Gn lavera
enfuite l’ouvrage avec de l’eau pure , comme
on fait aux carreaux des appartemens ; ce qu’on,
appelle déc r o t e r .
Lorfque l’ouvrage eft fini, fi l’on a quelques
changemens à faire, on abat jufqu’au premier
enduit feulement, & on remplace par du mortier
& d’autres petites pierres, l’ouvrage démoli
& enlevé.
Pour dorer, dans cette efpèce de peinture ,
foit pour le fond du tableau , loit dans les or—
nemens, ou dans les draperiès, on prend des
morceaux de verre non colorés. On mouille
un coté, ayec de l’èku dé gomme ; puis on
y applique uue feuille d’or. On pofe après cèla
le morceau de verre fur une pelle de f e r , &
cette pelle à l'entrée d’un fourneau , après l’avoir
couvert de quelqu’autre morceau de verre concave.
On laiffe ainfi la p e lle , jufqu’à ce que
le morceau de verre où l’or eft appliqué foie
devenu rougé, & l’or y demeure fi bien appliqué,
qu’ il ne s’en détache plus. On applique
lur le mortier la lurface dorée. Ces petits mor*
ceaux de verre doivent être de la même grandeur
que les autres pierres colorées. Mais pour
décroter ces pièces de v erre, il faut feulement
les ratifier proprement avec un couteau & leg
laver enfuite ; car le fable le plus fin ternî-
roit la furface du verre, & le brillant de l’or
ne paroîtroit plus au travers.
Potir que ces morceaux dè verre coloré tiennent
bien au mortier, il faut que chaque morceau ait
au moins feize ou dix-huit lignes d’épaifleur : on
dégroflit les furfaces qui doivent toucher an
mortier , pour leur ôter le poli qui Içs empêche
de le happer.
I l faut faire faire ces morceaux de verra
exprès; pour çet effet, on va dans une verrerie ;
& quand le verre eft diftribué dans les diffé-
rens creufets , on y met la couleur propre à lui
donner les différentes teintes que l’on defire
On commence par la plus c la ire , & l’on aug*
mente toujours jufqu’à la plus foncée. Quand
le verre eft cuit dans fa perfe&ion, on prend
avec de grandes cuillers le verre tout rouge t
& on en fait des tas fur un marbre poli &
chaud, ou fur une plaque de cuivre , & on
applique egs tas aveç un autre marbre auflj