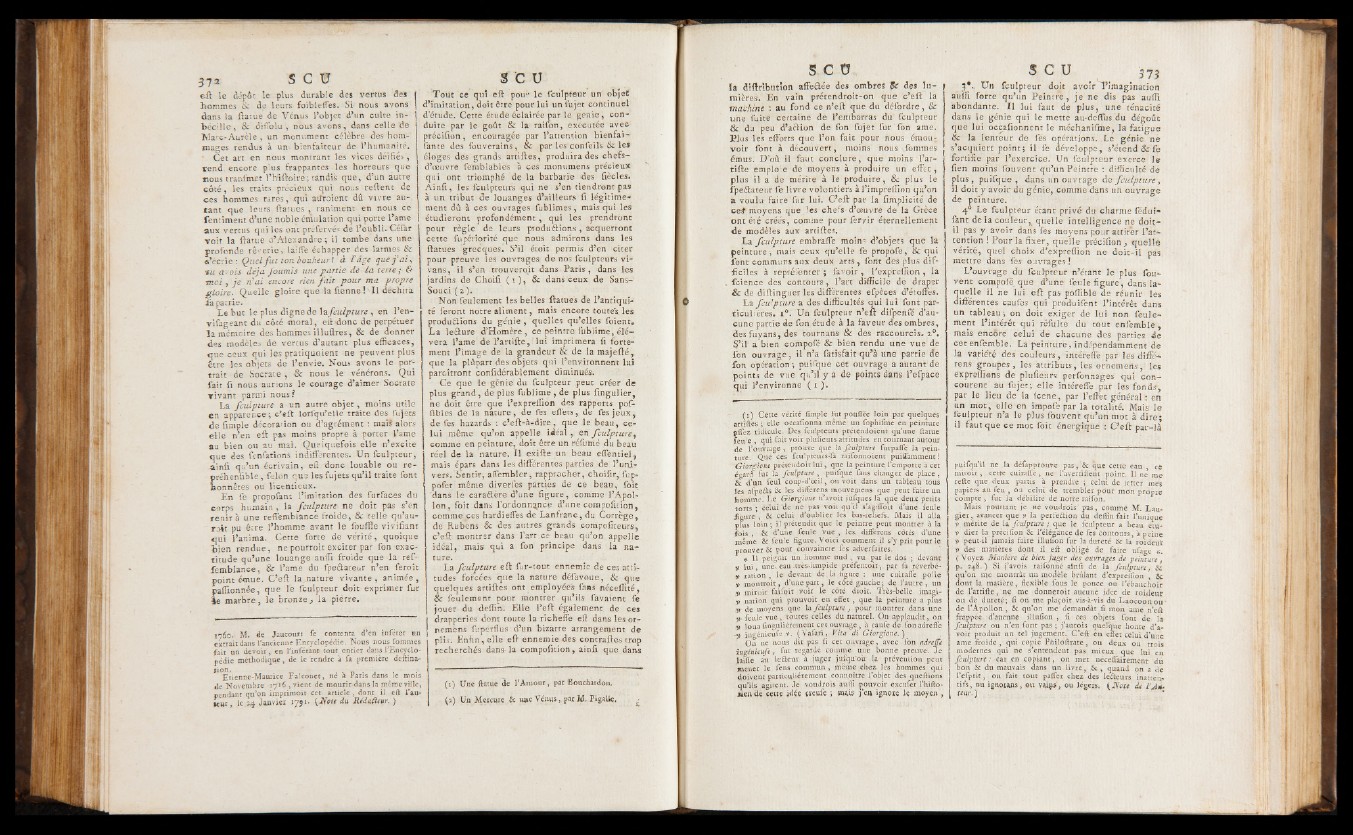
e ft le dépôt le plus durable des vertus des j
hommes & de leurs foibleffes. Si nous avons J
dans la ftatue de Vénus l’objet d’ un culte in- j
bécille , & diffolu , nous avons, dans celle de
Marc-Aurèle , un monument célèbre des hommages
rendus à un'- bienfaiteur de l’humanité.
• Cet art en nous montrant les vices déifies,
fend encore plus frappantes les horreurs que
nous tranlmet l’hiftoire; tandis que, d’un autre
c ô té , les traits précieux qui nous relient de
ces hommes rares, qui au'roient dû vivre au-,
tant que leurs lia tu es , raniment en nous ce
fentiment d’ une noble émulation qui porte l’âme
aux vertus qui les ont préfervé? de l’oübli. Céfar
voit la flatue d’Alexandre ; il tombe dans une
profonde rêverie, lai fie échapper dès larmes &
s’écrie : Quel fu t ton bonheur l à Tâge que f ai ,
tu avois. déjà fournis une partie de la terre ; &
moi , je n'ai encore rien fa it pour ma propre
gloire. Quelle gloire que la Tienne !XI 1 déchira
4a patrie.
Le but le plus digne de lafculpture , en l ’en-
vifageant du côté moral, eft donc de perpétuer
la mémoire des hommes illuftres,. & de donner
des modèles de vertus d’autant plus efficaces,
que ceux qui les pratiquaient ne peuvent plus
être les objets de l ’ envie. Nous avons le portrait
de Socrate , & nous le vénérons. Qui
fait fi nous aurions le courage d’aimer Socrate
vivant parmi nous?
La fculpture a un autre o b je t, moins utile
en apparence ; c’ eft lorfqu’ elle traite des fujets
de (impie décoradon ou d’agrément : mais alors
e lle n’ en eft pas moins propre à porter i ’ame
au bien ou au mal. Quelquefois elle n’excite
que des fenfations indifférentes. Un fculpteur,
ainfi qu’ un écrivain, eft donc louable ou re-
préhenûble, félon que les fujets qu’ il traite font
honnêtes ou licentieux.
En fe orepofant l’imitation des furfaces du
corps humain, la fculpture ne doit pas s’ en
tenir à une reftemblânce froide, & telle qu’aurait
pu être l’homme avant le fouffle vivifiant
qui l ’anima. Cette forte de v érité, quoique
Lien rendue, ne pourroit exciter par fon exactitude
qu’ une louange aufïi froide que la ref~
femblance, & l’âme du fpeâateur n’en feroit
point émue. C’ eft la ^nature vivante, animée,
paflionnée, que le fculpteur doit exprimer fur
l e marbre, le bronze., la pierre.
1760. M. de Jaucourt fe contenta d’en inférer un
extrait dans l’ancienne Encyclopédie. Nous nous fommes
fa it un devoir , en l’inférant- tout entier dans l’Encyclopédie
méthodique, de le fendre à fa première deftinaîl(>
Etienne-Mauïice Falconet, né à Paris dans le mois
Tout ce qui eft pour le fculpteur un objet
d’ imitation, doit être pour lui un fujet continuel
d’étude. Cette étude éclairée par le genie, conduite
.de Novembre 1716 , vient de mourirdans la même ville,
pendant qu’on imprimoit cet article , dont il eft l’au-
Jeur, le .24. Janvier 179j. {Note du Rédacteur.)
par le goût & la raifon, exécutée avec
précifion, encouragée par l’attention bienfai-
fante des fouverains, oc par les confeils & les
éloges des grands artiftes, produira des chefs-
d’oeuvre femblables à ces monumens précieux
qui ont triomphé de la barbarie des fiècles.
Ainfi, les fculpteurs qui ne s’en tiendront pas
à un tribut de louanges d’ailleurs fi légitimement
dû à ces ouvrages fublimes, mais qui les
étudieront profondément, qui les prendront
j pour règle de leurs productions, acquerront
I cette fupériorité que nous admirons dans les
ftatues grecques. S’ il étoit permis d’en citer
pour preuve les ouvrages de nos fculpteurs vi-
vans, il s’en trouveront dans Paris, dans les
jardins de Choifi ( 1 ) , & dans ceux de Sans-
Souci (2 ).
Non feulement les belles ftatues de l’antiquité
feront notre aliment, mais encore toute’s je s
produétions du génie , quelles qu’elles fuient.
La leéture d’Homère, ce peintre fublime, élé-
vera l’ame de l’artifte, lui imprimera fi fortement
l ’image de la grandeur 8c de la majefté,
que la plûpart des objets qui l’environnent lui
paraîtront confidérablement diminués.
Ce que le génie du fculpteur peut créer de
plus grand, de plus fublime, de plus fingulier,
ne doit être que l’expreffion des rapports pof-
fibles de la nature, de fes effets, de fe sjeux ,
de fes hazards : c’eft-à-dire, que le beau, ce*
lui même qu’on appelle idéal , en fculpture,
comme en peinture, doit être un réfumé du beau
réel de la nature. Il exifte un beau effentieJ,
mais épars dans les différentes parties de l ’ univers.
Sentir, affembler, rapprocher, choifir, fup-
pofer même diverfes parties de ce béau, foit
dans le caraélère d’une figure, comme l ’Apollon,
foit dans l’ordonnance d’une compoficion,
commences hardi effes de Lanfranc, du Corrège,
de Rubens & des autres grands compofïteurs,
c’eft montrer dans l’art ce beau qu’on appelle
idéal, mais qui a fon principe dans la nature.
La fculpture eft fur-tout ennemie de ces attitudes
forcées que la nature défavoue, & que
quelques arciftes ont employées fans néceflité,
& feulement pour montrer qu’ ils favaient fe
jouer du deflin. Elle l’eft également de ces
drapperies dont toute la richefie eft dans les or-
nemëns fu perdus d’un bizarre arrangement de
plis. Enfin, elle eft ennemie des contraftes trop
recherchés dans la compofition, ainfi que dans
(1) Une ftatue de l ’Amour , par Bouchardon.
(2) Un Mercure fc une Vénus, par M. Pigalle,
fa diftrîbutîon affeélée des ombres 8c des lu - l
mières, En vain prétendroit-on que c’eft la
machine : au fond ce n’eft que du défordre, &
une fuite certaine de l’embarras du fculpteur
& du peu d’aftion de fon fujet fur fon ame.
Plus les efforts que l’on fait pour nous émouvoir
font à découvert, moins nous .fommes
émus. D’où il faut conclure, que moins l ’ar- ,
tifte emploie de moyens à produire un e ffe t,
plus il a de mérite à le produire, 8c plus le
fpeélateur fe livre volontiers à l ’impreflion qu’on
a voulu faire fur lui. C’eft par la (implicite de
ce#^ moyens que les chefs d’oeuvre de la Grèce
ont été créés, comme pour fervir éternellement
de modèles aux artiftes.
La fculpture embraffe moins d’objets que la
peinture -, mais ceux qu’elle fe propofe, & qui
font communs aux deux arts, foitt des plus dif- .
ficîles à représenter ; favoir , rexpreflion , la
fcience des contours, l’art difficile de draper
& de diflinguer les différentes efpèces d’étoffes.
La fculpture a des difficultés qui lui foné particulières.
i° . Un fculpteur n’e ll difpenfé d’aucune
partie de fon étude à la faveur des ombres,
des fuyans, des tournans & des raccourcis-z0..
S’ il a bien compofé & bien rendu une vue de
fon ouvrage, il n’a fatisfait qu’à une partie de
fon opération ; puifqne cet ouvrage a autant de
points de vue qu’il y a de points dans l’efpace
qui l’ environne ( 1 ),
(1 ) Cette vérité fimple fut pouffée loin par quelques
artiftes ; elle occafionna même un fophifmc en peinture
pffez ridicule. Des fculpteurs prétendoient qu’une ftatue
leu’e , qui fait voir plune lus attitudes en tournant autour
de l’ouvrage , prouve que la fculpture furpafle la peinture.
Que ces fculpteurs-là raifonnoient puiffàmment !
Giorgione prête ado it 'lu i, que la peinture l’emporte à cet
égard fur la fculpture , puiique fans changer de place ,
jfcfj d’un feul coup-d’oe i l , On voit dans un tableau tous
les afpe&s & les différens mouvemens que peut faire un
homme. Le Giergione n’avoit jûfques là que deux petits
torts ; celui de ne pas voir qu’il s’agilfoit d’une feule
figure , Sç celui d’oublier les bas-reliefs. Mais il alla
plus loin ; il prétendit que le peintre peut montrer à l'a
fois , ôc d’une feule vue , les. différens côtés d’une
même & feule figure. Voici comment il s’y prit pour le
prouver ôc poux convaincre fes adverfaires.
« 11 peignit un homme n u d , vu par le dos ; devant
y lu i, une.eau .très-limpide préfentoit, par fa réverbé-
v ration , le devant de la figure : une cuiraffe polie
,) montroit, d’une part, le côté gauche; de l’autre , un
,) miroir faifoit voir' le côté droit. Très-belle imagi-
,) nation qui prouvoit en effet | que la peinture a plus
de moyens que la fculpture, pour montrer dans une
feule vue , toutes celles du naturel. On applaudit, on
V loua finguliérement cet ouvrage , à caufe de fonadreffe
*>) ingénieufe ». (Vafa ri, Vita di Giorgione. )
On ne nous dit pas fi cet onvrage, avec fon adrejfe
ingénieufe, fut regardé comme une bonne preuve. Je
laiffe au lefteur a juger jufqu'ou la prévention peut
mener le fens commun, même chez les hommes qui
doivent particuliérement connoître l’objet des queftions
qu’ils agitent. Je voudrois auflî pouvoir exeufer l’hifto-
jien de cette idée çieufe ; mais j’en ignoxe le moyen ,
ffiji Un fculpteur doit avoir l’imagination
aufïi forte qu’ un Peintre , je ne dis pas aufïi
abondante. Il lui faut de plus, une ténacité
dans le génie qui le mette au-deffus du dégoût
que lui occafionnent le méchant fine, la fatigue
8c la lenteur de fes opérations. Le génie ne
s’acquiert point; il fe développe, s’étend & fe
fortifie par l ’exercice. Un fculpteur exerce le
fien moins fouvent qu’un Peintre : difficulté dé
plus, puifque , dans un ouvrage de fculpture,
il doit y avoir du génie, comme dans un ouvrage
de peinture.
40 Le fculpteur étant privé du charme fédui-
fant de là couleur, quelle intelligence ne doit-
il pas y avoir dans fes moyens pour attirer l’attention
! Pour la fixer, quelle précifion., quelle
vérité, quel choix d’exprefïïon ne doit-il pas.
mettre dans fes ouvrages !
L’ouvrage du fculpteur n’étant le plus fou-
vent compofé que d’une feule figure, dans laquelle
il ne lui eft pas pofîible de réunir les
différentes caufes qui produifent l ’intérêt dans
un tableau; on doit exiger de lui non feulement
l’ intérêt qui réfulte du tout enfemble ,
mais encÔre celui de chacune des parties de
cet enfemble. La peinture, indépendamment de
la variété des couleurs, intéreffe par les différons
groupes, lés attributs, les ornemeris, les
exprefîions de plufiears perfonnages qui concourent
au fujet; elle intéreffe pat les fonds',
par le lieu de la feene, par l’effet général : en
un mot, elle en impofe par la totalité. Mais le
fculpteur n’a le plus fouvent qu’ un mot à dire;
il faut que ce mot foit énergique : C’eft par-là
puifqu’ il ne la défap prouve pas , & que cette eau ce
miroir, cette cuiraffe , ne l’avertiffent point. Il ne me
refte que deux partis à prendre celui de jetter mes
papiers au feu , ou celui de trémbler pour mon propre
compte , fur la débilité de notre raifon.
Mais pourtant je ne voudrois plis, comme M. Laugier
, avancer que » la perteétidn du deflin fait l’unique
» mérite de la fculpture ; que le fculpteur a beau étu-
» dier la précifion & l’élégance de fes contours, à peine
» peut-il jamais faire illufion fur la dureté Ôc la roideut
» des matières dont il eft obligé de faire ufage «.
( Voyez Manière de bien juger des ouvrages de peinture,
p. 248. ) Si j’avois raifonné ainfi de la fculpture, ôc
qu’on me montrât un modèle bruiant d’expreflion 8c
dont la matière, flexible fous le pouce ou i’ébauchoir
de l’artifte, ne me donneroit aucune idée de roideut
ou de dureté ; fi on me plaçôit vis-à-vis du Laoco on ou •
de l’Apollon , ôc qu’on me demandât fi mon ame n’eft
frappée d’aucune illu fio n , fi ces objets font de là
fculpture ou n’en font pas ; j’aurois quelque honte d’avoir
produit un tel jugement. C ’eft en effet celui d’une
ame froide , qui copie Philoftrate, ou deux ou trois
modernes qui ne s’entendent pas mieux que lui en
fciilptpre : ' c ar en copiant, on met néceffairement du
bon ôc du mauvais dans un..livre, ôc , quand on a de
l’e fprit, ou fait tout paffer chez des le&eurs inattentifs
, ou ignoxans, on yjûçs , ou légers. ( iVbre de VA**
teur. ) -,