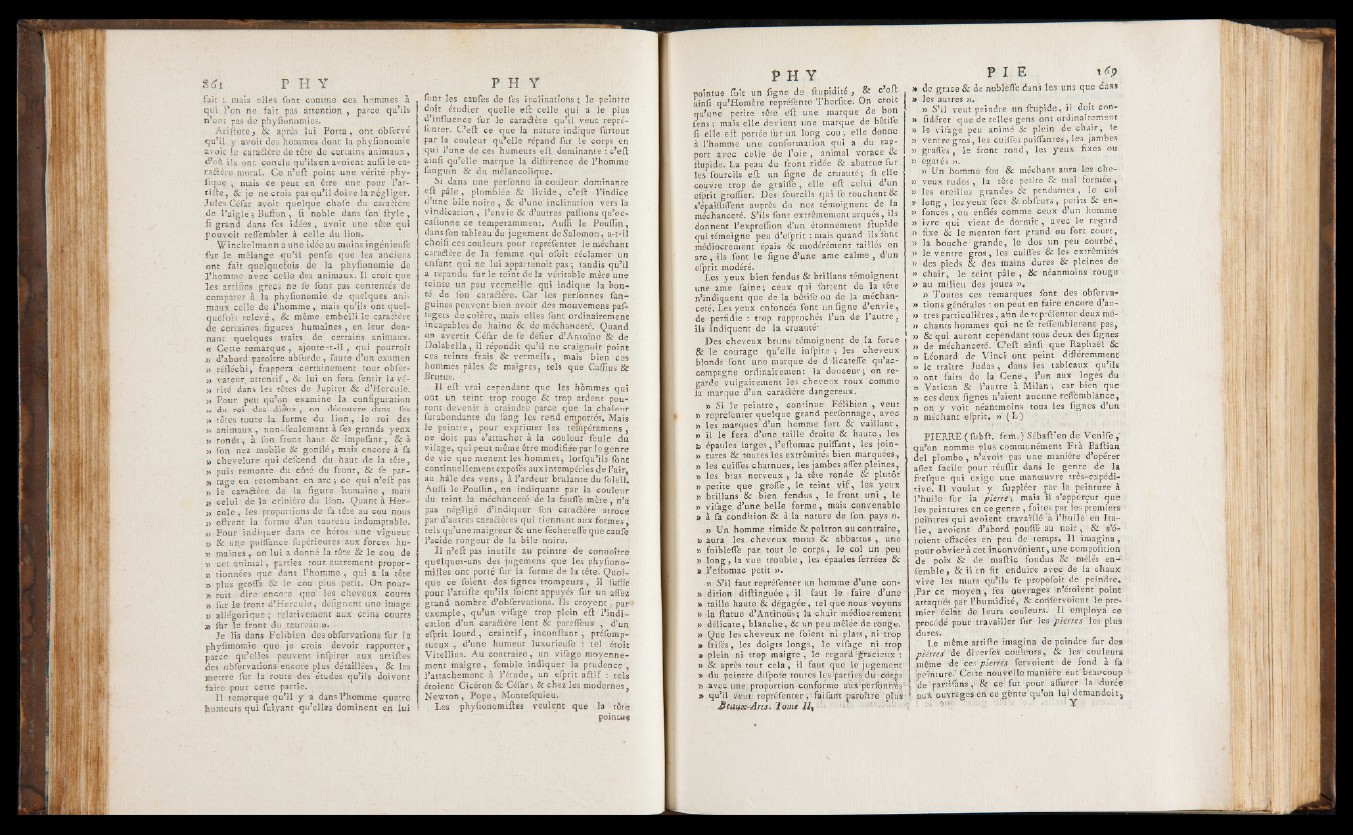
fait : maïs elles font comme ces Hommes a
qui l’on ne fait pas attention, parce qu’ ils
n’ont pas de^phyfionomies.
A riftote, & après lui Porta, ont obfervé
qu’il y avoit des hommes dont la phyfionomie
avoir le çaraâère de tête de certains animaux,
d’où ils ont conclu qu’ ils en avoient aufîileca-
raâère moral. Ce n’eft point une vérité phy-
fique , mais ce peut en être une pour l’ar-
tifte , & je ne crois pas qu’ il doive la négliger.
Jules Céfar avoit quelque choie du caiaélère
de l’aigle 5 Buffon , fi noble dans Ion' ftyle ,
fi grand dans fes idées , avoit une tête qui
pouvoir reffembler à celle du lion.
Winckelmann a une idée au moins ingçnieufe
fur le mélange qu’ il penfe que les anciens
ont fait quelquefois de la phyfionomie de
l ’homme avec celle des animaux. Il croit que
les artiftes grecs ne fe font pas contentés de
comparer à la phyfionomie de quelques animaux
celle de l’homme, mais qu’ils ont quelquefois
relevé ,■ 8a même embelli le cara&ère
de certaines figures humaines, en leur donnant
quelques traits de certains animaux.
« Cette remarque, ajoute-t-il, qui pourroit
» d’abord paraître abfurde, faute d’ un examen
» réfléchi, frappera certainement tout obfer-
» vateùr. attentif, & lui en fera fentir la vé-
» rité dans les têtes de Jupiter & d’HercuIe.
» Pour peu qu’on examine la configuration
» du roi des d ifu x , on découvre dans fes
î? têtes toute la forme du lion , le roi des
» animaux, non-feulement à fes grands yeux
» ronds, à fon front haut & impofant, & à
» fon nez mobile 8a gonflé, mais encore à fa
» chevelure qui defcend du haut de la tête,
» puis remonte du côté du front, & fe par-
» tage en retombant en arc ; ce qui n’eft pas
» le caractère de la figure Bumaine , mais
» celui de la crinière du lion. Quant à Her-
» eu le les proportions de fa tête au cou nous
» offrent la forme d’ un taureau indomptable.
» Pour indiquer dans ce héros une vigueur
» &. une puiffance fupérieures aux forces hu-
» maines, on lui a donné la tête & le cou de
» cet animal, parties tout autrement propor-
» tionnées que dans l’homme , qui a la tête
» plus greffe 8a le cou plus petit. On pour-r
7) roit dire encore que les cheveux courts
» fur le front d’HercuIe, défignent une image
» allégorique ; relativement aux crins courts
» fur le front du ^taureau ». -
Je lis dans Felibien des obfervations fur la
phyfimomie que je crois devoir rapporter,
parce qu’elles peuvent infpirer aux artiftes
des obfervations encore plus détaillées, & les
mettre fur la route des études qu’ils doivent
faire pour cette partie.
I l remarque qu’ il y a dans l’homme quatre
humeurs qui fuiyant qu’elles dominent en lui
font les caufes de fes inclinations ; le peintre'
doit étudier quelle eft celle qui a le plus
d’ influence fur le cara&ère qu’ il veut repré-
fenter. C’eft ce que la nature indique furtout
par la couleur qu’elle répand fur le corps en
qui l’une de ces humeurs eft dominante : c’eft
ainfi qu’elle marque la différence de l’homme
fanguin & du mélancolique.
Si dans une perfonne la couleur dominante
eft pâle , plomblée & liv id e , c’eft l’ indice
d’une bile noire , & d’une inclination vers la
vindication , l’envie & d’autres pallions qu’oc-
cafionne ce temperamment. Auffi le Poufîin,
dans fon tableau du jugement de Salomon, a-t-il
choifi ces couleurs pour repréfenter le méchant
caractère de la femme qui ofoit réclamer un
enfant qui ne lui appartenoit pas ; tandis qu’il
a répandu fur ie teint de la véritable mère une
teinte un peu vermeille qqi indique la bonté
de fon cara&ere. Car les perfonnes fan-
guines peuvent bien avoir des mouvemens paf*
i’agers de colère, mais elles font ordinairement
incapables de haine & de méchanceté. Quand
op avertit Céfar de fe défier d’Antojne & de
Dolafcella, il répondit qu’ il ne craignoit point
ces teints frais 8a vermeils, mais bien ces
hommes pâles Sa maigres, tels que Caflîus 8ç
BrutuS. 14 eft vrai cependant que les hommes qui
ont un teint trop rouge 8a trop ardent pou-
ront devenir à craindre parce que la chaleur
furabondante du fan g les rend emportés. Mais
le peintre, pour exprimer les tempéramens ,
ne doit pas s’ attacher à la couleur feule du
' vifage, qui peut même être modifiée par le genre
de vie que mènent les hommes, lorfqu’ils font
continuellement expofés aux intempéries de l’air,
au hâle des vens, à l’ardeur brûlante du foleil.
Àufîi le Pouffin, en indiquant par la couleur
du teint la méchanceté de la fauffe mère, n’a
pas négligé d’ indiquer fon çara&ère atroce
par d’autres caractères qui tiennent aux formes ,
tels qu’une maigreur & une féchereffe que caufe
l’acide rongeur de la bile noire.
I l n’eft pas inutile au peintre de comioître
quelques-uns des jugemens que les phyfiono-
miftes ont porté fur la forme de la tête. Quoique
ce foient des lignes trompeurs , il fuffic
pour l’ artifte qu’ ils foient appuyés fur un affez
grand nombre d’obfervations. Ils croyent, par -
exemple, qu’un vifage trop plein eft i’ indi-
cation d’un caractère lent & pareffeux ," d’uq
efprit lourd, c raintif, inconftant , préfomp-
tueux , d’une humeur luxurieufe : tel étoit
Vitellius. Au contraire, un vifage moyennement
maigre, femble indiquer la prudence ,
l ’attachement à l’étude, un efprit aéfif : tels
étoient Cicéron & Célar -, & chez les modernes,
Newton, Pope, Montefquieu.
Les phyfionomiftes veulent que la tète
pointu?
P H Y
pointue fait un figne de ftupidité , & c’eft
ainfi qu’Homère repréfente Therfite. On croit
qu’une petite tête eft une marque de bon
fens *, mais elle devient une marque de bêtife
fi-elle eft portée fur un long cou; elle donne
à-l’homme une conformation qui a du rapport
avec celle de l’oie , animal vorace &
ftupide. La peau du front ridée 8a abattue fur
les fourcils eft un figne de cruauté; fi elle
couvre trop de graiffe, elle eft celui d’un
efprit grofner. Des fourcils qui fe touchent &
s’épaifliffent auprès du nez témoignent de la
méchanceté. S’ils font extrêmement arqués, ils
donnent l’expreffion d’un étonnement ftupide
qui témoigne peu d’ efprit : mais quand ils font
médiocrement épais 8a modérément taillés en
a rc , ils font le figne d’une ame calme , d’un
efprit modéré.
Les yeux bien fendus & brillans témoignent
une ame faine; ceux q îi fortent de la tête
n’ indiquent que de la bêtife ou de la méchanceté.
Les yeux enfoncés font un figne d’envie,
de perfidie : trop rapprochés l’ un de l’ autre,
ils indiquent de la cruauté*
Des cheveux bruns témoignent de la force 1
& le courage qu’elle infpir.e ; les cheveux
blonds font une marque de dilicateffe qu’accompagne
ordinairement la douceur; on regarde
vulgairement les cheveux roux comme
la marque d’ un cara&ère dangereux.
» Si le peintre, continue Félibien , veut
» repréfenter quelque grand perfonriage, avec
» les marques d’un homme fort 8a vaillant,
» il le fera d’une taille droite 8a haute, les i
épaules’ larges, l’eftomac puiffant, les join- 1
» tures & toutes les extrémités bien marquées,
» les çuiffes charnues, les jambes affez pleines,
» les bras nerveux , la tête ronde Sa plutôt
» petite que groffe , le teint v i f , les y e u xN
» brillans 8a bien fendus , le front uni , le
» vifage, d’une belle forme, mais convenable
ÿ à fa condition & à la nature de fon. pays ».
» Un homme timide & poltron au contraire,
» aura les cheveux mous 8a abbattus , une
».foibleffe par tout le corps., le col un peu
» lon g, la vue trouble , les épaules ferrées 8a
» l ’eftomac petit ».
» S’ il faut repréfenter un homme d’une con-
» dition diftinguée ; il faut le faire d’unè '
» taille haute;& dégagée, tel quo nous voyons
» la ftatue d’Antinous; la chair médiôcrenient
» délicate, blanche, & un peu mêlée de rouge.
» Que leschèveux ne foient ni plats, ni trop
» frifés, les doigts longs, le vifage ni trop
» plein ni trop maigre, le regard gracieux :
» & après tout c e la , il faut que le jugement'
» du peintre difpoië toutes lesiparties-dü-c'ôrps
» avec une; proportion conforme a‘u iJpèrfbnh,esf
j» qu’ il veut; repréfenter ,: faifarît paroîtrë plus1
ÿ c a y ,o s -A n s . T o m e //,
P I E
» de grâce 8a de nobleffe dans les un? que dans
» les autres ».
» S’ il veut peindre un ftupide, il doit con-
» fidérer que de telles gens ont ordinairement
» le vifage peu animé 8c plein de chair, le
» ventre gros, les cuiffes puiffantes, les jambes
» graffes , le front rond, les yeux fixes ou
» égarés ». - ;
» Un homme fou 8c méchant aura les che-
» veux rudes , la tête petite 8a mal formée ,
» les oreilles grandes & pendantes, le col
» long , les yeux fecs 8a obfcurs, petits 8a en-
» foncés , ou enflés comme ceux d’ un homme
» ivre qui viént de dormir , avec le regard
i» fixe 8a le menton fort grand ou fort court,
» la bouche grande, le dos un peu courbe,
» le ventre gros, les cuiffes 8a les extrémités
» des pieds 8c des mains dures 8a pleines de
» chair, le teint pâle , & néanmoins rouge
» au milieu des joues ».
» Toutes ces remarques font des obferva-
» tions générales on peut en faire encore d’au-
» très particulières , ann de repréfenter deux mé-
» chants hommë? qui ne fe reffembleront pas,
» & qui auront cependant tous deux des fignes
» de méchanceté. C’eft ainfi que Raphaël 8c
» Léonard de Vinci ont peint différemment
» le traître Judas , dans les tableaux qu’ ils
.» ont faits de la C en e , l’ un aux loges du
i » Vatican & l’autre à Milan ; car bien que
» ces deux fignes n’aient aucune reffemblance,
» on y voit néanmoins tous les fignes d’un
» méchant efprit, » ( L )
PIERRE (fubft. fem>) Sébaft’en de V enife ,'
1 qu’ on nomme plus communément Frà Baftian
del piombo, n’avoit pas une manière d’opérer
affez facile pour réufîir dans le genre de la
frefque qui exige une manoeuvre très-expéditive.
Il voulut y fuppléer par la peinture à
l’huile: fur la pierre ; mais il s’appéfçut que
les peintures en ce genre , Mvjàf- par les premiers
peintres qui avoient travaille à l’huilé en Ital
i e , avoient d’abord pouffé au noir, & s*é-
toient effacées en peu de temps. I l imagina,
pour obvier à cet inconvénient , une compofition
de poix & de maftic fondus & mêlés en--
femble, & ilën fit enduire avec de la chaux
.vive les ïriurs ‘qu’ ils fe propofoit de peindre,
,Par cé moyen , fes ouvrage? n’étoient' point
attaqués par l’humidité, & corifervôient le premier
éclat de leurs couleurs. Il employa ce
procédé pour travailler fur les pierres Tes plus
dures.
Le même artifte imagina de peindre fur des
pierres de dîverfés couleurs, & le s 1 couleurs
mêhie *de ces pierres fervoîent de fond à fa
peinture? CëVtë nouvelle maniéré èut'beaucoup
i de'parVifànS & eë- fut ' pour afftirer: la ‘durée
! au"i ouvrages en ce gènre qu’on lui dëmandoit^