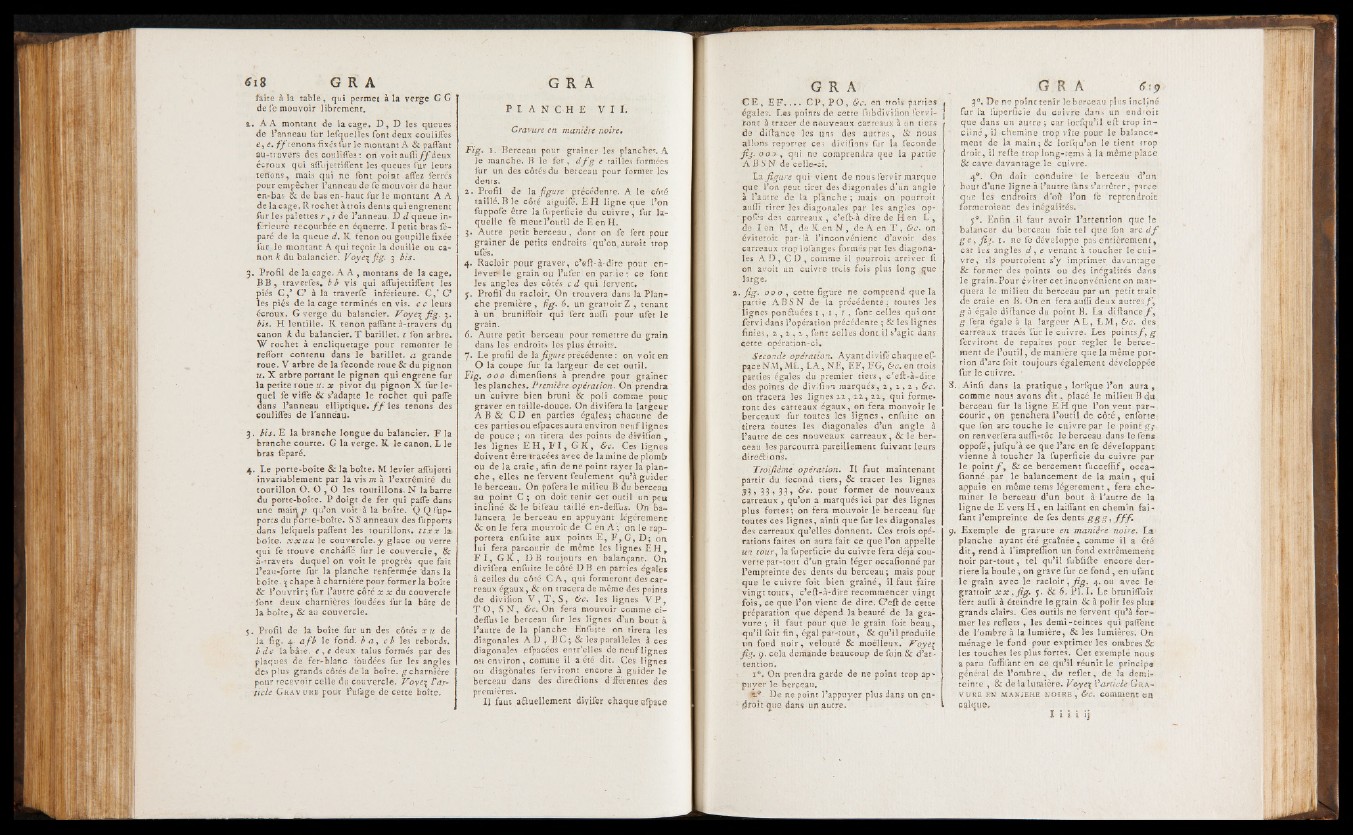
fa ite à la ta b le , q u i perm et à la v er g e G G
d e le m o u v o ir lib rem en t.
a . A A m ontan t d e la ç a g e . D , D les queues
d e l’anneau fur le fq u e lle s fon t d eux co u liffes e, e . f f ten on s fixés fur le m ontant A & partant
au -travers des co u lifles : ori v oit aurti f f deux
é cro u x q u i aflu jettifien t les q u eu es fur leurs
te n o n s, m ais q u i ne fon t point allez ferrés
pour em p êcher l’anneau de fe m o u v oir d e hau t
en -b a s & d e bas en -h a u t f u r ie m o n ta n t A A
d e la ca g e . R roch et à trois d en ts q u i en g ren en t
fur les p alettes r , 7 de l’anneau. D d q u eu e in férieure
recou rb ée en équ erre. I p etit bras fé -
paré d e la q u eu e d. K ten on ou g o u p ille fix ée
fur le m o n ta n t A qu i reçoit la d o u ille ou ca n
o n k du b a la n cier. Voye^fig. 3 bis.
3 . P ro fil de la ca g e. A A , m on tan s d e la ca g e.
B B , traverfes. b b v is qui a flu jettiflen t les
p ies C ,’ C* à la traverfe in férieu re. C ,’ C ’
le s piés d e la c a g e term in és en v is . c c leurs
écrou x . G v erg e du b a la n cier. Foye\ fig. 3.
bis. H le n tille . K te n o n partant à-travers du
can on k du b a la n cier. T b a rillet, t fon arbre.
yff ro ch et à e n c liq u e ta g e pour rem onter le
reflorr co n ten u dans le b a rillet, a gran d e
ro u e. V arbre de la féco n d é roue & du p ign on
u. X arbre portant le p ig n o n q u i en g ren e fur
la p etite rou e u. x p iv o t du p ig n o n X fur le -
u el fe v ifle & s’adapte le r o c h e t q u i parte
ans l’anneau e ll ip t i q u e .// “les ten on s des
cou lirtes d e Panneau.
3 . bis. E la b ra n ch e lo n g u e du b a la n cier. F la
branch e co u rte. G la v er g e . K le can on . L le
bras féparé.
4. L e p o r te -b o îte & la b o îte . M lev ie r aflujetti
in va ria b lem en t par la v is m à l’ex trém ité du
to u r illo n O . O , O le s to u rillo n s. N la barre
du p orte-b o îte. P d o ig t d e fer q u i parte dans
u n e m a in /7 qu’on v o it à la b o îte . Q Q fu p -
porcs du p o rte-b o îte. S S anneaux des fupports
dans lefq u els partent les to u rillo n s, t t x x la
b o îte , x x u u le c o u v e r c le .y g la c e ou verre
q u i fe trou v e enchârte fur le c o u v e r c le , &
à-travers d uq u el o n v o it le progrès q u e fait
l’eau -forte fur la p la n ch e renferm ée dans la
b o îte , 3: chape à ch arn ière pour form er la b o îte
& l’o u v r ir; fur l’autre côté x x du co u v ercle
fon t d eu x ch arn ières fou dées fur la bâte de
la b o îte , & au c o u v e r c le . 5
5 . Profil de la boîte fur un des côtés x u de
la fig. 4. a fb le fond, b a , c b les rebords. b de la bâte, e , e deux talus formés par des
plaques de fer-blanc foudées fur les angles
des plus grands côtés de la boîte, g charnière
pour recevoir celle du couvercle, Voye\ Varticle
Gravure pour l’ufage de cette boîte.
P l A N C H E V I I ' .
Gravure en manière noire.
Fig. 1. B erceau pour grain er les plancher. A
le m a n ch e. B le f e r , d f g e tailles form ées
fur un des cô tés du b eicea u pour form er les
d en ts.
а . P rofil d e la figure p récéd en te. A le côté
ta illé . B le côté aigu ife. E H lig n e q u e l’o n
fu p p ofe être la fu perficie du c u iv r e , fur la q
u e lle fe m eu t l ’o u til d e E en H .
3. A u tre p etit b e r c e a u , dont on f e fert pour
g ra in er d e p etits en d roits ‘ q u ’on, auroit trop
ufés.
4 . R a clo ir pour g ra v er, c’eft-à -d ire pour en le
v e r le „grain ou l’ufer en p a n ie : c e fo n t
les a n g le s d es cô tés c d q u i ferv en t.
5. P rofil du racloir. O n trouvera dans la P la n c
h e p rem ière , fig. 6 . un grattoir Z , ten an t
à un brunirtoir q u i 1ère aurti pour ufer le
grain .
б . A u tre p etit berceau pour rem ettre du grain
dans le s en d roits les plus étroits.
7 . L e profil de la figure précédente : on v o it en
O la cou p e fur la largeu r d e cet o u til.
Fig. 000 dim en fion s à prendre pour g ra in er
les p la n ch es. Première opération. On prendra
u n c u iv r e b ien bruni & p o li com m e pour
g ra ver en ta ille-d o u ce. On divifera la largeu r
A B & C D en parties é g a le s; ch a cu n e d e
ces parties o u efp aces aura en viron n e u f lig n es
d e p ou ce ; on tirera des points de d ivifio n ,
le s lig n e s E H , F I , G K , Oc. C es lig n e s
d o iv e n t être tracées a vec de lam in e d e plom b
ou d e la c r a ie , afin d e n e poin t rayer la planc
h e , e lle s n e ferven t feu lem en t qu ’à gu id er
le b erceau . O n pofera le m ilieu B du b erceau
au p o in t C ; o n d o it ten ir cet o u til un peu
in c lin é & le bifeau ta illé en-dertus. On balan
cera le b erceau en appuyant lég èrem en t
& on le fera m ou voir d e C en A ; o n le rapportera
en fu ite aux points E , F , G , D ; o n
lu i fera parcourir d e m êm e les lig n e s E H ,
F I , G K , D B tou jours en balan çan t. O n
d ivifera en fu ite le cô té D B en parties éga les
à c e lle s du côté C A , q ui form eront des carreaux
é g a u x , & on tracera d e m êm e des points
de d ivifio n V , T , S , Oc. les lig n e s V P ,
T O , S N , Oc. On fera m ou voir com m e c i-
deflus le b erceau fur les lig n e s d’un b ou t à
l ’autre d e là p lan ch e. E n fu ite on tirera les
d iag on a les A U , B C ; & les p a rallèles à ces
d iagon ales efpacées en tr’ell es d e n e u f lig n e s
ou en v iron , com m e il a été d it. C es lig n e s
ou d iag on a les ferviron t encore à gu id er le
berceau dans d es d ireétion s d fFéientes des
prem ières.
U fau t a ctu ellem en t d iyifer ch a q u e efpace
C E , E F . . . ; C P , P O , Oc. en trois parties
é g a le s. Les points de c ette fu b d ivifio n Pervi-
ront à tracer de n o u vea u x carreaux à un tiers
d e d ifta n ce les uns des a u tr e s , & nou s
a llo n s r e p o se r ces d ivifio n s far la fécon d é
fig,. 0 0 9-, qui, ne com prendra q u e la partie
A B S N d e c e lle -c i.
La figure q u i-v ie n t d e nous fervir m arque
q u e l’on peut tirer des d iagon ales d ’un a n g le
à l’autre d e la p lan ch e ; m ais o n pourroic
aurti tirer les d iag on a les par les a n g les o p -
pofés des carreaux , c’eft-à di’re de H en L ,
d e I en M , de K en N , de A en T , Oc. on
év itero it par-là l’in co n v én ien t d’avoir d es
carreaux trop lo fan ge s form és par les d iag on a les
A D , C D , com m e il pourroic arriver fi
on avo it un cu ivre trois fo is plus lo n g que
large.
a. fig. 000 , c ette figure n e com prend q u e la
partie A B S N d e la précéd en te: tou tes les
lig n e s ponCtuées 1 , 1 , r , fon t c e lle s q ui on t
fe r v i dans l’opération précédente ; & les lig n es
fin ie s, a , a , z , fon t c e lle s don t il s’a g it dans
cette opération-ci-.
Seconde opération. A y a n t d ivifé c h a q u e e fpace
N M , M L , L A , N E , E F , F G , Oc. en trois
parties éga les du prem ier tie r s , c ’eft-à -d ire
d es points d e d ivifio n m a rq u és, a , a , a , Oc.
on tracera les lig n e s aa , a a , a a , q u i form eron
t des carreaux ég a u x , on fera m o u v oir le
b erceau x fur to u tes les lig n e s , en fu ite on
tirera tou tes les d iag on a les d’un a n g le à
l’autre d e ces n o u v ea u x ca rrea u x , & le berceau
les parcourra p a reillem en t fu iv a n t leu rs
d irection s.
Troijième opération. I l fau t m a in ten an t
partir du fécon d tie r s, & tracer le s lig n e s
3 3 , 3 3 , 3 3 , Os. pour form er d e n o u vea u x
carreaux , qu’on a m arqués ic i par d es lig n es
p lu s fo r te s; on fera m o u v oir le b erceau fur
tou tes ces lig n e s , ain fi q u e fur les d iag on a les
des carreaux qu’e lle s d on n en t. C es trois opération
s faites on aura fait c e q u e l’on a p p elle un tour, la fu p erficie du c u iv r e fera déjà co u v
erte par-tout d’un grain lég e r occafion n é par
l’em preinte des d en ts du b ercea u ; m ais pour
q u e le cu iv re fo it b ie n grain e , il fau t faire
v in g t to u rs, c’eft-à -d ire recom m en cer v in g t
fo is , ce q u e l’on v ien t d e d ire. C ’eft d e ce tte
préparation q u e dépend la beauté d e la gravu
re ; il fau t pour q u e le g rain foit b ea u ;
q u ’il foit fin , éga l par-tou t, & q u ’^1 produite
tin fon d n o ir , v elou té & m o elleu x . Foye[
fig. 9 . c e la dem ande beaucoup d e foin & d’atte
n tio n .
i ° . O n prendra garde d e n e p o in t trop appuyer
le b erçeau.
æ*. D e n e point l’appuyer plus dans un gn-
jlroit q u e dans un autre.
3 °. D e n e p o in t ten ir le b erceau plus in c lin é
fur la fu p erficie du c u iv r e clans un en d ro it
q u e dans un autre ; car lorfq u ’il e ft trop in -
■ c iin é , il ch em in e trop vîce pour l e b a la n cem
en t d e la m ain ; & lorfq u ’on le tie n t trop
d ro it, il refte trop lon g -rem s à la m êm e p lace
& c a v e d a v a n ta g e le cu iv re.
4®. O n d o it co n d u ire le b erceau d’un
b ou t d’u n e lig n e à l’autre fans s’a rrêter, parce
q u e les en d ro its d ’où l ’on fe reprendroit
form eroien t d es in é g a lités. '
50. E n fin -il faur a v o ir l ’a tten tio n q u e le
b a la n cer du berceau foit tel q u e fon arc d f
g c , fig. 1. n e fe d év elo p p e pas e n ticrem en r,
car le s a n g les d , e v en an t à to u ch er le c u iv
r e , ils pourroient s’y im prim er d avan tage
& form er d es points ou des in ég a lités dans
le g ra in . Pour év ite r c e t in co n v én ien t on marquera
le m ilieu du berceau par un p etit traie
de craie en B. O n en fera aufli d eu x autres /',
g à ég a le d ifta n ce du p o in t B . La d if ta n c e /“,
g fera é g a le à la largeu r A L , L M , Oç. d es
carreaux tracés fur le cu iv re. Les p o in ts /’, g
ferviron t d e repaires pour regler le b e r c e m
en t de l’o u til, d e m an ière q u é la m êm e portio
n d’arc foit tou jours é g a lem en t dévelop p ée
fur le cu iv re. •'
S. A in fi dans la pratique , lorfq u e l’on aura ,
com m e nous avon s d i t , p lacé le m ilieu B d u
b erceau fiir la lig n e E H q u e l’on v eu t p a r -,
c o u r ir , on p en ch era l’o u til d e cô té , en forte ,
q u e fon arc to u ch e le c u iv re par le p o in t g ;
o n renverfera au fli-tôc le berceau dans le fen s
o p p ofé, jufqu’à ce q u e l ’arc en fe d év elop p an t
v ie n n e à tou ch er la fu p erficie du cu iv re par
le p o in t /’, & c e b ercem en t fu c c e flif, o cc a fionné
par le b a la n cem en t de la m ain , q u i
appuie en m êm e tem s lé g è r em e n t, fera c h e m
in er le berceau d’un bou t à l’autre d e la
lig n e d e E vers H , en lairtant en ch em in fa i-
fan t l’em p rein te d e fes d en ts g g g , f f f»
9. E x em p le d e gravu re en manière noire. La
p lan ch e a ya n t été graîn ée , com m e il a été
d it , rend à l'im prem on un fon d extrêm em en t
n oir p a r -to u t, te l qu’il fu b fifte en core d errière
la b o u le ; on g ra vé fur c e fo n d , en ufant
le grain a v e c le r a c lo ir , fig . 4. ou a v ec le
grattoir x x , f i g . 5. & 6 . P L I . L e b ru n iflois
fert aurti à étein d re le g rain & à p olir les plus
grands clairs. C es o u tils n e ferven t q u ’à fo r m
er les reflets , les d em i-te in te s q u i partent
d e l ’om bre à la lu m ièr e , & les lum ières. O n
m én a g e le fon d pour exp rim er les om bres &
les to u ch es les plus fo rtes. C e t exem p té nous
a paru fuffilant en ce q u ’il réu n it le principe
gén érai d e l’o m b r e , du r e fle t, d e la demi?
te in te , & de la lum ière. Veye% Marticle G r a vu
r e kn manière no ir e , Oc. com m en t e n
c a lq u e,
I
I i i i ij