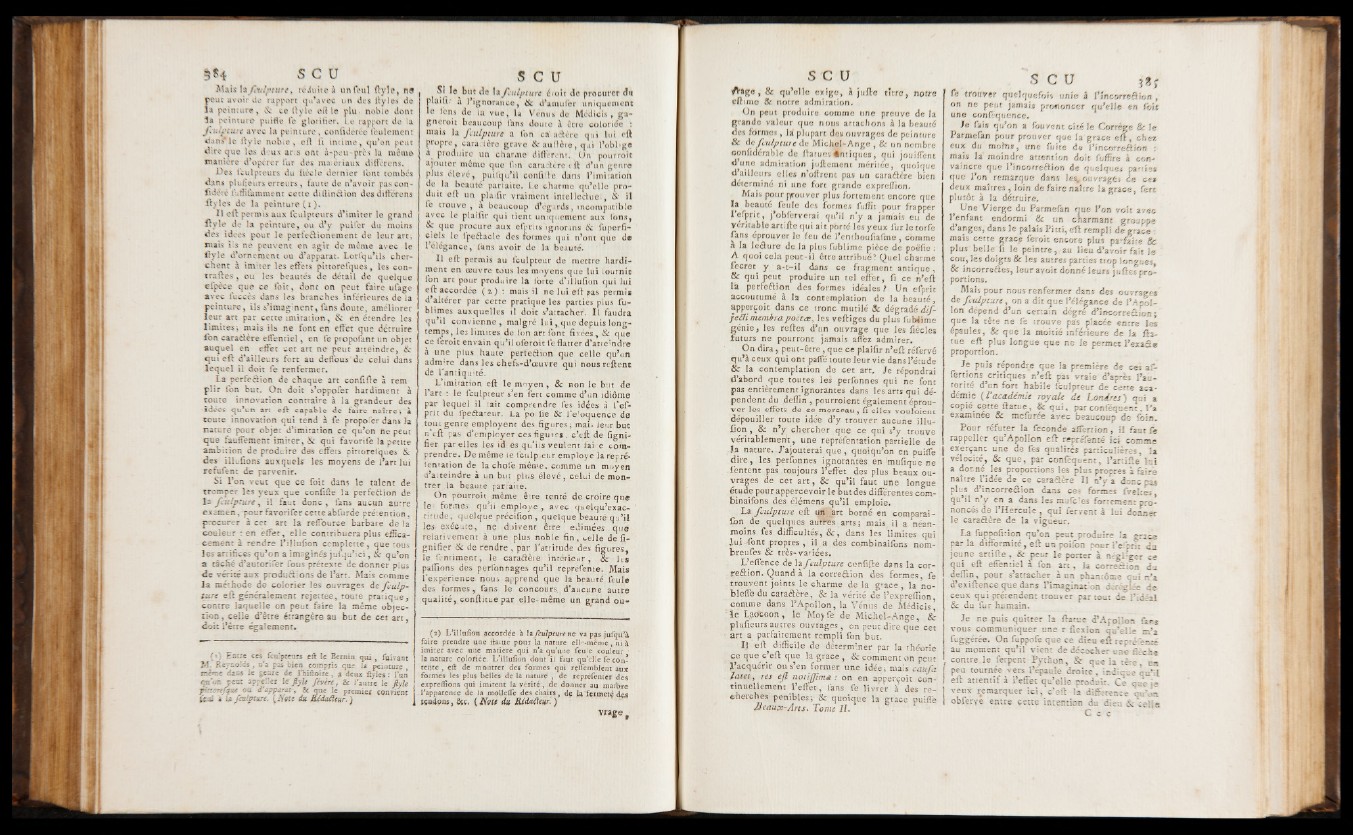
5*4 S C U
Mais laJiv/pture t .réduite à unfeul fty le , ns
peut avoir d© rapport qu’avec un des ftylês de
la peinture, & ce ftyle eft le plu. noble donc
la peinture- puifle le glorifier. l.e rapport do la
JctiWtttre avec la peinture, eonfideree (eulemenc
dans le fty le nob le3 eft fi intime, qu’on peut
dire que les deux ar.s ont à-peu-près la même
manière d’operer fur des matériaux ditterens.
Des Iculpteurs du liée 1 e dernier font tombés
dans pluijeurs erreurs, faute de n’avoir pas confédéré
fuffilamment cette dülin&ion des différons
Ifyles de la peinture ( i ) .
I l ou permis aux Iculpteurs d’ imiter le grand
I fy le de la peinture, ou d’ y puilcr du moins
des idées pour le perteâionement de leur art,
mais iis ne peuvent en agir de même avec le
ily le d’ornement ou d’apparat. Lorlqu’ ils cherchent
à imiter les effets pittorefques, les contraires
, ou les beautés de détail de quelque
efpèce que ce (bit, donc on peut faire ufage
avec tucces dans les branches inférieures de la
peinture, ils s’ imaginent, fans doute, améliorer
leur art par cette imitation, & en étendre les
limites ; mais ils ne font en effet que détruire
l'on caracière effentiel, en le propofant un objet
auquel en effet cet art ne peut atteindre, &
qui eft d’ailleurs fort au deflous de celui dans
lequel il doit le renfermer.
l a perfe&ion de chaque art confifte à rem
plir ion but. On doit s’oppoler hardiment à
toute innovation contraire à la grandeur des
idées qu’ un art eft capable de faire naître-, à
toute innovation qui tend à fe propofer dans la
nature pour objet d’imitation ce qu’on ne peut
que faufTement imiter, & qui favorite la petite
ambition de produire des effets pittorefques &
des illufions auxquels- les moyens de l’art lui
refui en e de parvenir.
Si l ’on veut que ce foit dans le talent de
tromper les yeux que confifte la perfection de
la fculpturc, il faut donc, (ans aucun autre
examen, pour favorifer cette abfurde prétention,
procurer à cet art la reflource barbare de la
couleur : en effet, elle contribuera plus efficacement
à rendre l’ illufion complétée, que tous
les artifices qu’ on a imaginés jufqu’ ic i, & qu’on
a tâche d’autorifer fous prétexte de donner plus
de vérité aux productions de l’art. Mais comme 3a méthode de colorier les ouvrages de fculp-
turc eft généralement rejettée, toure pratique,
contre laquelle on peut faire la même objection
, celle d’ être étrangère au but de cet a r t ,
doit l’être également.
( t) Entre ces fcnlpteors eft le Bernin qui } fuivant
M- Reynolds, n’a pas bien compris que la peinture ,
même dass le genre de fhifloire, a deux ftyles : l’un
qn on vent appeler le fiyle févire, & l’autre le ftyle
fizzcTtfqiu ou d'apparat, & que le premier convient
Uai a la fculpturc. {Ifetc du Eldaftcur. )
S C U SI le but do îa fculpturt école do procurer du
piaille à l’ ignorance, de d’atuufer uniquement
le Ions de la vue, la Vénus do Mcdicis, ga-
gneroit beaucoup (ans doute à être coloriée !
«*ais la fculpture a Ion ca‘ aâère qui lui eft
propre, caractère grave &: au (1ère, qui l’ obii g®
à produire un charme diffèrent. On pourroit
ajouter même que fon caractère if t d’ un genre
plus élevé, puifqu’ il confilte dans l’ imitation
do la beauté parfaite. Le charme qu’ elle produit
eft un plaifir vraiment intelleèluei, & il
le trouve, a beaucoup d’égards, incompatible
avec le plaifir qui tient uniquement aux Ions,
& que procure aux efprlts ignorons & fuperfi-
ciels le tpeâacle des formes qui n’ont que de
1 élégance, lans avoir de la beauté.
Il eft permis au fculpteur de mettre hardiment
en oeuvre tous les moyens que lui lournic
fon arc pour produire la forte d’ illufion qui lui
eft accordée ( a ) : mais il ne lui eft pas permis
d’altérer par cette pratique les parties plus fu-
blimes auxquelles il doit s’attacher. Il faudra
qu’ il convienne, malgré lu i , que depuis longtemps,
les limires de l’on art font fixées, & que
ce feroit envain qu’il oferoit le flatter d’atrerndre
a une plus haute perteâion que celle qu’on
admire dans les chefs-d’oeuvre qui nous reftent
de fantiqu«té.
L imitation eft le moyen , 8c non le but de
1 art : le fculpteur s’en ferc comme d’ an idiome
par lequel il tait comprendre fes idées à l’ef-
prit du fpeâa-eur. La po fie & l’e'oquence de
tout genre employent des figures j mai;, leur but
n’ eft pas d’employer ces figures . c’eft de lignifier
par elles les id es qu’ ils veulent faire comprendre.
De même le fculpteur employé la r'epré-
tentation de la choie même, comme un moyen
d’atteindre à un but plus é le vé , celui de montrer
la beauté parfaite.
On pourroit même être tenté de croire que
le ; formes qu’ii employé , avec quelqu’exac-
titude, quelque précifion , quelque beauté qu’ il
les exécute, ne doivent être edi niées . que
relativement à une plus noble fin, celle de lignifier
& de rendre , par ] attitude des figures,
le fenrimer.t, le caraâère intérieur, & les
pallions des perfonnages qu’ il repréfente. Mais
l’expérience nous apprend que la beauté feule
des formes, fans le concours, d’aucune autre
qualité, conftitue par elle-même un grand ou*
(2) L’illufion accordée à la fculpture no va pas jufqii’à
faire prendre une ftatue pour la nature elh-même, ni à
imiter avec une matière qui n’a qu’une feule couleur ■
la nature coloriée. L’illufion dont il faut qu’elle fe conteste
, eft de montrer des formes qui reflcmblent aux
formes les plus belles de la nature , de repréfenter des
exprelfions qui imitent la yérité, de donner au marbre
l’apparence ac la moUeffe des chairs, de la fermeté des,
tendons, ôcc, ( Note du Rida fleur.)
vrage
S C U
A a g e , & qu’ elle exige, à jufte titre f notre
eft 1 me 8c notre admiration.
On peut produire comme une preuve de la
grande valeur que nous attachons à la beauté
de» forme», la plupart des ouvrage» de peinture
8c de Sculpture de Michel-Ange, 8c un nombre
oonfiaérable de ftatuf. #n tiques, qui jouiflent
d une admiration juftement méritée, quoique
d ailleurs elles n’offrent pas un caraâère bien
déterminé ni une fort grande exprefîion.
Mais pour prouver plus fortement encore que
la beauté feule des forme» fuffit pour frapper
l ’efprit, j’obferverai qu/il n’y a jamais eu de
véritable artifte qui ait porté les yeux fur le torfe
fans éprouver le feu de l’ entboufiafme , comme
à la leéhire de la plus fublime pièce de poê'fie ;
A quoi cela peut-il être attribué? Quel charme
fecrec^ y a-t-il dans ce fragment antique,
& qui peut produire un tel effet, fi ce n’ eft
là perfeâion des formes idéales ? Un efprit
accoutumé à la contemplation de la beauté,
apperçoit dans ce tronc mutilé 8c dégradé dif-
jeüimembrapoëtoe, les veftiges du plus fuWirne
génie, les reftes d’ un ouvrage que les fiècles
futurs ne pourront jamais aflez admirer.
On dira, peut-être, que ce plaifir n’eft réfervé
qu’ à ceux qui ont palTé toute leur vie dans l’étude
& la contemplation de cet art. Je répondrai
d’abord que toutes les perfonnes qui ne font
pas entièrement ignorantes dans les arts qui dépendent
du deflin , pourroient également éprouver
les effets de ce morceau, fi elles vouîoient
dépouiller toute idée d’y trouver aucune illusion
, & n’y chercher que ce qui s’y trouve
véritablemenlt, une repréfentation partielle de
la nature. J’ajouterai q ue , quoiqu’on en puifle
d ire , les perfonnes ignorantes en ^mufique ne
fentent pas toujours l’effet des plus beaux ouvrages
de cet a r t, & qu’il faut une longue
étude pourappercevoir le but des différentes com-
binaifons des élémens qu’il emploie.
La fculpture efti un art borné en comparai-
fon de quelques autres arts; mais il a néanmoins
fes difficultés, & , dans les limites qui
l.ui--font propres, il a des cojnbinaifons nom-
breufes & très-variées.
L’eflence de la feulpture confifte dans la cor-
reélion. Quand à la corre&ion des formes, fe
trouvent joints le charme de la grâce la no-
bleffe du caraélère, & la vérité de l’expreffion
comme dans l’Apollon, la Vénus de Médicis’
le L^ocoon, le Moyfe de Michel-Ange, &
plufieurs autres ouvrages , on peut dire que cet
art a parfaitement rempli fon but.
I l eft difficile de déterminer par la théorie
ce que c’ eft que la grâce , & comment on peut
l ’acquérir ou s’en former une idée-, mais caufa
latet y res ejl notijfima : on en apperçoit continuellement
l’ effet-, fans fe livrer à des recherches
pénibles-, & quoique la grâce puifle
Jleaux-Arts. Tome IL '
S C U
Ce troaver quelquefois unie à Ctncorreâ'wn , on ne peut jamais une conCétiucncc* prononcer qu’elle en Coït
Je fai» qu’on a Couvent et té le Corrèze 8c le Parme&n pour prouver que la grâce eft, chez
eux du mofriir, une fuite de l’incorreâion ;
mvaaiin»c rlea moindre attention doit fuffire I conque
l’incorreéUon de quelques que l’on remarque dan» le»* ouvragés ce ce*
pdleuutxô tm àa îltar edsé, tlrouiinr ed. e faire naître la grâce, fert
Une Vierge du Parmelan que l’on voit avec l’enfant endormi 8c un charmant groappe d’ange», dans le palais Pitti, eft rempli de grâce r. mais cette grâce feroit encore plu» parfaite 8c cpoluus, lbése ldleo igfit sl e peintre, au lieu d’avoir fait le 8c les autres parties trop longue»
p&o ritniocnosr.reéles, leur ayoit donné leurs juftes proMais
pour nous renfermer dan» des ouvrages
ldoen f eduélppetnudr ed, ’uonn ac edritta qinu ed lé’églréeg adn’icoec doer rle’Aâipoonl'
que la tête ne fe trouve pas placée entre les étupea ueléfst, p8lcu sq uloen lgau em qoiutieé ninef éleri epuerrem dete i ’leax aftâaeproportion.
ferJmeo npsu icsr irtéipqouneds ren ’qefute plaas pvrreamieiè rde’ adper èsc el»’ aauftorité
d’un fort habile fculpteur de cette académie
{Vacadémie royale de Londres) qui a copié cette ftatue, & qui, par conféquent... Ta examinée & mefurée avec beaucoup de fbin.
Pour réfuter la fécondé aflertion, il fautfê rappeller qu5Apollon eft repréfenté ici comme | exerçant une de fes qualités particulières, la
av édloocnintéé, l&es qpruoep,o rptairo ncso lnefsé qpuluesn pt,r olp’arrersi fàt ef aliurei
naître l’idée de ce caraâère II n’y a donc pas plus d’incorreâion dans ces formes fvekes nqoun’iclé sn ’dye el’nH ae rcdualnes ,l eqsu mi ufefcr!veesn fto àr telumi ednot npnreorle
caraâère de la vigueur.
La fuppofirion qu’on peut produire la grâce par la difformité, eft un poifon pour l’efprit da
jeune artifte, & peut le porter à négliger ce qui eft effentiel à fon art, la correction da deflin, pour s’attacher à un phantôme q u i n’a d’exiftence que dans l’imaginat on déréglée de c&eu dxu q fuuir phruémtenaidne.nt trouver par tout de l’idéal
Je ne puis quitter la ftatue d’Arollon fàn*
vous communiquer une r flexion qu’elle m’a fuggerée. On fuppofe que ce dieu eft terré enoe . acuo nmtroem.lee nfte rqpue’nilt vPiyentht odne, d&éc oqcuheer l au nteêt ae rc chm» peu tournée vers l’épaule droite , :nd;cue I eft attentif à l’effet qu’elle produit. Ce que je
veux remarquer ici, c’eft ia différence qu‘Jrt oblerye entre cette intention du dieu & celle
C c e