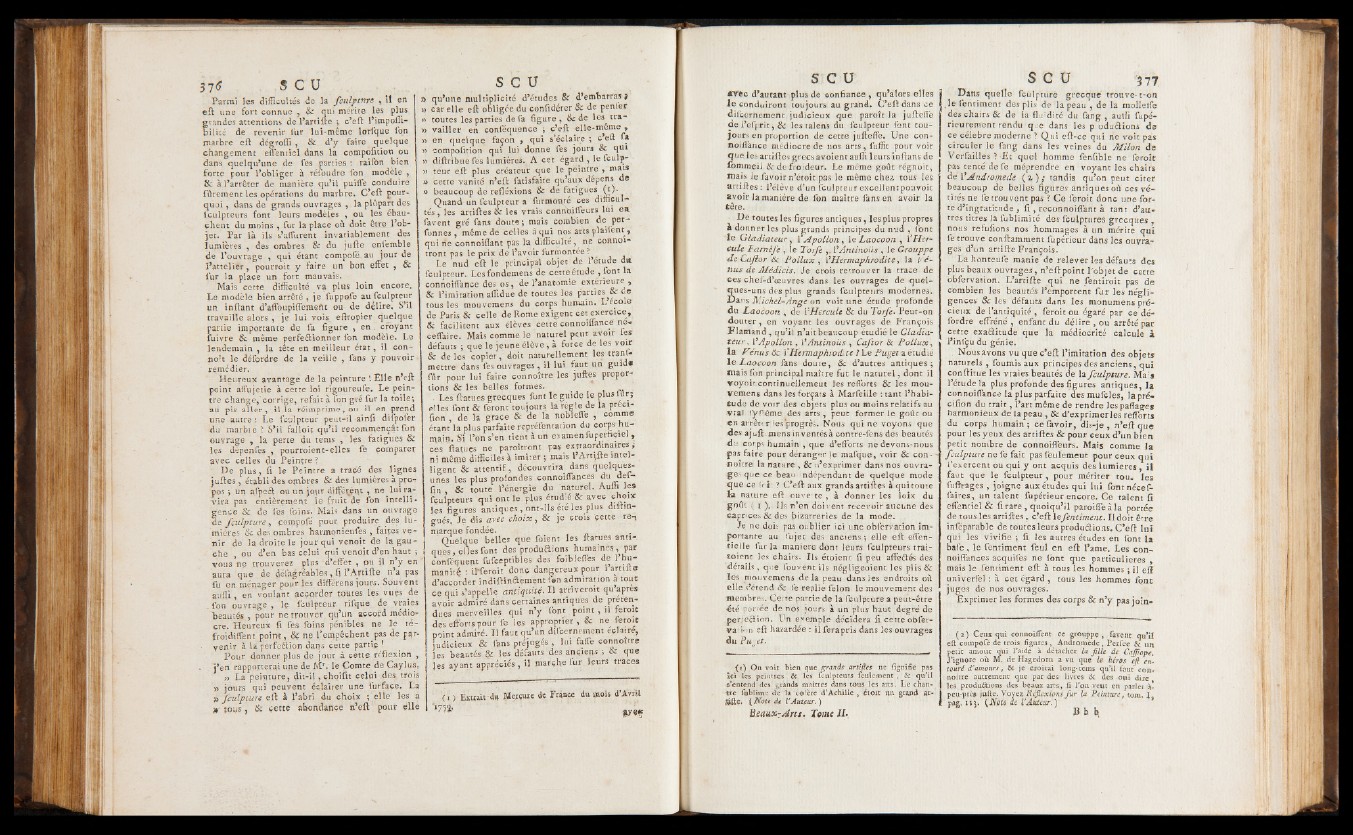
Parmi les difficultés de la fculptnrt , il en
eft une fort connue , 8c qui mérite les plus
grandes attentions de l’artifte -, c’ eft l’ impofïi-
bilité de revenir i'ur lui-même lorfque fon
marbre eft dégrofli , & d’y faire quelque
changement effentiel dans la compoficion ou
dans quelqu’ une de fes parties : raifôn bien
forte pour l’obliger à réfoudre fon modèle ,
& à l’arrêter de manière qu’ il puiffe conduire
fûrement les opérations du marbre. C’ eft pourquoi
, dans de grands ouvrages , la plupart des
fculpteurs font leurs modèles , ou les ébauchent
du moins , fur la place où doit être l’objet.
Par là ils s’affurent invariablement des
lumières , des ombres. & du jufte enfemble
de l’ouvrage , qui étant compofé^au jour de
Patteliêr, pourroit y faire un bon effet , &
fur la place un fort mauvais.
Mais cette difficulté va plus loin encore.
Le modèle bien arrêté , je iuppofe au fculpteur
un inftant d’affoupiffemeftt ou de délire. S’il
travaille alors , je lui vois_ eftropier quelque
partie importante de la figure , e n . croyant
fuivre & même perfectionner fon modèle. Le
lendemain , la tête en meilleur éta t, il con-
poit le défordre de la veille , fans y pouvoir *
remédier,
Heureux avantage de la peinture 1 Elle n’ eft
point affujetie à cette loi rigoureufe. Le peintre
change,’ corrige, refait à fon gré fur la toile;
au pis a lle r , il la réimprime, ou il en prend
une autre : Le fc'ilpteur peut-il ainfi difpofer
du marbie ? S’ il falloir qu’ il recommençât fon
ouyrage , la perte du tenis , les fatigues &
les dépenfes , pourroient-elles fe comparer
avec celles du Peintre ’
De plus, fi le Peintre a tracé des lignes
iuftes , établi des ombres & des lumières a pro-s
pos ; un afpeét ou un jo\.ir différent , ne lui ravira
pas entièrement le fruit de fon intelligence
& de fes foins. Mais dans un ouvrage
■ de fculpture, çompofé pour produire des lùr
mières & des ombres, harmonieufes , faites v enir
de la droite le jour qui venait de la gauche
, ou d’ en bas celui qui venoit d’ en haut -,
vous ne trouverez plus d’ effet , ou il n’y en
aura que de délàgréables, fi l’Artifte n’a pas
fu en ménager pour les différens jours. Souvent
aufïi, en voulant accorder toutes les vues de
_ fon ouvrage , lg lculpteur rifque de vraies
beautés , pour ne trouver qu’ un accord médior
çre. Heureux fl fes foins pénibles ne le ré-
froidiffent point, & ne l ’empêchent pas de parvenir
à là perfeClion dans cette partie !
Pour donner plus de jour à cette réflexion
. j’en rapporterai une de Mr. le Comte de Çaylus,
» qu’ une multiplicité d’études & d’embarras 3
» car elle eft obligée du confidérer & de penfer
» toutes les parties de fa figure , de les tra-
» vailler en conléquence *, c’ eft elle-même ,
» en quelque façon , qui s’éclaire ; c’ eft fa
» compofition qui lui donne fes jours & qui
» diftribue fes lumières. A cet égard , le fculp-
» teur eft plus créateur que le peintre , mais
» cette vanité n’ eft fatisfaite qu’aux dépens de
o beaucoup de réflexions & de fatigues Cf)*
>3 La peinture, dit-il , çhoifit celui des trois
>3 jours qui peuvent éclairer une lurfaçe. La
» fculpture eft à l’abri du choix ; elle les a
tous, 8c cette abondance n’eft pour elle
Quand un fculpteur a furmonté ces difficultés,
les artiftes & les vrais conrihiffeurs lui en
lavent gré fans doute ; mais combien de per-
fonnes , même de celles à qui nos arts pîailent ,
qui ne connoifîànt pas la difficulté, ne connoi-
tront pas le prix de l’avoir furmontée?
Le nud eft le principal objet de l’étude du.
fculpteur. Les fondemens de cetteetude , font la
connoiffance des o s , de l’anatomie extérieure ,
& l’ imitation affidue de toutes les parties 8c ce
tous les mouvemens du corps humain. L ecole
de Paris 8c celle de Rome exigent cet exercice,
8c facilitent aux élèves cette connoiffance neceffaire.
Mais comme le naturel peur avoir fes
défauts ; que le jeune élève , a force de les voir
& de les copier, doit naturellement les tranj-
mettre dans fes ouvrages , il' lui faut un guldf
fùr pour lui faire connoître les juftes proportions
& les belles formes. *
- Les ftatues grecques font le guide le plus fur;
elles font & feront toujours la règle de la preci-
fion , de â grâce & de la nobleffe , comme
étant la plus parfaite repréfenration du corps humain.
Si l’on s’en tient à un examen luperfiçiel ,
çès ftatuçs ne . paroîtront pas extraordinaires
ni même difficiles à imiter ; mais l’Art jfte întel-
ligent & attentif., découvrira dans quelques-
unes les plus profondes connoiffances du def-
fin & toute l’énergie du naturel. Autli les
fculpteurs qui ont le plus étudié & avec <-h°>x
les figures antiques , ont-ils été les plus diitingués.
Je dis avèc choix, & je crois cette req
marque fondée- _
Quelque belles que foient les ftatues antir
ques, elles font des produélions humaines par
■ conféquent fufceptibles des foibieffes de 1 humanité
■ iKeroit donç dangereux pour 1 artifle
d’accorder indifflnaement (en admiration à tout
ce qui s’appelle antiquité II arriveroit qu après
avoir admiré dans certaines antiques de prétendues
merveilles qui n’y i'ortt point, il feroit
des effort.»pour fe les approprier , & ne feroit
ooint admiré. Il faut qu’ un dilfcernement éclairé,
judicieux & fans préjugés , lui fade connoître
les beautés les défauts des anciens ; & que
les ayant appréciés , il prarçhe fur leurs traces
: U ) Extrait d* Jtcjçute de Titoee du mois d'AVril
âYec d’autant plus de confiance , qu’alors elles
Je conduiront toujours au grand. C’eft dans ce
difçernement judicieux que parole la juftefl'e
de l ’efprit, & les talens du fculpteur font toujours
en proportion de cette jufteffe. Une connoiffance
médiocre de nos arts , fuffic pour voir
que les artiftes grecs avoient aufïi leurs inftans de
Jbmmeii & de froideur. Le même goût régnoit,
mais le favoirn’éroit pas le même chez tous les
artiftes : l ’élève d’ un fculpteur excellent pouvoit
avoir la manière de fon maître fans en avoir la
tête.
De toutes les figures antiques, les plus propres
à donner les plus grands principes du nud , font
le Gladiateur, 1 Apo llon, le Laocoon , VHercule
Far né Je , le TorJ'e ,. l’Antino iis , le Grouppe
de Cajlor &c P ollux , Ÿ Hermaphrodite, la ÿ é-
nus de Médicis. Je crois retrouver la trace de
ces chef-d’oeuvres dans les ouvrages de quelques
uns des plus grands fculpteurs modernes.
D a vs Michel-Ange on voit une étude profonde
du Laoèoon , de ŸHercule & du Torfe. Peur-on
douter, en voyant les ouvrages de François
Flamand , qu’il n’ait beaucoup étudié le Gladiateur
, l’Apollon , 1* Antinous , Caftor & P o llu x ,
la Pénus 8c l ’Hermaphrodite ? Le Puget a étudié
le Laocoon fans doute, 8c d’autres antiques;
mais fon principal maître fut le naturel, dont il
voyoit continuellement les refibrts & les mouvemens
dans les forçats à Marfeille : tant l’habitude
de voir des objets plus ou moins relatifs au
Vrai fyflème des arts , peut former le goût ou
en arrêtt rie s progrès. Nous qui ne voyons que
des ajuft mens in ventés à contre-fens des beautés
du corps humain , que d’efforts ne devons-nous
pas faire pour déranger }e mafque, voir 8c con-
Hoitre la nature , & n’ exprimer dans nos ouvrages
que ce beau ndépendant de quelque mode
que ce iri, ? C’ eft aux grands artiftes à quitonte
la nature eft ouve-te , à donner les loix du
goût ( i ). Ils n’ en doivent recevoir aucune des
caprces & des bizarreries de la mode.
Je ne dois pas oublier ici une obfervation importante
au fujet des anciens ; elle eft effen-
tielle fur la maniéré dont leurs fculpteurs trai-
toient les chairs. Ils étoient fi peu affeétés des
détails, que Couvent ils négligeoient les p lis&
les mouvemens delà peau dans les endroits où
elle s’étend & fe replie félon le mouvement des
membres. Ces te partie de la fculpture a peut-être
■ été porcée de nos jours à un plus haut degré de
perreftion. Un exemple décidera fi cette obfer-
va* ion eft hazardée : il fera pris dans les ouvrages
du Pu-et.
f i ) On voit bien que grands artiftes ne lignifie pas
ici les peintres & les fculpteurs feulement, & qu’il
s’entend des grands maîtres dans tous les arts. Le chancre
fijblime de la co'ère d’Achille , étoit un grand ar»
( Note de VAuteur. )
Ufuinx:Ans. Tome IL
Dans quelle fçülpture grecque trouve-t-on
\e fentiment des plis de la peau , de la mollelfe
des chairs & de la flu>dite du fang , autfi fupé-
rieurement rendu que dans les p odudions de
ce célébré moderne ? Qui çft-ce qui ne voit pas
circuler le fang dans les veines du Milon de
Verfailles ? Et quel homme fenfible ne feroit
pas ténté de fe méprendre en voyant les chairs
de l’Andromède (2, ) ,* tandis qu’on peut citer
beaucoup de belles figures antiques où ces vérités
ne le trouvent pas ? Ce feroit donc une forte
d’ ingratitnde , f l , reconnoiflant à tant d’au*
très titres la fublimité des fculptures grecques ,
nous réfutions nos hommages à un mérite qui
fe trouve conftamment fupérieur dans les ouvrages
d’ un artifte François.
La honteufe manie de relever les défauts des
plus beaux ouvrages , n’eft point l'objet de cette
obfervation. L’artifte qui ne fentiroit pas de
combien les beautés l ’emportent fur les négligences
& les défauts dans les nionumens précieux
de l’antiquité , feroit ou égaré par ce défordre
effréné , enfant du délire , ou arrêté par
cette exa&itude que la médiocrité calcule à
l’ infçu du génie.
Nous avons vu que c’eft l’ imitation des objets
naturels , fournis aux principes des anciens, qui
conftitue les vraies beautés de la fculpture. Ma:s
l’étude la plus profonde des figures antiques, la
connoiffance la plus parfaite desmufcles, lapré-
cifion du trait, l’arc même de rendre les palîao-es
harmonieux de la peau , & d’exprimerles relions
du corps humain; ce fa voir, dis-je, n’eft que
pour les yeux des artiftes & pour ceux d’ un bien
petit nombre de connoifleurs. Mais comme la
fculpture ne fe fait pas feulemeut pour ceux qui
l ’exercent ou qui y ont acquis des lumières, il
faut que le fculpteur, pour mériter tou* les
fuftrages , joigne aux études qui lui fontnécef-
faires, un talent fupérieur encore. Ce talent fi
effentiel & fl rare, quoiqu’ il paroiffeàla portée
de tous les artiftes. c’eft lefentiment. Il doit être
inféparable de toutes leurs produélions. C ’eft lui
qui les vivifie ; fi les autres études en font la
bafe, le fentiment feul en eft l’ame. Les connoiffances
acquifes ne Ibnt que particulières ,
mais le fentiment eft à tous les hommes ; il eff
univerfel : à cet égard , tous les hommes fçnc
juges de nos ouvrages.
Exprimer les formes des corps & n’y pas join-
• (a) Ceux qui connolflent ce grouppe, favent qu’ii
eft compofé de trois figures , Andromède, Perfée 8c un
petit amour qui l’aide à détacher la fille de CaJJiope.
J’ignore oh M. de Hagedprn a vu que le héros eft entouré
d'amours, & je croirai long-tems qu’il faut cojx.
noitre autrement que par des livre? ôc des ouï dire
les. productions des bçaux arts, fi l’on veut en parler à-
pe.u-près jufte. Voyez Réflexions fu r la Peinture, tom. J ,
pag. 113. {Note de l'Auteur. )
B b b