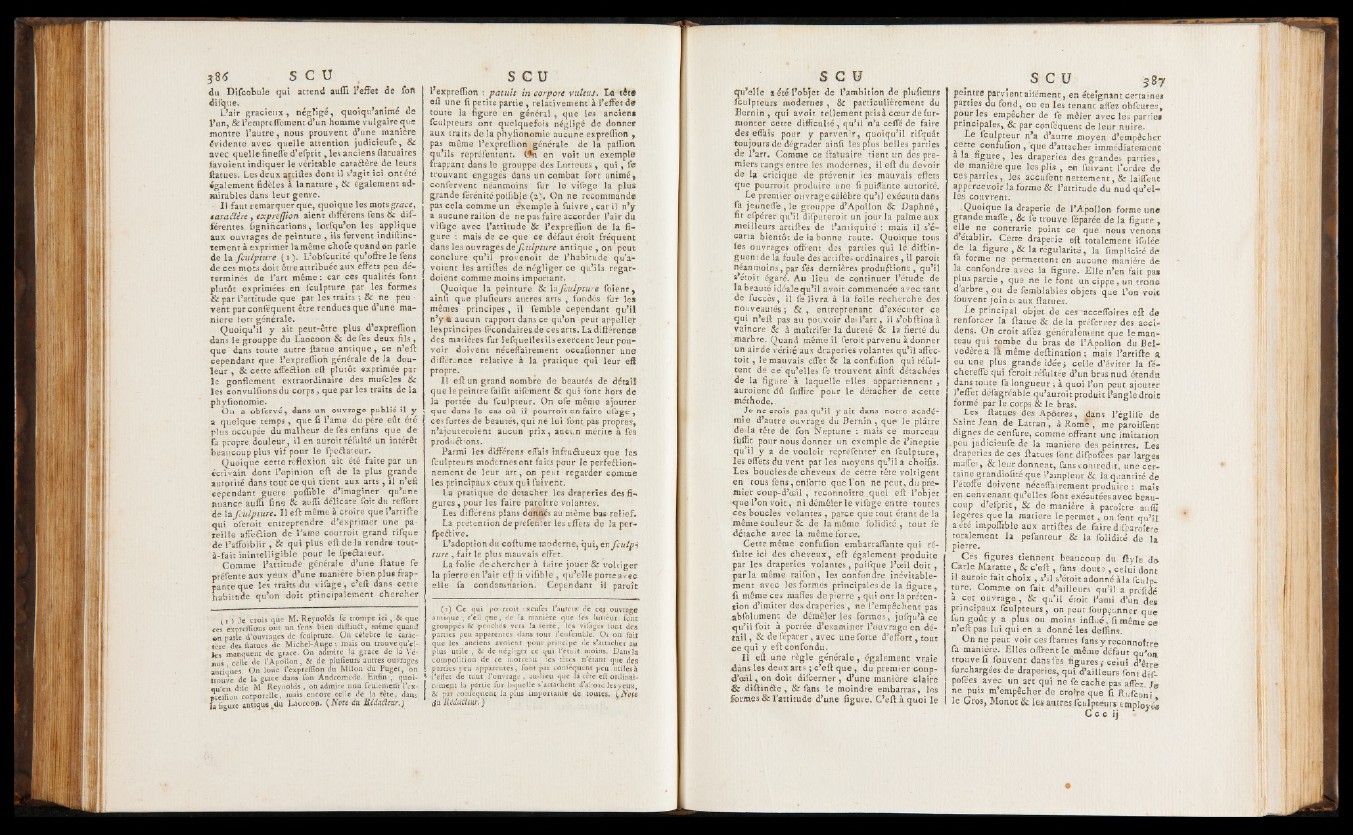
S C U
du Difcobule qui attend aufli l’effet de fon
difque.
L’air gracieux, négligé, quoiqu’ animé de
l’ un, & l’empreflement d’ un homme vulgaire que
montre l’autre, nous prouvent d’ une maniéré
évidente avec quelle attention judicieufe, &
avec quelle fineffe d’ efprit, les anciens ftatuaires
favoient indiquer le véritable cara&ère de leurs
ftatues. Les deux ajrtiftes dont il s’agit ici ont été
également fidèles a la nature , & également admirables
dans leur genre.
Il faut remarquer que, quoique les mots grâce,
caractère , expreffîon aient différens fens & différentes
lignifications, lorfqu’on les applique
aux ouvrages de peinture , ils fervent indiftinc-
tement à exprimer lamême chofe quand on parle
de la fculpture ( i ). L’obfcurité qu’offre le fens
de ces mots doit être attribuée aux effets peu déterminés
de l’art même : car ces qualités font
plutôt exprimées en fculpture par les formes
& par l ’attitude que par les traits •, & ne peu •
yent par conféquent être rendues que d’une maniéré
forr générale.
Quoiqu’ il y ait peut-être plus d’expreflion
dans le grouppe du Laocoon & de fes deux fils,
que dans toute autre ftatue antique, ce n’eft
cependant que l’expreflioh générale de la douleur
, & cette affe&ion .eft plutôt exprimée par
le gonflement extraordinaire des mufcles &
les convulfions du corps , que par les traits de la
phyfionomie.
On a obfervé, dans un ouvrage oublié il y
a quelque temps , que fi l’ame du pere eût été
plus occupée du malheur de fes en fans que de
fa propre douleur, il en auroitréfulté un intérêt
beaucoup plus v if pour le fpeélateur.
Quoique cette réflexion ait été faite par un
écrivain dont l ’opinion eft de la plus grande
autorité dans tout ce qui tient aux arts , il n’ èft
cependant guere poflible d’ imaginer qu’ une
nuance aufïi fine & aufli délicate fort du reffort
de la fculpture. Il eft même a croire que l’artifte
qui oferoit entreprendre d’ exprimer une pareille
affe&ion de J’ame courroit grand rifque
de l’affoiblir , & qui plus eft de la rendre tout-
à-fait inintelligible pour le fpe&ateur.
Comme l’ attitude générale d’une ftatue fe
préfente aux yeux d’une manière bien plus frappante
que les traits du v ifa g e , c’eft dans cette
habitude qu’on doit principalement chercher
( i ) Je crois que M. Reynolds fe trompe i c i , & que
ces expreffions ont un fens bien d iftinft, même quand
cm parle d’ouvrages de fculpture. On célébré le caractère
des ftatues de Michel-Ange ; mais on trouve qu’el- ,
les manquent de grâce. On admire la grâce de la Vénus
celle de l’Ap ollon, & de plufieurs autres ouvrages
antiques. On loue l’expreflïon du Milon du Pugct, on
trouve de la grâce dans fon Andromède. Enfin , quoi- *
eu’en dife M Reynolds , on admire non feuiemclfr l’ex- |
preffion corporelle, mais encore celle de la fê te, dans |
fa figure antique kdu Laocoon. {Note du Rédaâeur.)
S C U
l’ expreflion : patuit in corpore vultus. La têtê
ofl une fi petite partie, relativement à l’ effet de
toute la figure en général , que les anciens
fculpteurs ont quelquefois négligé de donner
aux traits de la phyfionomie aucune expreflion ,
pas même l’expreflionjgénérale de la paflion
qu’ ils repréfentent. (fn en voit un exemple
frappant dans le grouppe des Lutteurs , q u i, fe
trouvant engagés dans un combat fort animé9
confervent néanmoins fur le vifage la plus
grande férénité polfible (2). On ne recommande
pas cela comme un exemple à fuivre , car il n’y
a aucune railbn de ne pas faire accorder l’air du
vifage avec l’attitude & l’expreflion de la figure
: mais de ce que ce défaut étoit fréquent
dans les ouvrages de fculpture antique , on peut
conclure qu’ il provenoit de l’ habitude qu’a-
voienc les artiftes de négliger ce qu’ ils regar-
doîent comme moins important.
Quoique la peinture & la fculpture foient,
ainii que plufieurs autres arts , fondés fur les
mêmes principes, il femble cependant qu’ il
n’yéi aucun rapport dans ce qu’on peut appeller
les principes fécondai res de ces arts. La différence
des matières fur lefquelles ils exercent leur pouvoir
doivent néceflairement occafionner une
différence relative à la pratique qui leur efl
propre.
Il eft un grand nombre de beautés de détail
que le peintre faifit aifément & qui font hors de
la portée du fculpteur. On ofe même ajouter
que dans le cas où il pourroit en faire ufage,
ces fortes de beautés, qui né lui font pas propres,
n’ajeuteroient aucun prix, atici.n mérite a fes
produ&ions.
Parmi les différens eflais infru&ueux que les
fculpteurs modernes ont faits pour le perfectionnement
de leur art, on peut regarder comme
les principaux ceux qui fuivent.
La pratique de détacher les draperies desfi-i
gures , pour les faire paroître volantes.
Les différens plans donnés au même bas relief.
La prétention de préfenter les effets de la per-
fpe&ive.
L’adoption du coftume moderne) qui, en fa ilp î
ture ,-fait le plus mauvais effet.
La folie de chercher à faire jouer & voltiger
la pierre en l’air eft fi vifible , qu’elle porte avec
elle fa condamnation. Cependant il paroît
(2) Ce qui pourroit c xeufer l’auteujt de cgi ouvrage
antique , c’eli qu e , de la manière que fes lutteur, font
groappés & penchés vers la terre, les vifages l’ont des
parties peu apparentes dans tout l’enfemble. Or on fait
que les anciens avoient pour principe de s’attacher au
plus utile , & de négliger ce qui l’étoit moins. Dans la
compofition de ce morceau _ les têtes n’étant que des
parties peu apparentes, font par conféquent peu utiles a
l’effet de tout l’ouvrage , au-lieu que là tête eft ordinairement
la partie fur-laquelle s’attachent d’abord les yeux,
& par conféquent la plus importante de toutes. LNou
du Rédaâeur. )
S C U
qu’elle a été l’objet de l’ambition de plufieurs
fculpteurs modernes , & particulièrement du
Bernin, qui avoit tellement pris à coeur de (ur-
itionter cette difficulté , qu’ il n’a cefle de faire
des eflais pour y parvenir, quoiqu’ il rifquât
toujours de dégrader ainfi les plus belles parties
de l ’art. Comme ce ftatuaire tient un des premiers
rangs entre les modernes, il eft du devoir
de lg critique de prévenir les mauvais effets
que pourroit produire une fi puiffante autorité.
Le premier ouvrage célèbre qu’ il exécuta dans
fa jeunefle , le grouppe d’Apollon & Daphné,
fit efpérer qu’il difputeroit un jour la palme aux
meilleurs artiftes de l’antiquité : mais il s’écarta
bientôt de la bonne route. Quoique tous
les ouvrages offrent des parties qui le diftin-
guentde la foule des artiftes ordinaires , il paroît
néanmoins, par fés dernières productions , qu’ il
s étoit égaré. Au lieu de continuer l’étude de
la beauté idéale qu’ il avoit commencée avec tant
de fuccès, il fe livra à la folle recherche des
nouveautés ; & , entreprenant d’exécuter ce
qui n’eft pas au pouvoir de*l’art, il s’obftinaà
vaincre & à maîtrifer la dureté & la fierté du
marbre. Quand même il feroit parvenu à donner
un airde véritéaux draperies volantes qu’ il affec-
t o i t , le mauvais effet & la confufion qui résultent
de ce’ qu’elles fe trouvent ainfi détachées
de la figure à laquelle elles appartiennent ,
auroient dû fuffire pour le détabher de cette
méthode..
Je ne crois pas qu’ il y ait dans notre académie
d’autre ouvrage du Bernin, que le plâtre
de la tête de fon Neptune : mais ce morceau
fuffit pour nous donner un exemple de l’ineptie
qu’il y a de vouloir repréfenter en fculpture,
les effets du vent par les moyens qu’ il a choifis.
Les boucles de cheveux de cette tête voltigent
en tous fens, enforte que l'on ne peut, du premier
coup-d’oeil , reconnoître.quel eft l’objet
que l’on vo it, ni démêler le vifage entre toutes
ces boucles volantes , parce que tout étant de la
même couleur & de lamême folidité , tout fe
détache avec la même force.
Cette même confufion embarraflante qui ré-
fulte ici des cheveux, eft également produite
par les draperies volantes, puifque l’oeil doit ,
parla même raifon, les confondre inévitablement
avec les formes principales de la figure ,
fi même ces mafles de pierre , qui ont la prétention
d’ imiter des draperies , ne l’empêchent pas
abfolument de démêler les formés, jufqu’à ce
qu’ il foit à portée d’ examiner l’ouvrage en détail
, & de féparer , avec une forte d’ effort, tout
ce qui y eft confondu.
I l eft une règle générale, également vraie
dans les deux arts ; c’eft q ue , du premier coup-
d’ceil, on doit difeerner , d’une manière claire
& diftin& e, & fans le moindre embarras, les
formes & l’attitude d’une figure. C’eft à quoi le
S C U 387
peintre parvient ailement, en éteignant certaines
parties du fond, ou en les tenant aflez obfcures,
pour les empêcher de fe mêler avec les partie*
principales,. & par conféquent de leur nuire.
Le fculpteur n’a d’autre moyen d’empêcher
cette confufion , que d’attacher immédiatement
a la figure, les draperies des grandes parties,
do manière que les plis-, en fuivant l’ordre de
ces parties, les acculent nettement, & laiffent
appercevoir la forme & l ’attitude du nud qu’elles
couvrent.
.Quoique la draperie de l’Apollon forme une
grande mafle, & fe trouve féparée de la figure ,
«Ie J1? contrarie point ce que nous venons
d établir. Cette draperie eft totalement ifolée
de la figure , & la régularité, la fimplicité de
fa forme ne permettent en aucune manière de
la confondre avec la figure. Elle n’ en fait pas
plus partie , que ne le font un cippe , un tronc
d arbre, ou de femblables objets que L’on voit
fouvent joints aux ftatues.
Le principal objet.de ces^acceffoires eft de
renforcer la ftatue & de la préferver des accî-
dens. On croît aflez généralement que le manteau
qui tombe du bras de l’Apollon du Bel-
vedere a la meme- deftination ; mais l’artifte a
eu une plus grande idée* celle d’éviter la fé-
cherefle qui feroit réfuitée d’ un bras nud étendu
dans toute fa longueur * à quoi l ’on peut ajouter
l’effet défagreable qu’auroit produit l?angîe droit
formé par le corps & le bras.
Les ftatues des Apôtres, dans l’églife de
Saint Jean de Latran, à Rome , me paroiflenc
dignes de cenfure, comme offrant une imitation
.peu judicieufe de la manière des peintres. Les
draperies de ces ftatues font difpofées par larges
mafle?, & le u r donnent, fans contredit, une certaine
grandiofité que l’ampleur & la quantité de
l’étoffe doivent néceflairement produire : mais
en convenant qu’ elles font exécutées avec beaucoup
d’ efprit, & de manière à paroître aufli
légères que la matière le permet, on fent qu’ il
a été impoflible aux artiftes de faire difparoître
totalement la pefanteur & la folidité de la
pierre.
Ces figures tiennent beaucoup du ftyle do.
Carie Maratte , & c’eft , fans doute , celui dont
il auroit fait choix , s’ il s’étoit adonné àla fculpture.
Comme on fait d’ailleurs qu’il a préftdé
à cet ouvrage., 8c qu’ il étoit l’ami d’un des
principaux fculpteurs , on peut foupçojiner que
fon goût y a plus ou moins influé, fi même ce
n’eft pas.lui qui en a donné les deflins.
On ne peut voir ces ftatues fans y reconnoftre
fa manière. Elles offrent le même défaut qufoa
trouve fi fouvent dans fes figures y celui d’être
furchargées de draperies, qui d’ailleurs font difpofées
avec un art qui ne fe cache pas aflez Je
ne puis m’empêcher de croire que fi Rufooni
le Gros, Monot & les autres fculpteurs employée