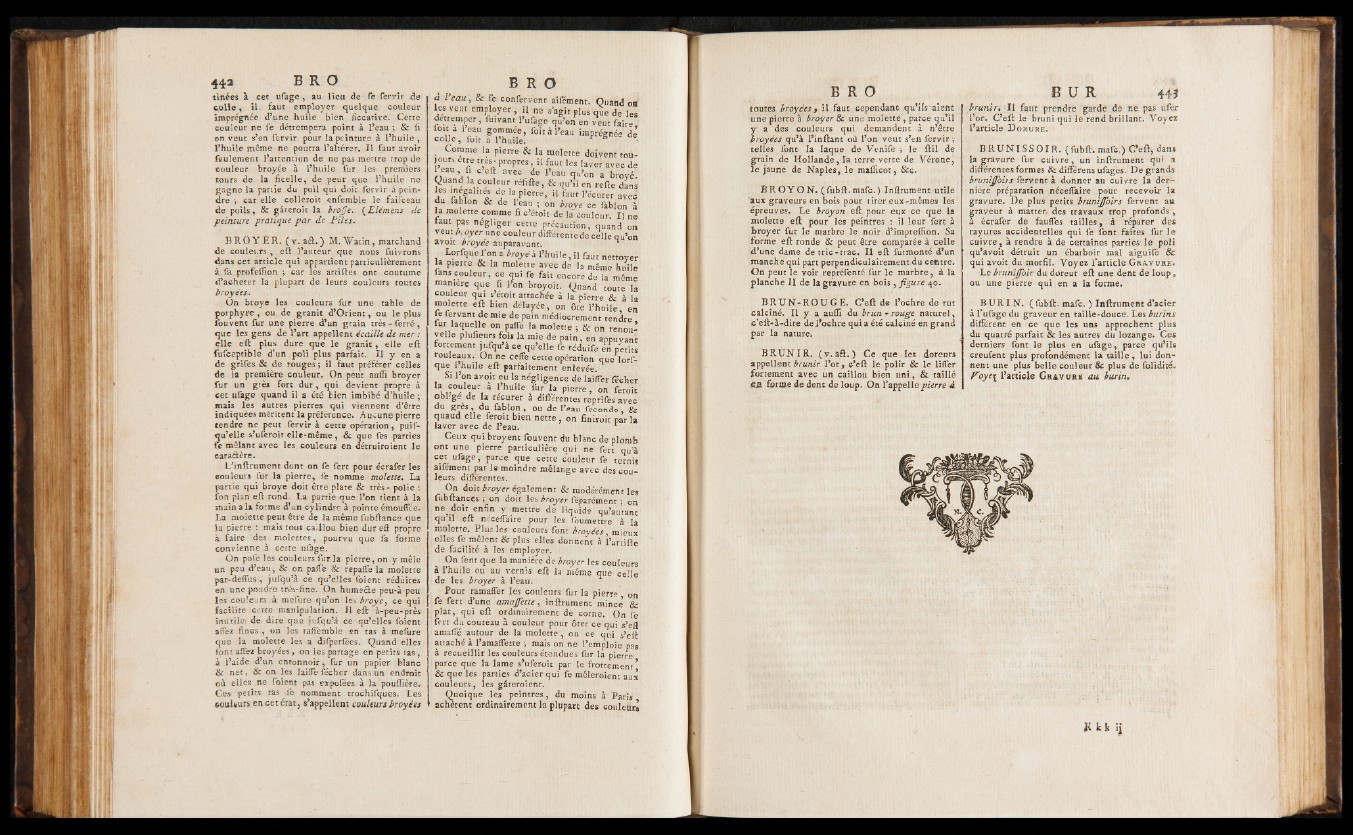
tinées à cet ufage , au lieu de Te fervîr de
c o l le , il faut employer quelque couleur
imprégnée d’ une huile bien ficcative. Cette
couleur ne fe détrempera point à l’eau ; & fi
on veut s’en fervîr pour la peinture à l ’huile ,
l ’huile même ne pourra l’altérer. I l faut avoir
feulement l’attention de ne pas mettre trop de
couleur broyée à l’ huile fur les premiers
tours de la fice lle , de peur que l ’huile ne
gagne la partie du poil qui doit fervir à peindre
i car elle colleroit enfemble le faiiceau
de poils, & gâteroit la brojje. ( Elément de
peinture pratique par de Piles.
B R O Y E R . ( v . a&. ) M. Watin, marchand
de couleurs , eft l’auteur que nous fuivrons
dans cet article qui appartient particulièrement
à. fa profelïion *, car les artiftes ont coutume
d’ acheter la plupart de leurs couleurs toutes
broyées.
On broyé les couleurs fur une table de
porphy-Te , ou de granit d’O rient, ou le plus
ïbuvent fur une pierre d’ un grain très - ferré,
que les gens dé l’ art appellent écaille de mer :
elle eft plus dure que le gran it, elle eft
fufceptible d’un poli plus parfait. I l y en a
de grifes & de rouges ; il faut préférer celles
de la première couleur. On peut aufii broyer
fur un grès fort d u r , qui devient propre à
cet ufage quand il a été bien imbibé d’huile ;
mais les autres pierres qui viennent d’être
indiquées méritent la préférence. Aucune pierre
tendre ne peut fervir à cette opération, puif-
qu’elle s’ uleroir elle-même, & que fes parties
fe mêlant avec les couleurs en détruiroient le
eara&ère.
1/inftrument dont on fe fert pour écrafer les
couleurs fur la pierre, fe nomme molette. La
partie qui broyé doit être plate & très - polie :
fon plan eft rond. La partie que l’on tient à la
main a la forme d’ un cylindre à pointe émoufiee.
La molette peut être dç la même fubftance que
la pierre : mais tout caillou bien dur eft propre
à faire des molettes, pourvu que fa forme
convienne à cette ufage.
On pôle les couleurs fur la pierre, on y mêle
un peu d’ eau, & on parte & repartie la molette
par-deffus , jufqu’à ce qu’ elles foic-nt réduites
en une poudre très-fine. On humecle peu-à-peu
les couleurs à mefûre qu’on les broyé, ce qui
facilite cette manipulation. Il eft à-peu-près
inutile- de dire que jufqu’ à ce qu’ elles foient
affez fines , on les raffemble en tas à mefure
que la molette les a difperfées. Quand elles
font affez broyées, on les partage en petits (as ,
à l’aide d’un entonnoir, fur un papier blanc
& net, & on les laiffefécher dans un endroit
où elles ne foient pas expofées à la poullière.
Ces petits tas fe nomment trochifques. Les
couleurs en cet état, s’appellent couleurs broyées
a l'ea u , & fe confervent aifément. Quand on
les veut employer , 11 ne s’agit plus que de les
detremper, luivant l’ ufage qu’on en veut faire J
loit a leau gommée, foie à l’eau imprégnée dé
c o lle , foit a l’huile. r 6 •
Comme la pierre & la molette doivent tou-
jour. être très- propres, il faut les laver avec de
,,eau m c c(î avec de l’eau qu’on a broyé.
Quand la couleur réfifte, & qu’il en refte dans
les inegal.tes de la pierre, il faut l’écurer aveb
du fablon & de 1 eau ; on broyé ce fablon à
la molette comme fx c’étoit de la couleur. Il ne
faut pas négliger cette précaution, quand on
veut b. oyer une couleur différente de celle qu’on
avoit proyee auparavant. n
Lorfquel’on a broyé* l’h u ile ,il faut nettoyer
la pierre & la molette avec de la même huile
lans couleur, ce qui Ce fait encore de la même
maniéré que fi l’on broyoit. Quand toute la
couleur qui s etoit attachée à la pierre & à la
molette eft bien délayée, on ôte l’huile, en
le iervant de mie de pain médiocrement tendre
fur Uquelle on paffe la moletie ; & on renouvelle
plufieurs fois la mie de pain, en appuyant
fortement jufqu’ à ce qu’ elle fe réduffe en petits
rouleaux. On ne cefle cette opération que lorf-
que 1 huile eft parfaitement enlevée.
Si l’on avoir eu la négligence de laitier fécher
, ur, a 1 huile fur la pierre, on feroit
oblige^ de 1a recurer à différentes reprifes avec
du grès , du fablon , ou de l’eau fécondé &
quaud e lle feroit bien nette , on finiroit par la
laver avec de l ’eau.
Ceux qui broyent fouvent du blanc de plomb
ont une pierre particulière qui ne fert qu’à
cc’ ufage, parce que cette couleur fe ternir
aifement par le moindre mélange avec des couleurs
différentes.
On doit broyer également & modérément les
fubftances ; on doit les broyer féparément ; on
ne^doit enfin y mettre de liquide qu’autant
qu’ il eft néceffaire pour les foumettre à la
molette. Plus les couleurs font broyées, mieux
elles fe mêlent & pins elles donnent à l’artifte
de facilité à les employer.
On fent que la manière de broyer les couleurs
à l’huile ou au vernis e f t la même que celle
de les broyer à l’eau.
Pour ramaffer les couleurs fur la pierre an
fe fert d’une amajfette, infiniment mince &
plat, qui eft ordinairement de corne. On fç
fert du couteau à couleur pour ôter ce qui s’eft
amafTé autour de la molette, ou ce qui s’eft
attaché à l’amaffette -, mais on ne l’emploie pas
à recueillir les couleurs étendues fur la pierre-
parce que la lame s’ uferoit par le frottement*
& que les parties d’acier qui fe mêleroient aux
couleurs, les gâteroient.
Quoique les peintres, du moins à Paris
achètent ordinairement la plupart des couleiira
toutes broyées, îl faut cependant qu’ils aient
une pierre a broyer & une molette , parce qu’ il
y a des couleurs qui demandent à n’être
broyées qu’à l’ inftanc où l’on veut s’en fervir ;
telles font la laque de Venife ; le ftil de
grain de Hollande, la terre verte de Vérone,
le jaune de Naples, le mafiieot, & c.
B R O Y O N . (fubft.mafe.) Infiniment utile
aux graveurs en bois pour tirer eux-mêmes les
épreuves. Le broyon eft pour eux ce que la
molette eft pour les peintres : il leur fert à
broyer fur le marbre le noir d’ imprelïion. Sa
forme eft ronde & peut être comparée à celle
d’une dame de trie-trac. I l eft furmonté d’ un
manche qui part perpendiculairement du centre.
On peut le voir repréfentc fur le marbre, à la
planche II de la gravure en bois y figure 40.
B R U N -R O U G E . C’eft de l’ochre de rut
calciné. I l y a aufii du brun - rouge naturel,
c ’eft-à-dire de l ’ochre qui a été calciné en grand
par la nature»
B R U N IR . ( v . a£i. ) Ce que les doreurs
appellent brunir l’or , ç’eft le polir & le lifter
fortement avec un caillou bien u n i, & taillé
£& forme de dent de loup. On l’appelle pierre à
brunir. Il faut prendre garde de ne pas ufer
l ’or. C’eft le bruni qui le rend brillant. Voyez
l’article D orure.
B R U N I S S O I R. ( fubft. mafe.) C’eft, dans
la gravure fur cu iv re , un inftrument qui a
différentes formes & différens ufages. De grands
bruniÿbiis fervent à donner au cuivre la dernière
préparation néceffaire pour recevoir la
gravure. De plus petits bruniffoirs fervent au
graveur à matter. des travaux trop profonds,
a écrafer de faufles tailles , à réparer des
rayures accidentelles qui fe font faites fur le
cuivre, à rendre à de certaines parties le poli
qu’avoit détruit un ébarboir mal aiguife &
qui avoit du niorfil. Voyez l’article Gravure.
Le brunijffbir du doreur eft une dent de loup,
ou une pierre qui en a la forme.
B U R IN . ( fubft. mafe. ) Inftrument d’acier
à l’ufage du graveur en taille-douce. Les burins
différent en ce que les uns approchent plus
du quarré parfait & les autres du lozange. Ces
derniers font le plus en ufage, parce qu’ ils
creufent plus profondément la ta ille , lui donnent
une plus belle couleur & plus de folidité.
Voye\ l’article Gravure au burin»
K fcfc îj