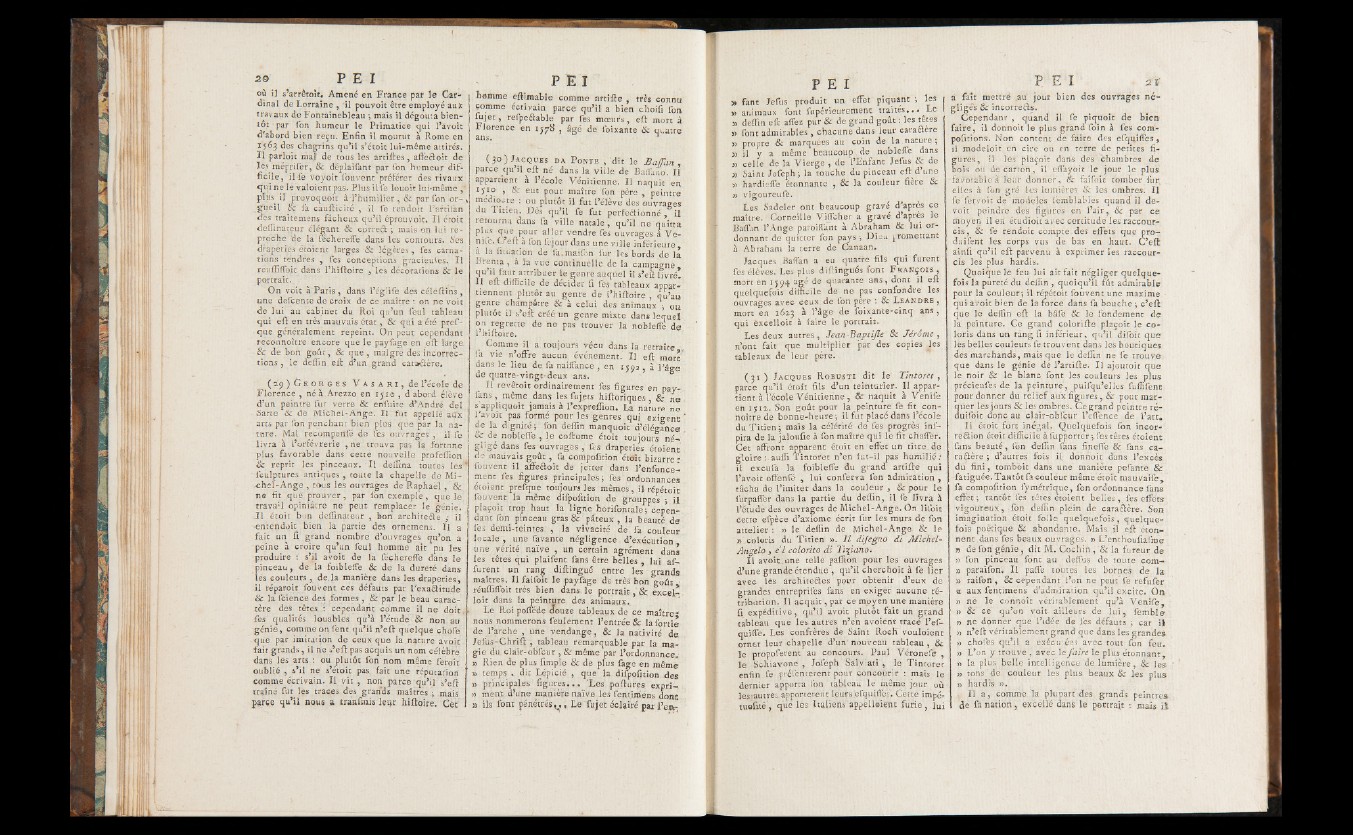
2© P E I
où i] s’arrêtoit. Amené en France par le Cardinal
de Lorraine , il pouvoit être employé aux
travaux de Fontainebleau •, mais il dégoûta bientôt
par fon humeur le Primatice qui l’àvoit
d’abord bien reçu. Enfin il mourut à Rome'en
1563 des chagrins qu’ il s’étoit lui-même attirés.
I l parloit mal de tous les artiftes, affect oit de
les mëprifer, 8c déplaifant par fon humeur diffic
ile , il fe voyoit fouvent préférer des rivaux
<jui ne le valoient pas. Plus il le louoit lui-même
plus il proyoquoit à l ’humilier , &: par fon or- ,
gueil & fa caufticité , il fe rendoit l’ artifan
des tfaitemens fâcheux qu’ il eprou voit. I l étoit
deflinaceur élégant & cprreét ; mais on lui reproché
de la féchereffe dans les contours. Ses
draperies étoient larges & légères , les carnations
tendres , fes conceptions gracieuses. Il
reuffiffo.it dans l’hiftoire les décorations & le
portrait.
On voit à Paris , dans l’églife des célèflîns ,
une defcente de croix de ce maître : on ne voit
de lui au cabinet du Roi qu’un feul tableau
qui eft en très mauvais éta t, 8c qui a été presque
généralement repeint. On peut cependant
réconnoître encore que le payfage en eft large.
8c de bon goût, & q ue, malgré des incorrections
, le defîin eft d’ un grand caraâère.
( 29 ) G e o u g e s V A s A r i , de l’école de
Florence , né à Arezzo en 15.10 , d abord élève
d’un peintre fur verre & enfuite d’André del
Sarre & de Michel-Ange. Il fut appelle aiTx
arts par fon penchant bien plus que par la nature.
Mal recompeüfé de fes ouvrages , il fe
livra à l’orfèvrerie , ne trouva pas la fortune
plus favorable dans cette nouvelle profefîion
8c reprit les pinceaux. I l deffina toutes les*
fculptures antiques , toute la chapelle de Michel
Ange , tous les ouvrages de Raphaël, 8c
ne fit que prouver, par l’on exemple, que le
travail opiniâtre ne peut remplacer le génie.
J 1 étoic bon deflinâteur , bon architeéle ; il
•entendoit bien la partie des ornemens. Il a
fait un fi grand nombre d’ouvrages qu’on a
peine à croire qu’ un feul homme ait pu les
produire : s’ il avoit de la féchereffe dans le
pinceau, de- la foiblefTe & de la dureté dans
lés couleurs , de. la manière dans les draperies,
il réparoit fouvent ces défauts par Fexaâitude
ik la lcience des .formes , & par lé beau caractère
des têtes : cependant comme il ne doit,
fes qualités louables qu’à l’étude & non au
génie, comme on, refit' qu’ il n’ eft quelque chofe
que par imitation de ceux que la nature avoir
fait grands, il ne s’ eft pas acquis un nom célèbre
dans les arts : ou plutôt fon nom même fëroit
oublié , s’ il ne s’étoit pas fait une réputation
comme écrivain. I l vit , non parce qu’iTs ’eft
traîné fur les traces des grands maîtres • mais
parce qu’ il nous a tranfinis leur hiftoire. Cet
p e 1
homme eftimable comme artifte , très connu
Comme écrivain parce qu’ il a bien choifi fon,
ftije t, refpeékable par fes moeurs, eft mort à
hlorence en 157b , âgé de foixante 8c quatre
ans. *
(3 0 ) Jacques da Ponte , dit le BaJTan
parce qu’ il eft né dans la ville, de Baffano. I l
appartient à l’école Vénitienne. Il naquit -en
fJ.1® > & eut pour maître fon père , peintre
médiocre : ou plutôt il fut l’élève des ouvrages
du Titien. Dès qu’il fe fut perfeélionné , il
retourna dans fa v ille natale, qu’ il ne quitta
plus que pour aller vendre fes ouvrages à Ve-
nilè. G’ eft à fon fejour dans une ville inférieure ,
à la fi tuât ion de fa.maifon fur les bords de la
Brenta, à la vue continuelle de la campagne,
qu’il faut attribuer le genre auquel il s’ eft livrét
; I l eft difficile de décider fi fes tableaux appartiennent
plutôt au genre de i’hiftoire , qu’au
genre champêtre 8c à celui des animaux ; ou
plutôt il s’ eft créé un genre mixte dans lequel
on regrette de ne pas trouver la nobleffe de 1 hiftoire.
Comme il a toujours vécu dans la retraite
fa vie n’offre aucun, événement. I l eft mort
dans le lieu de fa naiffance , en 1592 , à T âg e
de quatre-vingt-deux ans.
Il revêtoit ordinairement fes figures en pay-
fans , même dans les fuj.ets hiftoriques, & ne
s’appliquoit jamais à l’exprefïion. La nature ne
l’avoit pas formé pour les genres qui exigent
de la dignité-, fon deffin manquoit d’élégafice
Sr de nobleffe , le coftume étoit toujours né-*
gligé dans fes ouvrages , fes draperies étoient
de mauvais goût , fa compofition étoit bizarre r
fouvent il affedoit de jetter dans l’enfoncement
fes figures principales; fes ordonnances
étoient prefque toujours les mêmes, il répétoit
fouvent la même difpofition de grouppes ; il
plaçoit trop haut la ligne horifontale; cependant
fan pinceau gras 8c pâteux , la beaute.de
fes demi-teintes , la vivacité de fa couleur
locale , une favante négligence d’ exécution
une vérité, naïve , un certain agrément dans
les têtes qui plaifent fans être belles , lui af-
furent un rang diftingué entre les-grands
maîtres. Il faifoit le payfage de très bon goût ■
réufliffoit très bien dans, le portrait, & excel*.
loit dans la peinture des animaux.
Le Roi pofféde douze tableaux de ce maître-
nous nommerons feulement l’entrée & lafortie
de l’arche , une vendange , & la nativité de
Jefus-Chrift , tableau remarquable par la magie
du clair-obfcur , 8c même par l’ordonnance,
» Rien de plus fimple & de plus fage en même
» temp$ , ait Lépicié , que la difpofition des
» principales figure s.. . Xes poftures ex p art
ment a*ime manière naïve Jes lentiifiens donc
» ils font pénétrés . » « Le fujet éclairé par l ’ea-
P E I
» fant Jefus produit un effet piquant ; les
» animaux font fupérieurement t r a i t e s * L e
» deffin eft affez pur & de grand goût : les têtes
» font admirables , chacune dans leur caraélere
» propre 8c marquées au coin de la nature ;
» i l y a même beaucoup de nobleffe dans
» celle de îa Vierge , de l’Enfant Jefus & de
» Saint Jofeph ; la touche du pinceau eft d une
» hardieffe étonnante , & la couleur fiere 8c
» vigoureufe.
Les Sadeler ont beaucoup gravé d’après ce
maître. Corneille Viffcher a gravé d’après le
Baffan l’Ange parôiffant à Abraham & lui or"
donnant de quitter fon pays ; Dieu promettant
à Abraham la terre de Canaan.
Jacques Baffan a eu quatre fils qui furent
fes élèves. Les plus diftingués font F rançois ,
mort en 1594 aS>® de ans, dont il èft
quelquefois difficile de ne pas confondre les
ouvrages avec ceux de fon père ; & Leandre ,
mort en 1623. à l’âge de foixante-cinq ans,
qui èxcelloit à faire le portrait.
Les deux autres, Jean-Baptijle & Jérôme ,
n’ont fait que multiplier par des copies Jes
tableaux de leur p.ère.
( 3 1 ) Jacques Robusti dit le Tintoret,
parce qu’ il étoit fils d’un teihturier. 11 appartient
à l’école Vénitienne, & naquit à Venife
en 1512. Son goût pour la peinture'fe fit con-
noître de bonne-heure ; il fut placé dans l’école
du Titien; mais la célérité de fes progrès înf-
pira de la jaloufie à fon maître qui le fit chaffer.
Cet affront apparent étoit en effet un titre., de
gloire :.auffi Tintoret n’ en fut-il pas humilié;
il excufa la foibleffe du grand artiftë qui
l’avoit offenfé , lui conferva l’on admiration ,
tâcha de l’imiter dans la couleur , 8c pour le
furpaffer dans la partie du deffin, il fe livra à
l’étudè des ouvrages de Michel-Ange. On lifoit
cette elpèce d’axiome écrit fur les murs de fon
attelier : » le deffin de Michel-Ange. & le
» coloris du Titien ». I l dijegno di Michel-
Angelo , e l colorito di Ti\iàno.
Il avoit. une telle pafîion pour les ouvrages
d’ une grande étendue , qu’ il cherchoit à fe lier
avec les architeélës pour obtenir d’eux de
grandes entreprifes fans en exiger aucune rétribution.
Il acquit, par ce moyen une manière
fi expéditive, qu’ il avoit plutôt fait un grand
tableau que les autres n’en avoiënt tracé l’ef-
quiffe. Les confrères de Saint Roch vouloient
orner leur chapelle d’un- nouveau tableau , 8c
le propoferent au concours. Paul Véronefë ,
le Schiavone , Jofeph Salv:ati , le Tintoret
enfin fe préfenterent pour concourir : mais le
dernier apporta ion tableau le même jour où
lesfautres apporteront leurs efquiffe's, Cétte impé-
tuofité , que les Italiens appelaient furie , lui
P E l ■
â fait metrré .au jour bien des ouvrages né-
gligé's & incorrects.
Cependant' , quand il fe piquoit de bietr
faire, il donnoit le plus grand foin à fes com-
pofitions. Non content de faire des efquifîes,
il modeloit en cire ou en terre de petites figures,
il les plaçoit dans des chambres de
bois ou de éàr'rôn, il'effayoit le jour le plus
favorable à leur donner , 8c faifoit tomber fur;
elles à fon gré les lumières ik les ombres. I l
fë fërvoit de modèles lëmblables quand il dévoie
peindre des figures en l’air, 8c par ce
moyen il en étudioit avec certitude les raccourc
is , & fe rendoic compte, des effets que pro-
duifent les corps vus de. bas en haut. C’eft
ainfi qu’ il eft parvenu à exprimer les raccourcis
les plus hardis.
Quoique le feu lui ait fait négliger quelquefois
la pureté du deffin , quoiqu’ il fût admirable
pour la couleur; il répétoit fouvent une maxime
qui avoit bien de la force dans fa bouche ; c’eft
que lë deffin eft la bâfé & le fondement de
la peinture. Ce grand colorifte. plaçoit le coloris
dans un rang fi inférieur, qu’il difoit que
; lès belles couleurs fe trouvent dans les boutiques
des marchands, mais que le deffin ne fe trouve
que dans le génie dè l’artifte; II ajoutoit que
le noir 8c le blanc font les couleurs les plus
précieufes de la peinture, puifqu’elles fuffifent
pour donner du relief aux figures, & pour marquer
les jours & les ombres. Ce grand peintre ré-
duifoit donc au clair-abfcur l’effence de l’art.
I l étoit fort inégal. Quelquefois fon incor-
reétion étoit difficile à fupporter ; fes têtes étoient
fans beauté, fon deffin fans fineffe 8c fans ca-
ra&ère ; d’autres fois il. donnoit dans l ’excès
du fin i, tomboit dans une manière pefante &
fatiguée. Tantôt fa coulëur même étoit mauvaife,
fa compofition fymétrique, fon ordonnance fans
effet ; tantôt fes têtes étoient b elles, fes effets
vigoureux, fon deffin plein de caractère. Son
imagination étoit folle quelquefois, quelquefois
poétique 8c abondante. Mais il eft étonnent
dans fes beaux ouvrages. » L’ enthoufiafme
» de fon génie , dit M. Cochin , & la fureur de
» fon pinceau font au deffus de toute com-
» paraifon. I l paffe toutes les bornes de la
» raifon, & cependant l ’on ne peut fe refufer
et aux fentimëns d’admiration qu’ il excite. On
» ne le connoît véritablement qu’à V en ife -
» 8c ce qu’on voit ailleurs de lu i, femble
» ne donner que l’idée de fes défauts ; car il
n n’ èft véritablement grand que dans les grande»
» choies qu’il a exécu:ées avec tout fon feu*
» L’ on y trouve , avec lé faire le plus étonnant,
» la plus belle intelligence de lumière, 8c les-
» tons dé couleur les plus beaux & les plus
» hardis ».
v II a , comme la plupart des grands peintres
de fanation , excellé dans le portrait :: mais i l