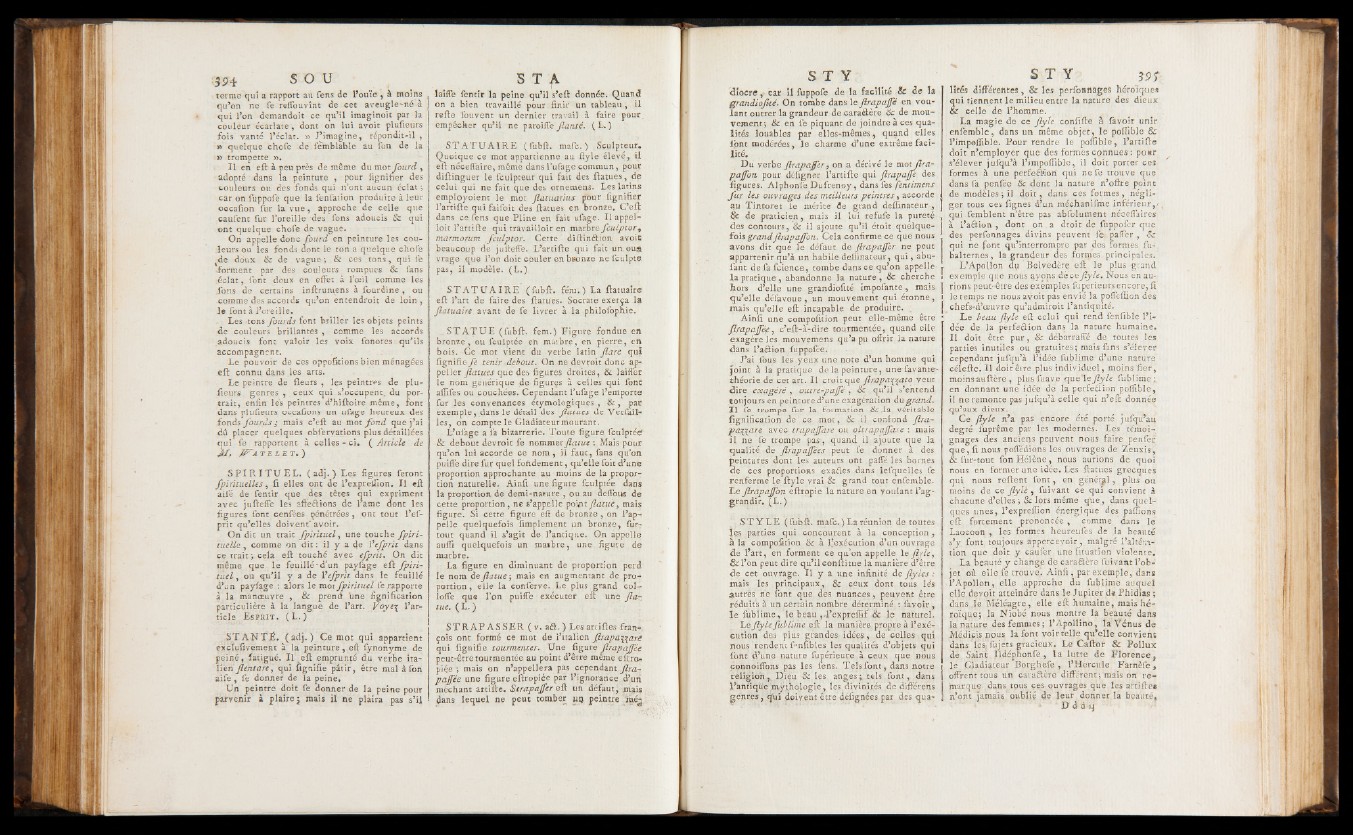
terme qui a rapport au fens de l’o u ïe , à moins
qu’on ne fe r«flouvînt de cet aveugle-né à
qui l’on demandoit ce qu’ il imaginoit par la
couleur écarlate, dont on lui avoit plufieurs
fois vanté l’éclat. » J’ imagine, répondit-il ,
» quelque chofe de femb labié au ion de la
» trompette ».
I l en eft â peu près de même du mot fourd ,
adopté dans la peinture , pour figniner des
couleurs ou des fonds qui n’ont aucun éclat -,
car on fuppofe que la fenfation produite à leur
oocaiion fur la v u e , approche de celle que
caufent fur l’oreille des fons adoucis & qui
ont quelque chofe de vague.
On appelle donc fourd en peinture les couleurs
ou les fonds dont le ton a quelque chofe
de doux & de vague; & ces tons, qui fe
forment par des couleurs rompues & fans
;éclat, font doux en effet à l’oeil comme les
fons de certains inftrumens à fourdine , ou
comme des accords qu’on entendroit de loin ,
le font à X?oreille.
Les .tons fourds font briller les objets peints
de couleurs brillantes , comme les accords
adoucis font valoir les voix fonorest qu’ ils
accompagnent.
Le pouvoir de ces oppofitions bien ménagées
eft connu dans les arts.
Le peintre de fleurs , les peintres de plufieurs
genres , ceux qui s’occupent, du portrait,
enfin les peintres d’hiftoire même, font
dans plufieurs occafions un ufage heureux des"
fonds fourds / mais c’ eft au mot fond que j’ai
dû placer quelques obfervations plus détaillées
qui fe rapportent à celles - ci. ( Article de
M t TE LE T , )
S P I R I T U E L , ( a d j . ) Les figures feront
fpirituelles, fi elles ont de l’exprelfion. I l eft
ailé de fentir que des têtes qui expriment
avec jufteffe les afteélions de l’ame dont les
figures font cenfées pénétrées , ont tout l’ef-
prit qu’ elles doivent' avoir.
On dit un trait fpirituel, une touche fpiri-
tue lle , comme on dit : il y a 4e Ÿefprit dans
ce trait; cela eft touché avec efprit. On dit
même que le feuille*d’ un payfage eft fpiri-
tu e l, ou qu’ il y a de Ÿefprit dans le feuille
d’un payfage : alors le mor fpirituel fe rapporte
a la manoeuvre , & prend une lignification
particulière à la langue de l’art. Voye\ ^article
Esprit. ( L. )
S T A N T É . ( a d j.) Ce mot qui appartient
exclufivement à la peinture,.eft fynonyme de
peiné, fatigué. I l eft emprunté du verbe italien
fient are, qui lignifie pâtir, être mal à fon
a i fe , fe donner de la peine.
Un peintre doit fe donner de la peine pour
parvenir à plaire $ mais il ne plaira pas s’ il
laifle fentir la peine qu’il s’eft donnée. Quand
on a bien travaillé pour finir un tableau, il
refte 'Couvent un dernier travail à faire pour
empêcher qu’ il ne paroiffe fianté. ( L. )
S T A T U A IR E (fubft. mafe. ) Sculpteur.
Quoique ce mot appartienne au ftyle élevé, il
eft néceffaire, même dans l ’ufage commun, pour
diftinguer le fculpteur qui fait des ftatues, de
celui qui ne fait que des orne mens. Les latins
employoient le mot fiatuarius pour fignifier
l ’artifte qui faifoit des ftatues en bronze. C’eft
dans ce fens que Pline en fait ufage. U appel-
loit l’artifte qui travailloir en marbre fculptor,
marmorum fculptor. Cette diftinétion avoic
beaucoup de jufteffe. L’artifte qui fait un.oust
vrage que l’on doit couler en bronze ne fculpte
pas, il modèle. (L .)
S T A T U A IR E (fubft. fém.) La ftatuaire
eft l’art de faire des ftatues. Socrate exerça la
Jlatuaire avant de fe livrer à la philoiophie.
. .S T A T U E (fubft. fem.) Figure fondue en.
bronze, ou fculptée en marbre, en pierre, en
bois. Ce mot vient du verbe latin jlare qui
fignifie fe tenir debout. On ne devroit donc ap-
peller ftatues que des figures droites, & laiffer
le nom générique de figures à celles qui font
affifes ou couchées. Cependant l’ufage l’emporte
fur les convenances étymologiques , & , par
exemple, dans le détail des ftatues de Verfail^
les, on compte le Gladiateur mourant.
L’ ufage a fa bizarrerie. Toute figure fculpteef
& debout devroit fe nommer Jlatue : Mais pour
qu’on lui accorde ce nom, il faut, fans qu’on
puiffe dire fur quel fondement, qu’elle foit d’ une
proportion approchante, au moins de la proportion
naturelle. Ainfi une figure fculptée dans
la proportion de demi-nature , ou au aeffous de
cette proportion, ne s’appelle po’yn jlatue, mais
figure. Si cette figure eft de bronze, on l’appelle
quelquefois fimplement un bronze, fur7
tout quand il s’agit de l’antique. Qjn appelle
aufli quelquefois un marbre, une figure de
marbre.
La figure en diminuant de proportion per à
le nom dejlatue ; mais en augmentant de proportion
, elle la conferve. Le plus grand col-
loffe que l’on puiffe exécuter eft une fia t
tue. ( L. )
S T R A P A S S E R ( v. aél. ) Les artiftes fran-
çois ont formé ce mot de i’ italicn firapa-ftaré
qui fignifie tourmenter. Une figure firapajfét
peut-être tourmentée au point d’être même eïtro*
piçe ; mais on n’appellera pas cependant, y2/vz-
pajfée une figure eftropiée par l’ ignorance d’ un
méchant artifte. Strapajfer eft un défaut^ mais
dans lequel ne peut tomber uq peintre. 3né^
idîodre v car il fuppofe de la facilité & de la
grandiofité. On tombe dans le firapajfé en voulant
outrer la grandeur de caraâère 6c de mouvement;
& en fe piquant de joindre à ces qualités
louables par elles-mêmes., quand elles
lpnt modérées, le charme d’une extrême facilité.
Du verbe firapafier, on a dérivé le mot fira-
pajfon pour défigner l’artifte qui firapajfé des
figures. Alphonfe Dufrenoy, dans fes fentimens
fu r les ouvrages des meilleurs peintres, accorde
au Tintoret le mérite de grand defîinateur ,
& de praticien , mais il lui refufe la pureté ,
des contours, & il ajoute qu’ il étoit quelque- j
fois grandfirapajfon. Ceia confirme ce que nous ;
avons dit que le défaut de firapajfer ne peut :
appartenir qu’à un habile defîinateur, q u i, abu-
fant de fa fcience, tombe dans ce qu’on appelle-
la pratique, abandonne la nature, 8c cherche ;
hors d’elle une grandiofité impofante, mais
qu’ elle défavoue, un mouvement qui étonne,
mais qu’elle eft incapable de produire. .
Ainfi une compofition peut elle-même être
ftrapajféfi, c’eft-à-dire tourmentée, quand elle
exagère les mouvemens qu’a pu offrir la nature
dans l ’aâion fuppofée.
J’ai fous les yeux une note d’un homme qui
joint à la pratique de la peinture, unefavante-
théorie de cet art. I l croit que firapa^ato veut
dire exagéré, outre-pajfé, & .qu’ il s’entend
toujours en peinture d’ une exagération du grand.
I l fe trompe fur la formation & ,1a véritable j
lignification de ce mot, & il confond fira-
pafâare avec trapajfare ou oltrapajfare : mais
i l ne fe trompe pas, quand il ajoute que la
qualité de flrapajfées peut fe donner a des
peintures dont les auteurs ont paffé les bornes
de ces proportions exades dans lefquelles fe
renferme le ftyle vrai 8c grand tout enfemble.
Le firapajfon eftropie la nature en voulant l’ag-
grandir. (L .)
S T Y L E (fubft. mafe.) La réunion de toutes
les parties qui concourent à la conception,
à la" compofition & à Inexécution d’un ouvrage
de l’art, en forment ce qu’on appelle le fiyle,
& l’ on peut dire qu’ il conflitue la manière d’être
de cet ouvrage. Il y a une infinité de fiyles :
mais les principaux, & ceux dont tous lés
Autres ne font que des nuances, peuvent être
réduits à un certain nombre déterminé, : favoir ,
le fublime, le beau , 4’expreffif & le naturel.
Le fiyle fublime eft la manière propre à l’exécution
des plus grandes idées, de celles qui
nous rendent ffinfibles les qualités d’objets qui
font d’une nature fupérieure à ceux que nous :
connoiffons pas les fens. Tels font, dans notre ;
religion ,s Dieu & les anges tels font, dans
l ’antiqife mythologie, les divinités de différens
genres, qbi doivent être désignées par des qualïtés
différentes, & les perfonnages héroïques
qui tiennent le milieu entre la nature des dieux
8c celle de l ’homme.
La magie de ce fiy îe confifte à favoir unir
enfemble, dans un même objet, le pofîible 8c
l’ impoffible. Pour rendre le pofîible, l ’artifte
doit n’employer que des formes connues : pour
s’élever jufqu’à l’ impoffible, il doit porter ces
formes à une perfection qui ne fe trouve que
dans fa penfée 8c dont la nature n’offre point
de modèles ; il d o it, dans ces formes, négliger
tous ces fignes d’ un méchanifme inférieur,/
qui femblent n’être pas abfolument néeeffaires
j à i ’aétion , dont on a droit de fuppofer que
^ des perfonnages. divins peuvent fe paffer , 8c
Iqui ne font qu’ interrompre par des formes fu-
balternes, la grandeur des forrnes principales.
T L’Apollon du Belvédère eft le plus grand
i exemple que noùs ayons de ce fiyle. Nous en au-
| rions peut-être des exemples fupérieurs encore, fi
i le temps ne nous avoit pas envié la poffeflion dès
j chefs-d’oeuvre qu’admiroit l ’antiquité.
1 Le beau fiyle eft celui qui rend fenfible l’ idée
de la perfection dans la nature humaine.
Il doit être pur, 8c débarraffé de toutes les
parties inutiles ou gratuites ; mais fans s’élever
• cependant jufqu’à l’idée fublime d’ une nature
- célefte. U doitêire plus individuel, moins fier,
moins auftère , plus fuave que le fiyle fublime ;
en donnant une idée de la perfeâion pofîible.,
. il ne remonte pas jufqu’ à celle qui n’eft donnée
qu’aux dieux.
Ce fiyle n’a pas encore été porté jufqu’au
degré luprême par les modernes. Les témoignages
des anciens peuvent nous faire penfer
que, fi nous pofledions les ouvrages de Zeuxis,
& fur-tout fon Hélène, nous aurions de quoi
nous en former une idée. Les ftatues grecques
qui nous relient fon t, en général , plus ou
moins de ce f iy le , fuivant ce qui convient à
chacune d’ elles ; & lors même que , dans quelques
unes, l ’expreffion énergique dçs paffions
eft fortement prononcée , comme dans le
Laocoon , les formes heureufes de la beauté
s’y font toujours appercevoir, malgré l’altér.i-
tion que doit y caufer une fituation violente,
La beauté y change dé caraélère fuivant l’objet
où elle fe trouve,! Ainfi , par exemple, dans
l’Apollon, elle approche du fublime auquel
elle devoit atteindre dans le Jupiter de Phidias ;
dans J e Méléagre, elle eft humaine, mais héroïque;
la N'iobé nous montre la beauté dans
la nature des femmes; l’Apollino, la Vénus de
Médici,s npus la font voir telle qu’ elle convient
dans fes! lu jets gracieux. Le Caftoir & Pollux
de Saint Ildéphonfè, la lutte de Florence,
le Gladiateur Borghèfe, l’Hercule Farnèfe ,
offrent tous un caraélère différent; mais on remarque
dans tous çes ouvrages que les artiftes
n’ont jamais oublié 4e leur donner la beauté*
D d d i.j