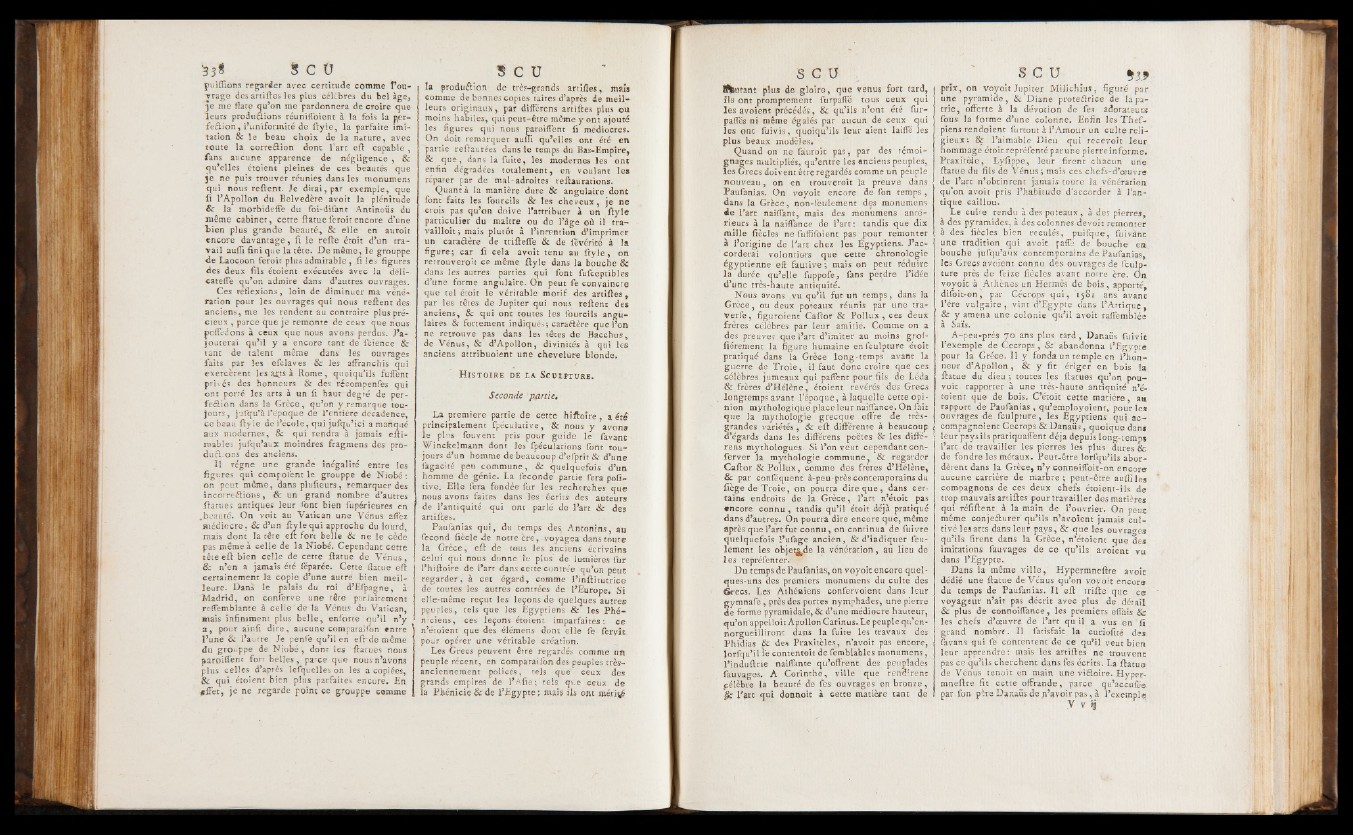
5 3 * S C Ü
çuifïions regarder avec certitude comme ï ’ou-
yrage des artiftes les plus célébrés du bel âge,
je me flate qu’on me pardonnera de croire que
leurs produdions réunifiaient' à la fois la perfection
, l’uniformité de fty le , la parfaite imitation
& le beau choix de la nature, avec
toute la corre&ion dont l ’art eft capable ,
fans aucune apparence de négligence , &
qu’elles étoienc pleines de ces beautés que
je ne puis trouver réunies dans les monumens
qui nous reftent. Je dirai, par exemple, que
fi l’Apollon du Belvedère avoir la plénitude
& la morbideffe du foi-difant Antinous du
même cabinet, cette ftatue feroit encore d’une
bien plus grande beauté, & elle en auroit
encore davantage, fi le refte étoit d’un travail
aufli fini que la tête. De même, le grouppe
de Laocoon feroit plus admirable , fi les figures
des deux fils étoient exécutées avec la déli-
catefle qu’on admire dans d’autres ouvrages.
Ces réflexions, loin de diminuer ma vénération
pour les ouvrages qui nous reftent des
anciens, me les rendent au contraire plus précieux
, parce que je remonte de ceux que nous
pcffedons à ceux que nous avons perdus. J’ajouterai
qu’ il y a encore tant de fcience &
tant de talent même dans les ouvrages
faits par les efclaves & les affranchis qui
exercèrent les açts à Rome, quoiqu’ils fuflent
privés des honneurs & des récompenfes qui
ont porté les arts à un fi haut degré de per-
feélion dans la Grèce, qu’on y .remarque toujours,
jufqu’à l’époque de l ’entière décadence,
ce beau ftyle de l’école, qui jufqu’ ici a manqué
aux modernes, & qui rendra à jamais efti-
mables jufqu’aux moindres fragmens des pro-
du&:ons des anciens.
Il régne une grande inégalité entre les
figures qui compolent le grouppe de Niobé :
on peut mêmè, dans plufieurs, remarquer des
Incorrections, & un grand nombre d’autres
ftatues antiques leur font bien fupérieures en
.beauté. On voit au Vatican une Vénus aflez
médiocre. & d’un ftyle qui approche du lourd,
mais dont la tête eft fort belle & ne le cède
pas même à celle de la Niobé. Cependant cette
tête eft bien celle de cette ftatue de Vénus,
& n’en a jamais été féparée. Cette flatue eft
certainement la copie d’ une autre bien meilleure.
Dans le palais du roi d’Efpagne, à
Madrid, on conferve, une tête parfaitement
reflemblante à c e lle 'd e la Vénus du Vatican,
mais infiniment plus b elle, enforte qu’ il n’y
a , pour ainfi dire, aucune comparaifon entre
l ’une & l’autre. Je penfe qu’il en eft-de même
du grouppe de Niobé, dont les ftatues nous
paroiffent fort b elles, parce que nous n’avons
plus celles d’ après lefquelles on les a copiées,
& qui étoient bien plus parfaites encore. En
#ffet, je ne regarde point ce grouppe comme
s c u la produélion de très-grands artïfles, mais
comme de bonnes copies laites d’après de meil-
: leurs originaux, par différens artiftes plus ou
moins habiles, qui peut-être même y ont ajouté
les figures qui nous paroi fient fi médiocres.
On doit remarquer aulfi qu’elles ont été en
partie reftaurées dans le temps du Bas-Empire,
& que, dans la fuite, les modernes les ont
enfin dégradées totalement, en voulant les
réparer par de mal-adroites reftau rations.
Quanta la manière dure & angulaire donc
font faits les fourcils & les cheveux, je ne
crois pas qu’on doive l’attribuer à un ftyle
particulier du maître ou de l’âge où il tra-
vailloit; mais plutôt à l’innention d’imprimer
un caraétère de trifteffe & de féyérité à la
figure; car fi cela avoit tenu au f ty le , on
retrouveroît ce même ftyle dans la bouche &
dans les autres parties qui font fufceptibles
d’une forme angulaire. On peut fe convaincre
que tel étoit le véritable motif des artiftes,
par les têtes de Jupiter qui nous reftent des
anciens, & qui ont toutes les fourcils angulaires
& fortement indiqués; caraélère que l’on
ne retrouve pas dans les têtes de Bacchus,
de Vénus, & d’Apollon, divinités à qui les
anciens attribuoient une chevelure blonde.
Histoire de la Sculpture.
Seconde p.artie,
La première partie de cette hiftoîre, a été
principalement fpéculative, & nous y avons
le plus fouvent pris pour guide le favant
Winckelmann dont les fpéculations font toujours
d’un homme de beaucoup d’efprit ik d’une
fagacité peu commune, & quelquefois d’un,
homme de génie. La fécondé partie fera pofi-
tive. Elle fera fondée fur les recherches que
nous avons faites dans les écrits des auteurs
de l’antiquité qui ont parlé de l’art & des
artifices.
Paufanias qui, du temps des, Antonins, au
fécond fiècle Je notre ère, voyagea dans toute
la Grèce, eft de tous les anciens écrivains
celui qui nous donne le plus de lumières fur
l’hiftoire de l’art dans cette contrée qu’ on peut
regarder, à cet égard, comme l’inftitutrice
de toutes les autres contrées de l’Europe. Si
elle-même reçut les leçons de quelques autres
peuples., tels que les Egyptiens & les Phéniciens,
ces leçons étoient imparfaites: ce
n’étoient que des élémens dont elle fe fer vit.
pour opérer une véritable création.
Les Grecs peuvent être regardés comme un
peuple récent, en comparaifon. des peuples très-
anciennement policés, tels que ceux des
grands empires de l’ Afie; tels, que ceux de
la Phénicie & de l’Egypte ; mai? ils ont mérité
S C O
tffcurant plus Je gloire, que venus fort tard,
ils ont promptement furpaffé tous ceux qui
les avoient précédés, & qu’ils n’ont été fur-
paflès ni même égalés par aucun de ceux qui
les ont fuivis , quoiqu’ ils leur aient laiffe les
plus beaux modèles.
Quand on ne fàuroit pas, par des témoignages
multipliés, qu’entre les anciens peuples,
les Grecs doivent être regardés comme un peuple
nouveau, on en trouveroit la preuve dans
Paufanias. On voyoit encore de fon temps,
dans la Grèce, non-feulement des monumens
«le l ’art naiffant, mais des monumens antérieurs
à la naiffance de l’art: tandis que dix
mille fiècles ne fuffifoient pas pour remonter
a l ’origine de l’art chez les Égyptiens. J’accorderai
volontiers que cette chronologie
égyptienne eft fautive; mais on peut réduire
la durée qu’elle fuppofe, fans perdre l’ idée
d’une très-haute antiquité.
Nous avons .vu qu’ il fut un temps, dans la
Grèce, ou deux poteaux réunis par une tra-
v e r fe , figuroient Caftor & Pollux , ces deux
frères célèbres par leur amitié. Comme on a
des preuves que l’art d’ imiter au moins grof-
fiérement la figure humaine enfculpture étoit
pratiqué dans la Grèce long-temps avant la
guerre de Tro ie , il faut donc croire que ces
célèbres jumeaux qui paffent pour fils de Léda
& frères d’Hélène, étoient révérés des Grecs
longtemps avant l’époque, à laquelle cette opinion
mythologique place leur naiflance. On fait
que la mythologie grecque -offre de très-
grandes variétés, 6c eft différente à beaucoup
d’égards dans les différens poètes & les différens
mythologues. Si l’on veut cependant con-
ferver la mythologie commune, & regarder
Caftor & Pollux, comme des frères d’Hélène,
& par conféquent à-peu-près contemporains du
liège de Troie, on pourra dire que, dans certains
endroits de la Grèce, l’ art n’étoit pas
•ncore connu , tandis qu’ il étoit déjà pratiqué
dans d’autres. On pourra dire encore que, même
après que l’art fut connu, on continua de fuivre
quelquefois i’ ufage ancien, & d’ indiquer feulement
les objetj^de la vénération, au lieu de
les repréfenter.’ ”
Du temps de Paufanias, on voyoit encore quelques
uns des premiers monumens du culte des
Grecs. Les Athéniens confervoient dans leur
gymnafe , près des portes nymphades*, une pierre
de forme pyramidale, & d’une médiocre hauteur,
qu’on appelloit Apollon Carinus. Le peuple qu’en-
norgueilliront dans la fuite les travaux des
Phidias & des Praxitèles, n’avoit pas encore,
Jorfqu’ il le contentoit de femblables monumens,
l’ induftrie naiflante qu’offrent des peuplades
fauvages. A Corinthe, v ille que rendirent
pélèbre la beauté de fes ouvrages en bronze,
jk l ’^rt qui donnoit à cette matière tant de
S C ü
prix, on voyoit Jupiter Milichîus, figuré par
une pyramide, & Diane proteârice de la patrie,
offerte à la dévotion de fes adorateurs
fous la forme d’une colonne. Enfin les Thef-
piens rendoient furtout à l’Amour un culte religieux:
& l ’aimable Dieu qui recevoit leur
hommage étoit repréfenté par une pierre informe.
Praxitède, Lÿfippe, leur firent chacun une
ftatue du fils de Vénus ; mais ces chefs-d’oeuvre
de l ’art n’obtinrent jamais toute la vénération
qu’on àvoit pris l ’habitude d’accorder à l’antique
caillou.
Le cube rendu à des poteaux, à des pierres,
à des pyramides, à des colonnes devoit remonter
à des fiècles bien reculés, puifque, fuivànt
une tradition qui avoit paffe de bouche ea
bouche jufqu’aux contemporains de Paufanias,
les Grecs avoient connu des ouvrages de fculp-
ture près de feize fiècles avant norre ère. On
voyoit à Athènes un Hermès de bois, apporté,
difoit-on, par Cecrops q u i, 1581 ans avant
l ’ère vulgaire, vint d’Egypte dans l’Afriqu e,
& y amena une colonie qu’ il avoit raflémblée
à Sais.
A-peu-près 70 ans plus tard, Danaüs fuivit
l’exemple de Cecrops, & abandonna l’Egypte
pour la Grèce. I l y fonda un temple en l’honneur
d’Apollon, & y fit ériger en bois la
ftatue du dieu ; toutes les ftatues qu’on pnu-
voic rapporter à une très-haute antiquité n’étoient
que de bois, C’étoit cette matière ait
rapport de Paufanias, qu’employoient, pour les
ouvrages de fculpture, les Egyptiens qui ac-
compagnoient Cecrops & Danaüs, quoique dans
leur pays ils pratiquaient déjà depuis long-temps
l’art-de travailler les pierres les plus dures &
de fondre les métaux. Peut-être lorfqu’ ils abordèrent
dans la Grèce, n’y conneiffoit-on encore
aucune carrière de marbre ; peut-être aufli les
compagnons de ces deux chefs étoient-ils de
trop mauvais artiftes pour travailler des matières
qui réfiftent à la main de l’ouvrier. On peut
même conje&urer' qu’ ils n’avoïent jamais cultivé
les arts dans leur pays, & que les ouvrages
qu’ ils firent dans la Grèce, n’étoient que des
imitations fauvages de ce qu’ ils avoient ru
dans l’Egypte.
Dans la même v ille , Hypermneftre avoit
dédié une ftatue de Vénus qu’on voyoit encore
du temps de Paufanias. Il eft rrifte que ce
voyageur n’ait pas décrit avec plus de détail
& plus de connoiflance, les premiers eflais &
les chefs d’oeuvre de l’art qu il a vus en fi
grand nombre. Il fatisfait la curiofité des
favans qui fe contentent de ce qu’ il veut bien
leur apprendre : mais les artiftes ne trouvent
pas ce qu’ils cherchent dans fes écrits. La ftatue
de Vénus tenoit en main une viéloire. Hypermneftre
fit cette offrande, parce qu’accufé©
par fon père Danaüs de n’gyoir pas, à l ’exemple