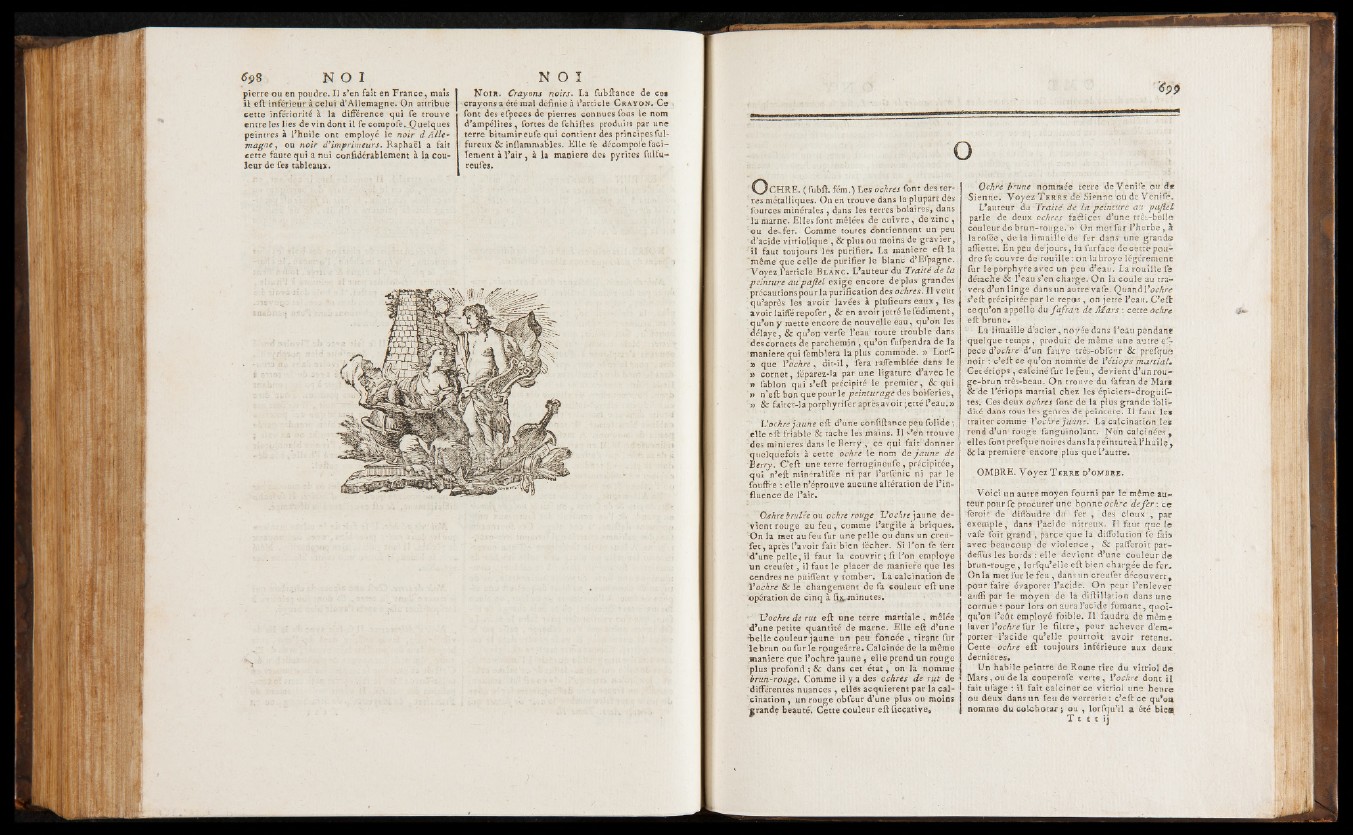
pierre ou en poudre. Il s’ en fait en France, mais
i l eft inférieur à celui d’Allemagne. On attribue
cette infériorité à la différence qui fe trouve
entre les lies de vin dont il fecompofe ^Quelques
peintres à l’huile ont employé le noir d Aile*
magne, ou noir d’ imprimeurs. Raphaël a fait
cette faute qui a nui confidérablement à la couleur
de Ces tableaux.
N oir. Crayons noirs. La fubftance de ces
crayons a été mal définie à i’arciclè C rayon. Ce
font des efpeces de pierres connues fous le nom
d’atnpélites, fortes de l’chiftes produit* par une
terre bitumireufe qui contient des principesful-
fureux & inflammables. Elle fe décompole facilement
à l’a i r , à la maniéré des pyrites fulfu-
O
reufes. : O c H R E . (Tubft. fern.) Les ochres font des ter-
.res métalliques. On en trouve dans la plupart dès
l'ources minérales , dans les terres bolaires, dans
la marne. Elles font mêlées de cuivre , de zinc ,
ou de*fer. Comme toutes contiennent un peu
' d’acide vitriolique , & plus ou moins de gravier,
il faut toujours les purifier. La maniéré eft la
'même que celle de purifier le blanc d’Efpagne.
Voyez l’article B l a n c . L’auteur du Traité de la
peinture aupaflel exige encore déplus» grandes;
précautions pour la purification des ochres. Il veut
qu’après les avoir lavées à plufieurs eaux, les ,
avoir laiifé repofer, & en avoir jette le fediment,
qu’on y mette encore de nouvelle èau, qu’on lés«
délaye, & qu’on verfe l’eau toute trouble dans;
des cornets de parchemin , qu’on fufpendra de 1a
maniéré qui femblera la plus commode. » Lorf-1
» que Yochre , dit-il, fera raflemblée dans le ?
» cornet, féparez-la par une ligature d’ âvëc le
» fablon qui s’eft précipité le premier, & q u i.
» n’eft bon que pour le peinturage des boiferies,
» & faîtei-la porphyrifer après avoir je.tté l’ eau.» ,
Vochré jaune eft d’une c.bnfiftance pé.u folide -,
elle e ft friable & tâche les mains. I l s’ én trouve
des minières dans le Berry , ce qui faitr donner
quelquefois à cette ochre le nom de jaune de
Berry. C’eft une terre ferrugineufe , précipitée, ,
qui n’eft minéralifée ni par l’arfénic ni par le
fouffre : elle n’éprouve aucune altération de l’ influence
de l’air.
O^thre brûlée ou ochre rouge JY ochre jaune devient
rouge au fe u , comme l’argile à briques.
•On la met au feu fur une pelle ou dans un crert-
fe t, après l’avoir fait bien fécher. Si Ton fe fert
d’une pelle, il faut la couvrir ; fi l’on employé
un creufet, il faut le placer de maniéré que les
cendres ne puiffent y tomber. La calcination de
Yochre & le changement de fa couleur eft une
opération de cinq à fi^minutes.
' U ochre de rut eft une terre martiale , mêlée
d’une petite quantité de marne. Elle eft d’ une
•belle couleur jaune un peu foncée , tira.nt fur
lebrun ou fur le rougeâtre. Calcinée de la même
maniéré que l’ochre jaune , elle prend un rouge
plus profond ; & dans cet éta t, on la nomme
brun-rouge. Comme il y a des ochres de rut de
différentes nuances , elltfs acquièrent par la calcination
, un rouge obfcur d’une plus ou moins
grande beauté. Cette couleur eftficçatiye, ]
Ochée brune nommée terre de.Venife. ou de
Sienne. Voyez T erre dë:Sienne ou de Venifé.
L’auteur d u Traité de la peinture au paflel
parle de deux ochres factices d’une très-belle
couleur de brun-rougë.'» On met fur l’herbe , à
larofée, de la limaille de fer dans une grande
afliette. En peu de jours, la iurfâcë deoëttë poudre
fe couvre de rouille : on labroye légèrement
fur le porphyreàvèc un peu d’ eau. La rouille fe
détache & l’eau s’en charge. On la coule au travers
d’un linge dans un autre vafe. Quand Yochre
s’eft précipitée par le repos , on jette l’eau. C’eft
ce qu’on appelle du fafraa de Mars : cette ochre
eft brune*
La limaille d’a c ier, noyée dans l’eàu pendant
quelque temps, produit de' même une autre ë^
pece àé ochre d’un fauve très-obfcur & prefquè
noir : c’eft ce qu’on nomme de Yêtiops martial,
Cet étiops , calciné fur le feu , devient d’un rouge
brun très-beau. On trouve du fafran de Mar*
& de l’étiops martial chez les épiciers-droguif-
tes. Ces deux ochres font de la plus grande foli»-
dité dans tous lës genres de peinture. Il faut le*
traiter comme Yochre'jaùnc. La calcination le*
rend d’un-rouge. fanguinolant; Non calcinées -
elles font prefque noires dans lapeintureàl’ h u ilç .
& la première encore plus que l ’autre,
OMBRE. Voyez T erre p’ombrp.
Voici un autre moyen fourni par le même auteur
pour fe procurer une hçynne ochre de fe r : ce
ïèroic de diffoudre du fer , des doux , par
exemple, dans l’acide nitreux. Il faut que le
vafe fdit grand , parce que la diffolution fe fais
avec beaucoup de violence , & pafferoit par-
deffus les bords : elle devient d’une couleur de
brun-rouge, lorfqu’elle eft bien chargée de fer.
Onia met fur le feu , dans un creufet découvert,
•pour faire évaporer l’ acide. On peut l’enlever
auffi par le moyen de la diftillation dans une
corniie : pour lors on aural’abide fumant, quoiqu’on
l’eût employé foible. I l faudra de même
laver Yochre fur le filtre, pour achever d’emporter
l ’acide qu’elle pourroit avoir retenu.
Cette ochre eft toujours inférieure aux deux
dernieres.
Un habile peintre de Rome tire du vitriol de
Mars,ou de la couperofe verte, Yochre dont il
fait ufage : il fait calciner ce vitriol une heure
ou deux dans un feu de verrerie : c’eft ce qu’oa
nomme du cokhocar ; ou , lorfqu’ il a été biea