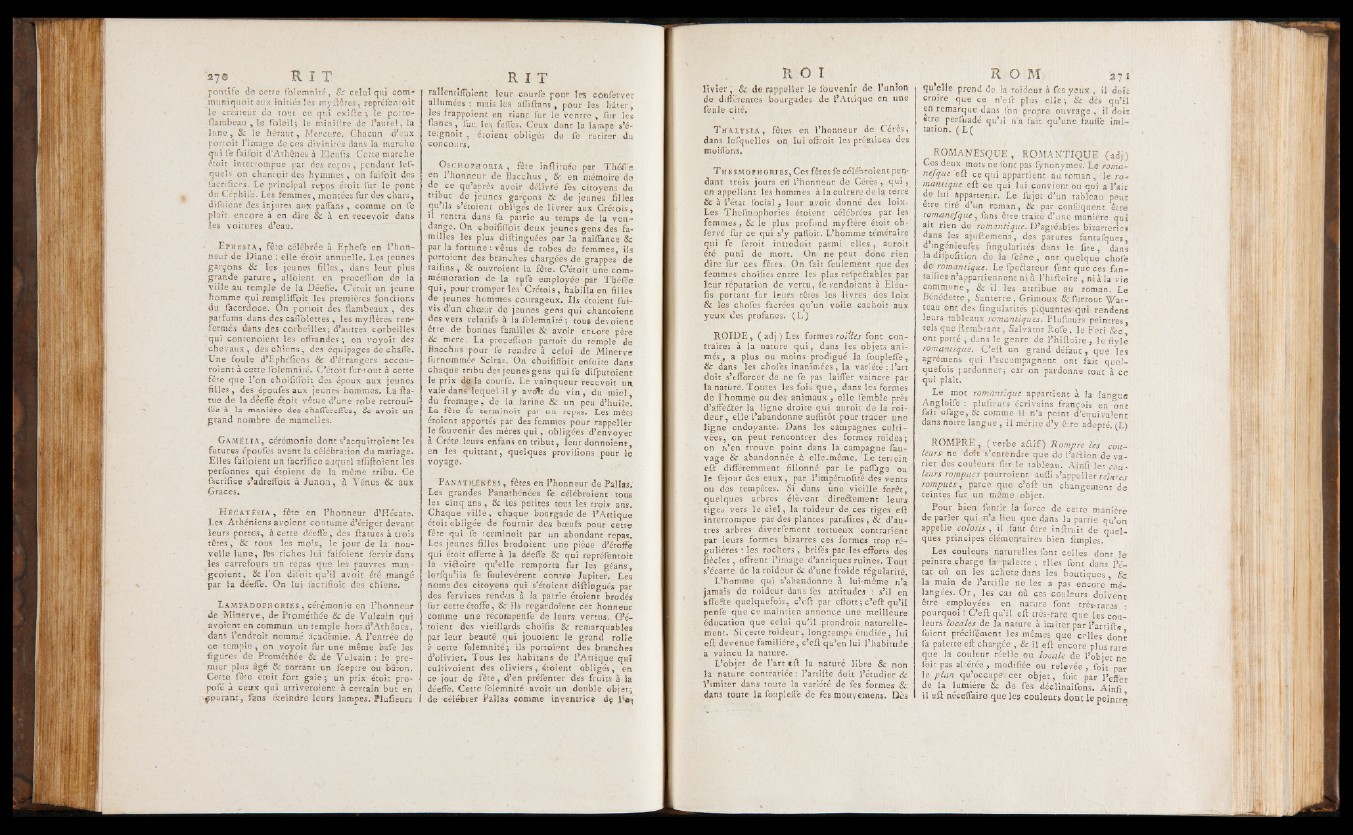
pontife de cette folemnité, 8c celui qui cOîti*
muniquoit aux initiés lès m y Itères-, repréfentoit
le créateur de tout ce qui exifte -, le porte-
flambeau , le fo le il, le miniflre de l’autel, la
lu n e , & le héraut, Mercure. Chacun d’ eux
portoit l’image de ces divinités dans la marche
qui le faifoit d’Athènes à Eleufis Cette marche
étoit interrompue par des repos, pendant le fi-
quels on chanto.it des hymmes, on faifoit des
lacrinces. Le principal repos étoit fur le pont
du Céphifë. Les femmes, montées fur des chars,
difoienc des injures airçc paflàns, comme on le
plaît encore à en dire & à en recevoir dans
les voitures d’eau.
- E ph e s ia , fête célébrée à Ephefe en l’hon-.
neur de Diane : elle étoit annuelle. Les jeunes
garçons & les jeunes filles., dans leur plus
grande parure, alloient en procefïion de la
v ille au temple de la Déefle. C’étoit un jeune
homme qui remplifloit les premières fondions
du Pacerdoce. On portoit des flambeaux , des
parfums dans des caflole-ttes , les myftères ren-~
fermés dans des corbeilles-, d’autres corbeilles'
qui contenoient les offrandes ; on voyoit dés
chevaux , des chiens, des équipages do charte.
Une foule d’Ephcfiens & d’étrangers accou-
roîent à cette folemnité. C’étôit fur-tout à cette
fête que l ’on choififloit des époux aux jeunes I
fille s , des époufes aux jeunes hommes. La fta-
tue de la déeffe étoit vêtue d’ une rpbe retrouf-
fée à la manière des chaflerertes, & avoir un
grand nombre de mamelles.
C amélia, cérémonie dont s’acquittoient les
futures époufes avant la célébration du mariage.
Elles faifoient un facrifice auquel affiftoient les
perfonnës qui étpient de la même tribu. Ce
facrifice s’adrertoit à Junon, à Vénus & aux
(Sraces.
Hécatésia , fête en l ’honneur d’Hécate,
Les Athéniens avpient coutume d’érigcr devant
leurs portes, à cette déefle, des ftatues à trois
têtes, 8c tous les mois, le jour de la nouvelle
lune, lès riches lui faifoient fçrvir dans
les carrefours un repas que les pauvres man ■
geoient, & l’on difoit qu’il avoit été mangé
par la déefle. On lui lacrifioit des chiens.
Lampadophories , cérémonie en l’honneur
de Minerve, de Prpméthée & de Vuleain qui
avoient en commun un temple hors d’Athènes,
dans l’endroit nommé académie. A l’entrée de
c e temple, on yoyoit. fur une même bafe les
figures de Prométhée & de Vuleain : le premier
plus âgé & portant un fçeptre ou bâton.
Cette fête étoit «fort gaie ; un prix étoit pro-
pofé à ceux qui arriveroient à certain but en
-^pujr^nt, fans éteindre leurs lampes. Plufieurs i
i*aïlencïflblent leur courfe pour tes conferver
allumées: mais les afliftans , pour les hâter,
les frappoient en riant fur le ventre , fur les.
flancs,, fur. le^ fertes. Ceux dont la lampe s’é-
teignoit , étoient obligés de fe retirer du
concours,
Oschophoria , fête inflituée par Théfte
en l ’honneur de Bacchus , & en mémoire de
de ce qu’après avoir délivré fes citoyens du
tribut de jeunes garçons & de jeunes .filles
qu’ ils s’étoient obligés de livrer aux Crétois,
il rentra dans fa patrie au temps de la vendange.
On çhoififl’oit deux jeunes gens des familles
les plus diftinguées par la naiflance &
par la fortune : vêtus de robes de femmes, ils
portoient des branches chargées de grappes de
raifins , & ouvroient la fête. C’étoit une commémoration
de la rufe employée par Tljéfée
qui, pour tromper les Crétois, habilla en filles
de jeunes hommes courageux. Us étoient fui-
vis d’un choeur de jeunes gens qui chantoient
des vers relatifs à la folemnité-, tous dévoient
être de bonnes familles & avoir encore père
& mere, La procefïion partoit du temple de
Bacchus pour fe rendre à celui de Minerve
furnommée Scirâs. On choififloit enfuire dans
chaqùë tribu des jeunes gens qui fe difputoient
le prix de la courfe. Le vainqueur recevoit un
vafe danf'lequel il y avoit du vin , du m iel,
du fromage, de la farine 8c un peu d’huile.
La fête fe terminoit par un repas. Les mêts
étoient apportés par des femmes pour rappeller
le fou venir des mères q u i, obligées d’envoyer
à Crète leurs enfans en tribut, leur donnoient,
en les quittant, quelques provifions pour le
voyage.
Panathénées , fêtes en l’honneur de Pallas.
Les grandes Panathénées fe. célébroient tous
les cinq ans, & les petites tous les trois ans.
Chaque v ille , chaque bourgade de l ’Attique
étoit obligée de fournir des boeufs pour cetre
fête qui fe terminoit par un abondant repas.
Les jeunes filles brodoient une pièce d’étoffe
qui étoit offerte à la déefle & qui repréfentoit
la vi&oire qu?elle remporta fur les géans,
lorfqu’ ils fe foulevèrent contre Jupiter. Les
noms des citoyens qui s’étoient diftingués par
des fervices rendus à la patrie étoient brodés
fur cette étoffe, & ils regardoient cët honneur
comme une 'récompenfe de leurs vertus. G’é-
toiént des vieillards choifis 8c remarquables
par leur beauté qui jouoient le grand rolle
è cette folemnité; ils portoient des branches
d’olivier. Tous les habitans de l ’Attique qui
cultivoient des oliviers, étoient obligés, en
ce jour de fê te , d’en préfenter des fruits à la
déefle. Cette folemnité avoit un double objet;
I de célébrer Pallas comme inventrice dç 1%»
liv ie r , 8c de rappeller le fouvenïr de l’ union
de differentes bourgades de l’ Attique en une
feule cité,
T halysia, fêtes en l’honneur de Cérès,
dans lefquelles on lui offroit les prémices des
moiflons.
T hesmophories, Ces fêtes fe célébroient pendant
trois jours en l’honneur de Cérès, q u i,
en appellant les hommes à la culture de la terre
& à l’état focial, leur avoit donné des loix-
Les Thefmophories étoient célébrées par- les
femmes, 8c le plus profond myftère étoit ob-
fervé fur ce qui s’y pafl’oit. L’homme téméraire
qui fe feroit introduit parmi e lle s , auroit
été puni de mort. On ne peut donc rien
dire fur ces fêtes. On fait feulement que des
femmes choifies entre les plus refpe&ables par
leur réputation de vertu, lë rendoient à Eléu-
fis portant fur leurs têtes les livres des loix
& les chofes facrées qu’ un voile cachoit aux
yeux des profanes. (L )
ROIDE , ( adj ) Les formes roules font contraires
à la nature q u i, dans les objets animés.,
a plus ou moins prodigué la fouplefle,
& dans les chofes inanimées, la variété : l’art
doit s’efforcer de ne fe pas laifler vaincre par
la nature. Toutes les fois, que, dans les formes
de l'homme ou des animaux , elle femble près
d’affeéter la ligne droite qui auroit de la roi-
deur, elle l’abandonne auflitôt pour tracer une
ligne ondoyante. Dans les campagnes cultivées,
on peut rencontrer des formes roides;
on n’ en trouve point dans la campagne fau-
vage & abandonnée à elle-même. Le terrein
eft différemment fîllonné par le partage ou
le féjour des eaux, par l’impétuofité des vents
ou des tempêtes. Si dans une vieille forêt,
quelques arbres élèvent dire&ement leurs
tiges vers le c ie l , la roideur de ces tiges eft
interrompue par des plantes parafites , & d’autres
arbres diverfement tortueux contrarient
par leurs formes bizarres ces formes trop régulières
: les rochers, brifés.par les efforts des
fiée l'es , offrent l ’image d’antiques ruines. Tout
s’écarte de la roideur 8c d’une froide régularité.
L’homme qui s’abandonne à lui-même n’a
jamais de roideur dans fes attitudes : s’ il en
affeéle quelquefois, c’ e.ft par effort ; c’eft qu’ il
penfe que ce maintien annonce une meilleure
éducation que celui qu'il prendroit naturellement.
Si cette roideur, longtemps étudiée, lui
eft devenue familière, c’eft qu’en lui l’habitude
a vaincu la nature.
L’objet de l’art eft la nature libre & non
la nature contrariée : l’artifte doit l’étudier 8c
l ’ imiter dans toute la variété de fes formes 8c
dans toute la fouplefle de fes mouyemens. Dès
qu’elle prend de la roideur à fes yeux , il doit
croire que ce n’eft plus e lle ; & dès qu’ il
en remarque dans l’on propre ouvrage, il doit
être perluadé qu’ il n’a fait qu’ une faufle imitation.
( L (
ROMANESQUE, ROMANTIQUE (adj)
Ces deux mots ne l’ont pas fynonymes. Le roma-
nefque eft ce qui appartient, au roman, le romantique
eft ce qui lui convient ou qui a l ’air
de lui appartenir. Le fujet d'un tableau peut
être tiré d’ un roman, & par conféquent être
romanefque, fans être traité d’une manière qui
ait rien de romantique. D’agréables bizarreries
dans les ajuftemeris, des parures fantafques
d’ ingénieufes Angularités dans le fire, dans
la difpofition de la fcène , ont quelque choie
de- romantique. Le fpeélateur lent que ces fan-
taiftes n’appartiennent ni à l’hiftoire , ni à la vie
commune, & il les attribué au roman. Le
Bénédette, Santerre , Grimoux & furtout "Wat-
teau ont des Angularités piquantes qui rendent
leurs tableaux romantiques. Plufieurs peintres,
tels que Rembrant, Salvator Rofe, le Feti & c
ont porté , dans le genre' de l’hiftoire, le üyle
romantique. C’ eft un grand défaut, que les
agrémens qui l’accompagnent ont fait quelquefois
{.ardonnér-, car on pardonne-tout à ce
qui plaît. "
Le mot romantique appartient à la langue
Angloife : plufieurs écrivains françois en ont
fait ufage, & comme il n’a point d’équivalent
dans notre langue , il mérité d’y ê:re adopté. (L)
ROMPRE , .(verbe a£ if ) Rompre les couleurs
ne doit s’entendre que de l’aélion de varier
des couleurs fur. le tabl.eau. Ainft les couleurs
rompues pourroient aufli s’appeller teintes
rompues, parce que c’eft un changement de
teintes fur un même objet.
Pour bien fentir la force de cette manière
de parler qui-n’a lieu que dans la partie qu’on
appelle coloris ^ il faut être inftruit de quelques
principes; élémentaires bien fimples.
Les couleurs naturelles font celles dont le
peintre charge là palette -, elles font dans l ’état
où on les acheté dans les boutiques &
la main de l’artifte ne les a pas encore mélangées.
O r , les cas où ces couleurs doivent
êtré employées en nature font très-rares :
pourquoi ? C’eft qu’il eft très-rare que les Couleurs
locales de la nature à imiter par l’artifte
foient précifément les mêmes que celles dont
fa palette eft chargée , & il eft encore plus rare
que la couleur réelle ou locale de l’objet ne
foi t pas altérée, modifiée ou relevée, foit par
le plan qu’occupes cet ob jet, foit par l’effet
de la lumière & de fes déclinaifons. Ainfi
il eft néceflaire que les couleurs dont le peintre