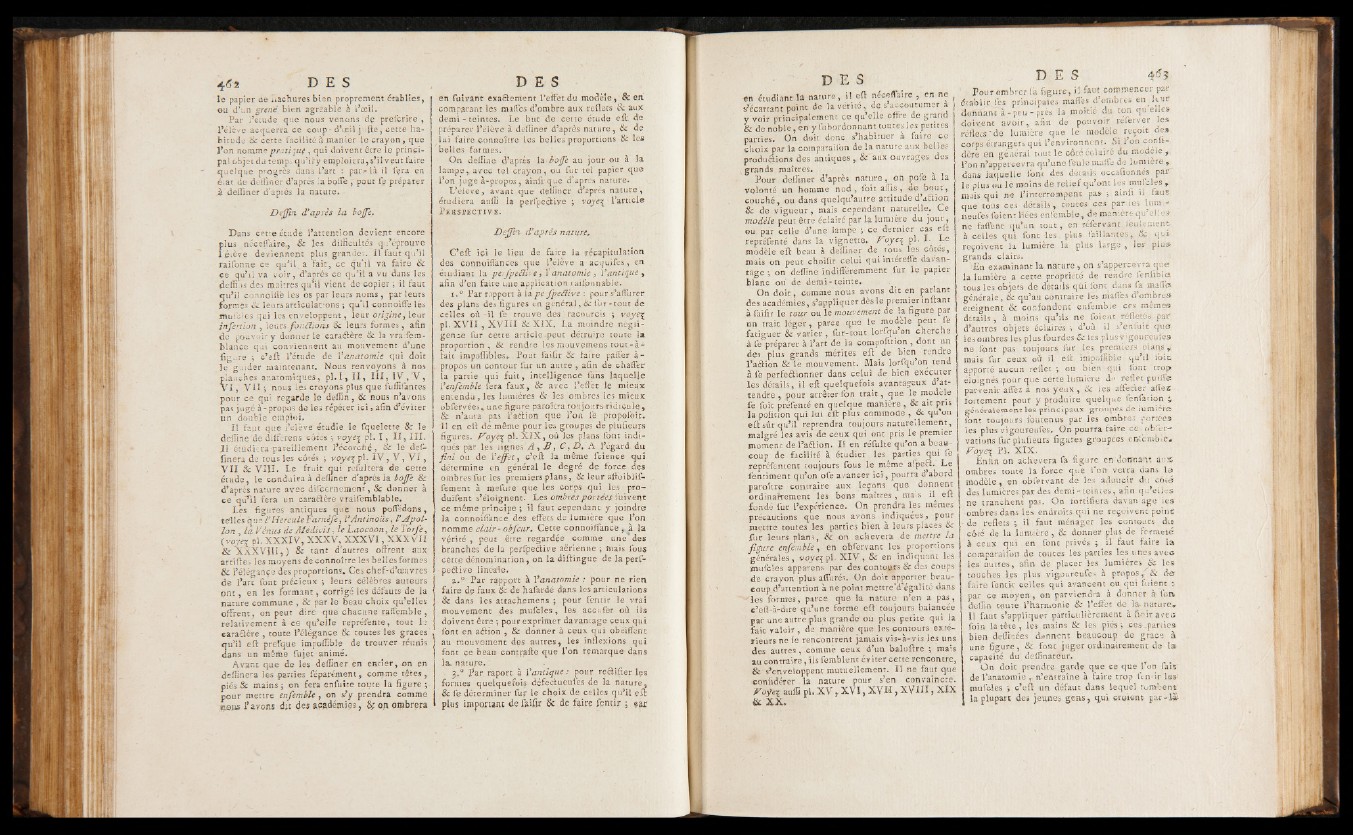
le papier oe Hachures bien proprement établies,
ou d’un grené bien agréable à l’oeil.
Par l’étude que nous venons de preferire ,
l’élève acquerra ce cou p'd ’oeil jufte, cette habitude
& cette facilité à manier le crayon, que
l ’on nomme pratique , qui doivent être le principal
objet du tempe, qu’il y emploiera, s’ il veut taire
quelque progrès dans l’art : par.-là il fera en
état de deffiner d’après ia boffie , pour le préparer
à detîiner d’aptès la nature.
Defiln d’ après la. bofle.
Pans cette étude l’attention devient encore
plus néceffaire., & les difficultés qu’éprouve I éîève deviennent plus grandes. Il faut qu’il
raifonne ce qu’ il, a fait, ce qu’il va faire 8c
ee qu’ il va vo ir , d’après ce qu’ il a vu dans les
deffi.is des maîtres qu’ il vient de copier -, il faut
qu’ il çonnoill'e les os par leurs noms , par leurs
formés 8c leurs articulat:ons ; qu’ il connoiffe lés
mufcles qui les enveloppent, leur origine, leur
infertiun , \e\ats fonctions 8c leurs formes, afin
de pouvoir y donner le caraélère & la vra fem-
blance qui conviennent au mouvement d’une
figure ; c’ eft l ’étude de l’ anatomie qui doit
le guider maintenant. Nous renvoyons à nos
planches anatomiques, pl. I-, I I , I I I , IV »"V,
V I , V I I ; nous les croyons plus que fuffifantes
pour ce qui regarde le deffin, & nous n’ àvons
pas jugé à-propos de les répéter ic i> afin d’éviter
un double emploi.
I l faut que i’ëlève étudie le fquelette & le
deffine de di fférens'cotés'; voye^ pl. ï , I I , III.
II étudiera 'pareillement l’écorchç, & le def-
jfinera de tous les côtés ; voye^ pî, I V , V , V I ,
V I I & V I I I . Le fruit qui refultera de cette
étude, le conduira à deffiner d’après la bofle 8c
d’après nature avec dilçernement, & donner à
ce qu’ il fera un caraclère vraifemblable.
Les figures antiques que nous poffédons,
telles que T Hercule Farnèfe, l’ Antinous, V A p o llon
la Vénus de M édicis, le Laocoon, le Torfe,
(voye% pl, X X X IV , X X X V , X X X V I , X X X V II
& X X X V I I I ,) & tant d’autres offrent aux
artiffes les moyens deconnoître les belles formes
& l’élégance des proportions. Ces chef-d’oeuvres
de l’art font précieux } leurs célèbres auteurs
o n t , en les formant, corrigé les défauts de la
nature commune , & par le beau choix qu’elles
offrent, on peut dire que chacune raffemble ,
relativement à ce qu’e lle repréfente, tout 1;
caraélère , toute l’élégance 8c toutes les grâces
qu’il eft prefque impoffible de trouver réunis
dans un même fujet animé.
Avant que de les deffiner èn entier, on en
deffinera les parties féparement, comme têtes,
pies & mains ; on fera enfuite toute la figure ;
pour mettre enfemble, on s?y prendra comme
çiQiis 1* avons dit des académies, 8c oji ombrera
en fuivant exaélenîent l’effet du modèle, & en
comparant les maffies d’ombre aux reflets & aux
demi - teintes. Le but de cette étude eft, de
préparer l’élève à deffiner d’après nature, &: de
lui faire çonnoître les belles proportions 8c les
belles formes; ;
On déffine d’après lu bofle au jour ou à la
lampe, avec tel crayon, ou fur tel papier que
l ’on juge à-propos, ainfrque d’apres nature.
L’éieve, avant que tlpffiner d’ après nature,
étudiera auffi la perfpeçfive ; voye\ l ’article
Perspe ct iv e.
Deffin d’après nature,
C’ eft içi le lieu de faire la récapitulation
des connoiffances que l’élève a acquifes, en
, étudiant la pçrfpeçtF e > Y anatomie } l ’antique ,
afin d’en faire une application raisonnable.
i . ° Par rapport à la pe fpecüve : pour s’affiurer
des plans des figures en général, &:fur - tout de
celles o ù -if fe trouve des) racourcis ; voye\
p l.X V I I , X V I I I 8c XIX. La moindre négligence
fur cette article .peut détruire toute la
proportion, & rendre les mouvgmens tou t-à-
raic impofïibles. Pour fa ifir8c faire paffer à -
. propos un contour fur un autre , afin de chaffer
la partie qui fu it, intelligence fans laquelle
Ÿenfemble fera faux, & avec l’ effet le mieux
entendu, les lumières & les ombres les mieux
obfervées, une figure paroîcra toujours-ridicule,
& n’aura pas Paèlion que l’on le propofoit.
Il en eft de.même pour les groupes de plufieujrs
figures. Voy'e\ pl. X IX , où les plans font indiqués
par les lignes A , B , C , D , A l’egard du
fini ou de Y effets c’ eft la même feiençe qui
détermine en général le degré de force dçs
ombres fur les premiers plans, 8c leur aftoiblif-
femenc à mefure que les corps qui les pro-
duifent s’éloignent. Les ombres portées fuivent
ce même principe ; il faut cependant y joindre
la connoiffance des effets de lumière que l’on
nomme clair - obfcur. Cette connoiffance , ; à la
vçrité , peut être regardée comme une des
branches de la perfpe&ive aerienne ; mais fous
cètte dénomination, on la diftingue de la perfi-
peélive linéa'le.
z.? Par rapport à Vanatomie : pour ne rien
faire dp faux 8c de hafardé dans les articulations
& dans les attachemens ; pour fentir le vrai
mouvement des mufcles, les accnfer où ils
doivent être -, pour exprimer davantage ceux qui
, font en aélion , 8c donner à ceux qui obéiffent
au mouvement dç-s autres, les inflexions qui
font çe beau contraftè que l’on remarque dans
la» nature..
3.0 par raport à l'antique: pour reclifier les
formes quelquefois défeclueufes de la nature,
& fe déterminer fur le chçix de celles qu’il eft
plus important de faifir & de faire fentir ; §ar
en étudiant la nature, il eft néceffaire , en ne
s’écartant point de la vérité, de s accoutumer a
y voir principalement ce qu’elle offre de grand
& de noble, en y fubordonnant toutes les petites
parties. On doit donc s’habituer à faire ce
choix par la comparaifon de la nature aux belles
produirions des antiques , & aux ouvrages des
v grands maîtres.
Pour delftner d’après nature, on pofe a la
volonté un homme nud, foit afïis , de bout,
couché, ou dans quelqu’autre attitude d aélion
& de vigueur, mais cependant naturelle. Ce
modèle peut être éclairé par la lumière du jour,
ou par celle d’ une lampe y ce dernier cas eft
repréfenté dans la vignette. Voye\ pl. L Le
modèle eft beau à deffiner de tous les cotes,
mais on peut choiiir celui qui intereffe davantage
•, on deffine indifféremment fur le papier
blanc ou de demi-teinte. i
On d o it, comme nous ayons dit en parlant
des académies, s’appliquer dès le premierinftant
à faifir le tour ou le mouvement dé la figure par
un trait lé g e r , parce que le modèle peut I*e
fatiguer & v arie r, fur-tout lorfqu’on cherche
à fe préparer à l’ art de la compofition , dont un
des plus grands mérites eft de bien rendre
l ’aélion & ‘Ie mouvement. Mais lorfqu’ on tend
à fe perfectionner dans celui de bien executer
les détails, il eft quelquefois avantageux d’attendre
, pour arrêter fan trait, que le modèle
fe foit pféfenté en quelque manière, & ait pris
la poficion qui lui eft plus commode , & qu’ on
eft sûr qu’ il reprendra toujours naturellement,
malgré les avis-de ceux qui ont pris le premier
moment de l’aétion. I l en réfulte qu’on a beaucoup
de facilité à étudier les parties qui fe
repréfentent toujours fous le même afpeél. Le
fentiment qu’on ofe avancer ic i, pourra d’abord
paroîtrp contraire aux leçons que donnent
ordinairement les bons maîtres, mass il eft
fondé fur l’expérience. On prendra les memes
précautions que nous avons indiquées, pour
mettre toutes les parties bien à leurs places 8c
fur leurs plans, 8c on achèvera de mettre la
figure enfemble , en obfervant les proportions
générales, voye\ pl. X I V , 8c en indiquant les
mufcles apparens par des contours & des coups
de crayon plus allurés. On doit apporter beaucoup
d’attention à ne point mettre'd’égalité dans
' les formes, parce que la nature n’en a pas,
e’eft-à-dire qu’une forme eft' toujours balancée
par une autre plus grande- ou plus petite qui la
fait valoir, de manière que les contours extérieurs
ne fe rencontrent jamais vis-à-vis les uns
des autres, comme ceux d’un baluftre ; mais
au contraire, ils femblent éviter cette rencontre,
& s’enveloppent mutuellement. I l ne faut que
eonfidérer la nature pour s’en convaincre.
^ofe^ auffi pl. X V , X V I , X V I I , XVH I > XIX
& X X .
Pour ombrer fa figure, il faut commencer par
j établir les principales maffias d’ombres en leur
donnant à - peu - près la moitié du ton quelle»
doivent avoir, afin de pouvoir referver les
réflecs'de lumière que le modèle reçoit des
corps étrangers qui l’environnent. Si..l’on confédéré
en général tout le côté éclairé du modèle f
l’on n’appercevra qu’ une feule maffe de lumière 9
dans iaquelle font des détails occafionnés par
le plus ou lé moins de relief qu’ont les mufcles y
mais qui ne l ’ interrompent pas -, ainfi il faue
que tous ces détails, toutes ces parties lùmi-»
^neufes foient liées enfemble, de manière qu’ elles
ne faffent qu’ un tou t, en rélèrvant feulement
à celles qui font-les plus faillantes, & qui
reçoivent la lumière la plus large , les plu*
grands clairs.
En examinant la nature, on s’appercevra que
la lumière a cette propriété de rendre lenfiblô
tous les objets de détails qûi font dans fa mafie
générale, & qu’au contraire les maffies d’ombres
éteignent 8c confondent enfembie ces mêmes
details-, à moins qu’ ils ne foient réfletés par
d’autres objets éclairés y d’où il s’enfuit que
les ombres les plus lourdes 8c les plus vigoureulès
ne font pas toujours lur les premiers pians v
mais fur ceux où il eft impoffible qu’ il foie
apporté aucun reflet ; ou bien qui font trop
éloignés, pour que cette lumière du reflet punie
parvenir affèz a nos yeux , 8c les affecter allez
fortement pour y produire quelque (enfadon £
généralement les principaux groupes de lumière
font toujours foutenus par les ombres1 portée»
les plus vigpureufes» On pourra faire ce -obier--
varions fur plufieurs figures groupées enfemble..
Voye^ Pl. XIX.
Enfin on achèvera fa figure en donnant aux;
ombres toute la force que l’on verra dans le
modèle , en obfervant de les adoucir du côté
des lumières par des demi- teintes, afin qu’ elles
ne tranchent pas. On fortifiera davan âge les
ombres dans les endroits qui ne reçoivent poine
- de reflets ; il faut ménager les contours dit
côté de la lumière , & donner plus de fermeté
à ceux qui en font privés ; il faut faire la
comparaifon de toutes les parties les unes avec
les autres, afin de placer les lumières & les
touches les plus vig-oureufes à p r o p o s & défaire
fentir celles qui avancent ou qui fuient :
par ce moyen, on parviendra à donner à Ion
deffin toute l’harmonie & l ’effet de la nature»
Il faut s’appliquer particulièrement à ftr ira v e o
foin La tê te , les mains & les pies *, c e s s âm e s
bien deffinées donnent beaucoup de grâce à
une figure, & font j ug.er ordinairement de la
capacité du deffinateur.
On doit prendre garde que ce que l’on fais
de l’anatomie , n’entraîne à faire trop femir le»
mufcles -, c’ eft un défaut dans Lequel tombent
la plupart des jeunes gens, qui croient gar-l&