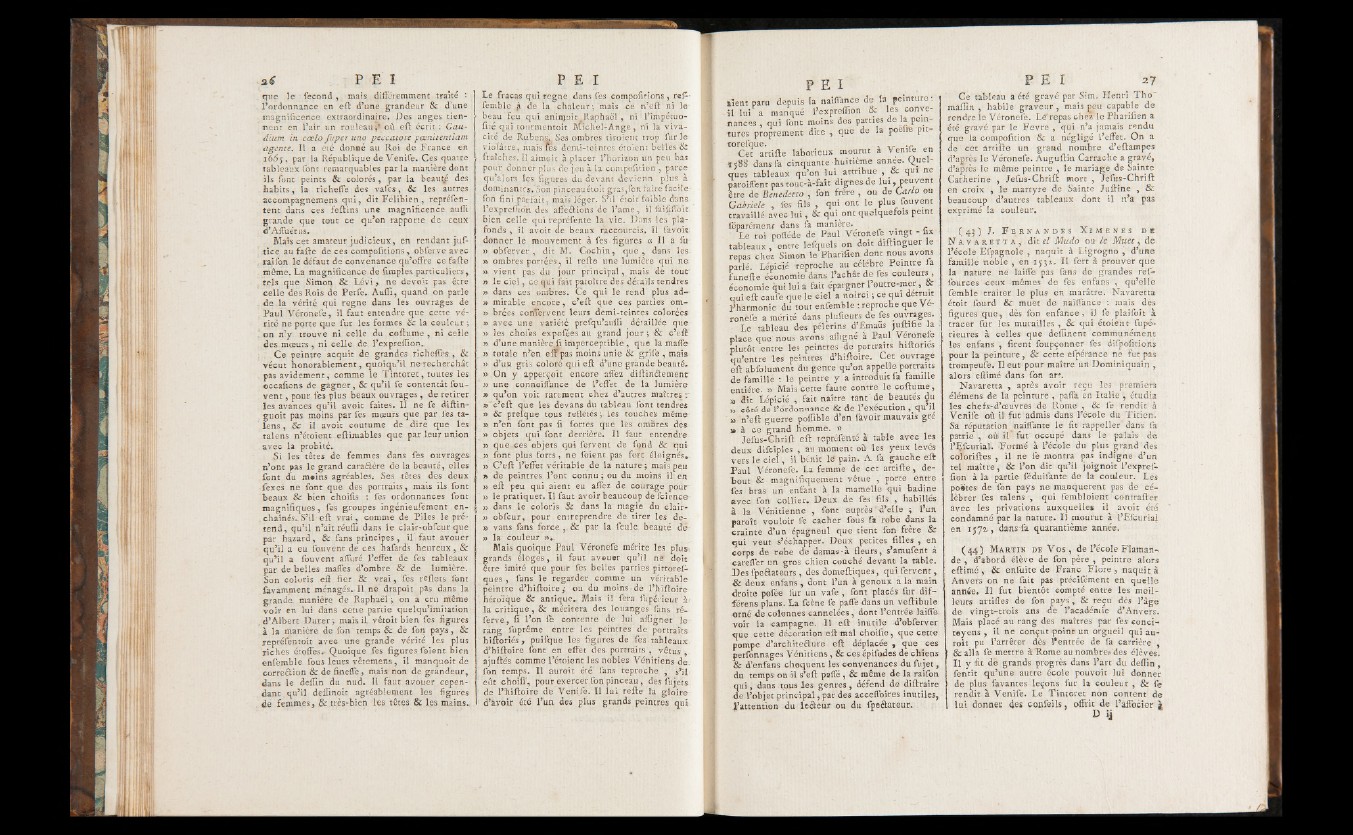
que le fécond , mais différemment traité :
l ’ordonnance en eft d’une grandeur 8c d’une
magnificence extraordinaire. Des anges tien- 1
Tient en l’air un rouleau 3* où eft écrit r Gau-
dium in ccelo fuper uno psccatere poenitentiam
agence. Il a èié donné au Roi de France eh
1665 , par la République de Venife. Ce,s quatre
tableaux font remarquables par la manière dont
ils font peints & colorés, par la beauté des
habits , la richefle des vafes, & les autres
accompagnemens q u i, dit Félibien , repréfen-
tent dans ces feftins une magnificence aufli
grande que tout ce qu’on rapporte de ceux
d* Afluér ns. . '
Mais cet amateur judicieux, en rendant juf-
ticë au fafte de ces compofitions , obferve avec
raifon le défaut de convenance qu’offre ce fafte
même. La magnificence de fimples particuliers,,
tels que Simon & Lévi > ne de voit pas être
celle des Rois de Perfe. Audi, quand on parle
de-la vérité qui régné dans les ouvrages de
Paul Véronefe, il faut entendre que cette vérité
ne porte que fur les formes 8c la couleur •,
on n’y trouve ni celle du coftume , ni celle
des.moeurs, ni celle de l ’exprefiion..
Ce peinçre acquit de grandes richeffes., &
vécut honorablement, quoiqu’il ne-recherchât
pas avidement, comme le Tintoret, toutes les
©ccafions de gagner., & qu’ il fe contentât fou-
vent , pour fes plus beaux ouvrages , de retirer
les avances qu’ il avoit faites. 11 ne fe diftin-
guoît pas moins par fes moeurs que par fes ta-
le n s , & il avoir coutume de dire que les
talens n’étoient eftimables que par leur union
avec la probités
Si les têtes de femmes dans fes ouvrages; „
n’ ont pas le grand caractère de la beauté, elles
font du m»ins agréables.- Ses -têtes des deux
fexes ne font que des portraits, mais ils font
beaux & bien choifis : fes ordonnances font "
magnifiques, fes groupes ingénieufément enchaînes.
S’ il eft vrai, comme de Piles le prétend,
qu’ il n’ait réuffi dans le clair-obfçur que
par hazard, 8c fans principes, i f faut avouer
qu’ il a eu fouvent de ces hafard’s heureux, &
qu’il a fouvent affuré l’effet de fes tableaux
par de belles maffes d’ombre & de lumière.
Son coloris eft fier & v ra i, fes reflets font
favamment ménagés,.; Il, ne drapoit pàs dans la
grande manière de Raphaël* on a cru même
voir en lui dans cette partie quelqu’imîtation
d’Albert Durer-, mais il vêtoit bien fes figures
à la manière de fon temps & dë fort pays, &
repréfentoit avec une grande vérité les plus
riches étoffes.- Quoique fes figures foient bien
enfemble fous leurs vêtemens, il manquoit de
corre&ion & de finefle, mais non de grandeur,
dans le deffln du nud. Il faut avouer cependant
qu’ il deffmoit agréablement les figurés ‘
de femmes, & très-bien les têtes & les mains. ’
Le fracas qui régné dans fes compofitions , re£-
fenible à de la chaleur -, maïs ce n’eft ni le
beau feu qui anirrjoit Raphaël , ni l ’impétuo-
fité qui totirmentok Michel-Ange , ni la vivacité
de Ruhen^ Ses ombres tiroieiit trop fur ie
violâtre., mais lés demi-teintes étoient belles 8t
fraîches. Il airaoit à placer l’horizon un peu bas
pour donner plus de jeu à la compofition , parce
qu’a lors les figures .du devant devienn plus à
dominantes/Son pinceau étoit gras,fon faire facile1
foh fini parfait, mais léger. S’ i l étoit foible dans,
l’exprefiion des affe&ions de l’ame, il faififloit
bien celle qui repréfente la vie. Dans les plafonds
, il avoit de beaux raccourcis. Il fa voit:
donner le mouvement à fes figures « I l a fu
» obferver , dit M. Cochin, que , dans les
» ombres portées, il refte une lumière qui ne.
» vient pas du jour principal, mais dë tour
» le c ie l , ce qui fait patoître des détails tendres
» dans ces ombres. Ce qui le rend plus ad—
» mirable encore, c’èft que ces parties om-
» brées conTervent leurs demi-teintes colorées
» avec une variété prefqu’aufïi détaillée que
» les chofes expofées au grand jour-, & c’eft
» d’une manièreJi imperceptible , que la maffe
» totale n’en, efrpas moins unie 8c grife , mais
» d’ un gris coloré qui eft d’une grande beauté.
».On y apperçoit encore affez diftinétemenr
» une connoiffance de l’ effet de la lumière
» qu’on voit rarement chez d’àutres maîtres r
»"c’eft que les devans du tableau font tendres
» 8c prelque tous reflétés -,. les touches même
» n’en font pas fi fortes que les. ombres des
» objets qui font derrière. Il faut entendre
» que* ces objets qui fervent de fqnd 8c qui
» font plus forts, ne foient pas fort éloignés»
» C’ eft l’effet véritable de la nature; maïs peu
» de peintres l’ont connu ; ou du moins i l en
» eft peu qui aient eu affez de courage pour
» le pratiquer. Il faut avoir beaucoup de fcience
» dans le coloris & dans la magie du clair-
» obfcur, pour entreprendre de tirer les de-
» vans fans f o r c e .& par la feule, beauté dé
» la couleur
Mais quoique Paul Véronefe mérite les plus
grands éloges , il faut avouer qu’ il né doit
être imité que pour fes belles parties pittoresques
, fans le regarder comme un véritable
peintre d’h ï f t o i r e o u du moins-de l’hiRoire
héroïque & antique- Mais il fera • fu péri eut à-
la critique , & méritera des louanges fans ré-
ferve, fi l ’on fe contente de lui afligner le
rang fiiprêmë entre les peintres de portraits
hiftoriés, puifque les figures de fes tableaux
d’ hiftoire font en effet des. portraits , vêtus ,
ajuftes comme l’étoient les nobles Vénitiens de
fon temps. Il auroit été fans reproche ,. s’ il
eût choift, pour exercer fon pinceau, des füjëts
de l’hiftoire de Venife. Il lui refte la gloire
d’àyoir été l ’un des plus grands peintres qui
aient paru depuis la naifl’ance de la peinture :
i l lui a manqué l’expreffion & les convenances,
qui font moins des parties de la pem-
tures proprement dite , que de la poefre pit-
torefque. . ^ _ ,r
Cet artifte laborieux mourut a Vernie en
t <88 dans fa cinquante-huitième annee. Quelques
tableaux qu’on lui attribue , & qui ne
paroiffent pas tout-à-fait dignesde lu i , peuvent
être de Benedetto , fon frère , ou de Carlo ou
Gabriele , fes fils , qui ont le plus fouvent
travaillé avec lu i , & qui ont quelquefois peint
féparémenr dans fa manière. . #
Le roi pofléde de Paul .Véronefe vingt Mix
tableaux entre lefquels on doit diftinguer le
repas chez Simon le Pharifien dont nous avons
parlé: Lépïcîé reproche au célébré Peintre la
funefte économie dans fâchât de fes couleurs,
économie qui lui a fait épargner Poutre-mer, tx
qui eft caufe que le ciel a noirci ; ce qui détruit
P harmonie du tour enfemble ; reproche que Ve-
ronèfe a mérité dans plufieurs de fes ouvrages.
- Le tableau des pèlerins d’Emaus juftihe la
place que nous avons afligné à Paul Véronefe
plutôt -entre les peintres de portraits hiftories •
qu’entre les peintres d’hiftoire. Cet ouvrage
eft abfolument du genre qu’ on appelle portraits
de famille : le peintre y a introduit fa famille
entière. » Mais cette faute contre le coftume,
» dit Lépicié , fait naître tant' de beautés $u
» côté de l’ordonnance & de l’ exécution , qu’ il
» n’eft guerre poflïble d’en lavoir mauvais gré
» à ce grand homme. »
Jefus-Chrift eft repréfenté à table avec les
deux difclples , au moment où les yeux levés
vers le c ie l , il bénit lë pain. A fa gauche efb
.Paul Véronefe. La femme de cet artifte, debout
& magnifiquement vêtue , porte entre
fes bras un enfant à la mamelle qui badine
avec fon collier. Deux de les fils , habilles
à la Vénitienne , font auprès'-d’elle ; l’ un
paroît vouloir fe cacher fous fa robè dans la
crainte d’un épagneul que tient fon frère 8c
qui veut, s’ échapper. Deux petites filles , en
corps de robe de damas - a fleurs, s’amufent a
carefler un gros chien couché devant la table.
De s fpeélateurs , des domeftiques, qui fervent,
& deux enfans , dont l’ un a genoux a la main
droite pofée fur un vafe , font placés fur d if-
férens plans. La fcène fe pâlie dans un veftibule
orné de colonnes cannelées, dont l ’entrée laiffe
voir la campagne. I l eft inùt^ile d’obferver
que cette décoration eft mal choifie, que cette
pompe d’architeélure eft déplacée , que ces
perfonnages Vénitiens, & ces épifodes de chiens
& d’enfans choquent les convenances du fuje t,
du temps ou il s’ eft paffé , & même de la raifon
q u i, dans tous les genres, défend de diftraire
de l’objet principal, pair des acceffoires inutiles,
^’attention du le&eur ou du fpe&ateur.
Ce tableau a été gravé par Sim. Henri Tho~
mâflin , habile graveur, mais peu capable de
rendre le Véronefe. Lé*repas chez le Pharifien a
été gravé par le Fevre , qui n’a jamais rendu
que la compofition 8c a négligé l’ effet. On a
de cet artifte un grand nombre d’eftampes
d’après le Véronefe. Auguftin Carrache a gravé,
d’ après le même peintre , le mariage de Sainte
Catherine , Jefus-Chrift mort , Jefus-Chrift
en croix , le martyre de Sainte Juftine , &
beaucoup d’autres tableaux dont il n’a pas
exprimé la couleur.
(43) J. F e r n a n d es X imene s de
N a v a r e t t a ,. dit el Mudo ou le Muet, de
l ’école Efpagnole , naquit à Ligrogno , d’une
famille noble , -en 1532. II fort à prouver que
la nature ne laiffe pas fans de grandes ref-
fouroes ceux mêmes de fes enfans , qu’ elle
femble traiter le plus en marâtre. Navaretta
étoit fourd & muet de naiffance : mais des
figures que, dès fon enfance, i f fe plaifoit à
tracer fur les murailles , & qui étoient fupé-
rieures à celles que deflinent communément
les enfans , firent foupconner fes difpofitions
pour la peinture, & cette efpérance ne fut pas
trompeufe. Il eut pour maître un Dominiquain ,
alors eftimé dans fon art.
Navaretta , après avoir reçu les premiers
élémens de la peinture , paffa en Italie , étudia
les ehefs-d’oeuvres de Rome , & le rendit à
Venife où il fut admis dans l’école du Titien.
Sa réputation naiflante le fit rappeller dans la
patrie , où. il* fut occupé dans le palais de
l’EfcuriaL Formé à l’école du plus grand des
coloriftes , il ne fe montra pas indigne d’un
tel maître, & l’on dit qu’ il joignoit l’expref*
lion à la partie féduifante de la couleur. Les
podees de fon pays ne manquèrent pas de célébrer
fes talens , qui fembloient contrafter
avec les privations auxquelles il avoit été
condamné pat la nature. I l mourut à l ’Efcurial
! en 1572., dans-fa quarantième année.
(44) Martin de V o s , de l’école Flaman--
de , d’ abord élève de fon père , peintre alors
eftimé , & enfoite de Franc Flore , naquit à
Anvers on ne fait pas précifément en quelle
année. I l fut bientôt compté entre les meilleurs
artiffes de fon pays, & reçu dès l’âge
de vingt-trois ans de l’ académie d’Anvers.
Mais placé au rang des maîtres par fes conci-
teyens , il ne conçut point un orgueil qui auroit
pu l’arrêter dès rentrée de fa carrière ,
& a lla fe mettre à Rome au nombren des élèves.
I l y -fit dé grands progrès dans l’ arc du deflin,
fentit qu’une autre école pouvoit lui donner
de plus favantes leçons fur la couleur , & fe
rendit â Venife. Le Tintoret non content de
lui donner des confoils, offrit de l’aflbeier g
D ïj