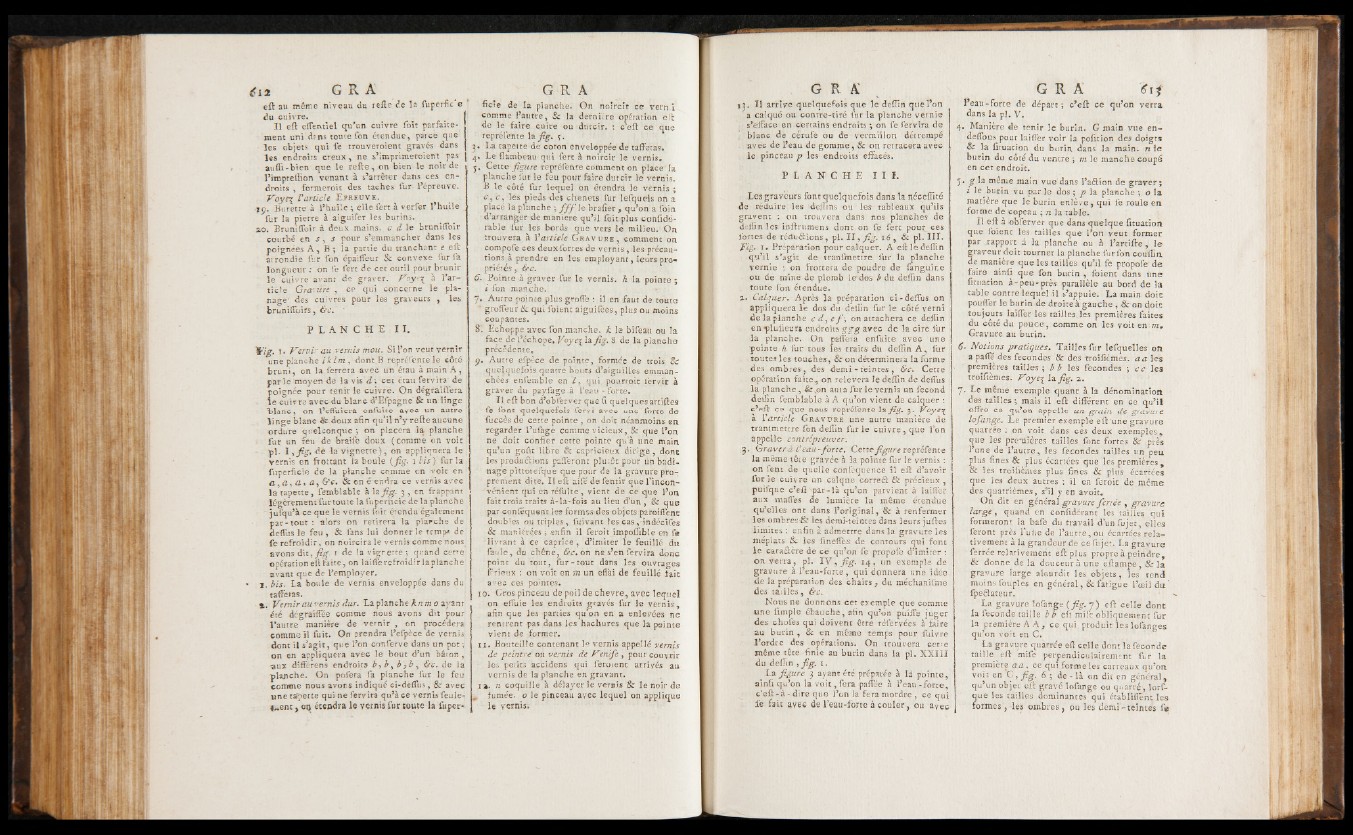
(i2 G R A
e ft au m êm e n iv e a u du refie d e la fuperfic e
du cu iv re.
I l eft e fle n tie î qu'un cu ivre Toit parfaite*
m en t u n i cbns tou te fon é te n d u e , parce q u e
le s o b jets q u i fe trou v eroien t gravés dans
le s en droits creu x , n e «’imprimeraient^ pas
a u fli'b ie n q u e le r e lie ,, o n b ien le n o ir de
rim p reflion v en a n t à s’arrêter dans ces e n droits
, form eroit des tach es fur l’ép reu ve.
Voyt{ P article E preuve.
■ 19. B u rette à l’h u ile ; e lle fert à verfer l’h u ile
fur la pierre à a ig u ifer le s burins.
a o . B runiffoir à d eu x m ain s, c d le bruniffoir
cou rb é en s , s pour s’em m an ch er dans les
p o ig n ées A , B ; la partie du tran ch an t e eft
arron die fur fon épailfeur 8c c o n v e x e fu.r fa
lo n g u eu r : 00 fe fert de c e t o u til pour brunir
le cu iv re avan t d e g raver. Voye% à l ’artic
le Gravure , c e q u i con cern e le plan
a g e ’ des cu ivres pour les graveu rs , les
b ru n iffoirs, &c.'
P L A N C H E I I .
tyig. 1. Vernir au vernis mou. S i l’on v eu t vern ir
u ne p lanch e i k lm , d o n t B repréfente le cô té
b r u n i, on la.ferrera a v e c ùn étau à m ain A ,
par le m o y en d e la v is d\ c e t étau fervira de
p o ig n ée pour ten ir le cu iv ré. O n dégraiiTera ;
- l e c u iv re avec-du b la n c d’E fpagne & un lin g e ■
b la n c , o n l’effuiera en fu ite a v e c un a u tre'
lin g e b lan c & dou x afin q u’il n’y r e lie a u cu n e ;
ord u re q u elco n q u e ; o n placera la p lan ch e ’
fu r un feu d e braife doux (c om m e o n v o it
p l. I rfig> d e -la 'v ig n e tte ), on ap p liquera le j
v ern is en frotta n t la b o u le (j% . 1 bis ) fur la
fu p erficie de. la p la n ch e com m e e n v o it en !
<j } æ , a y a , & on é e n d r a c e v ern is a v ec
la ta p e tte , fem b la b le à la fig. 3 , en frappant
lég èrem en t fur tou te la fup erficie de la p lan ch e
ju fq u ’à c e q u e le v er n is foit étend u éga lem en t
p a r -to u t : alors o n retirera la pi a rc h e de
d éfia s le feu , & fans lu i d onn er le tem ps de
fe r e fr o id ir , on noircira le v ern is com m e nous
a vo n s d it, fig. 1 de la v ig n e tte ; quand cette
o p éra tio n e llfa ite , on laiffe refroidir la p la n eh e
a van t q u e de l’em p lo y er.
• j . bis. La b o u le de v ern is en v elop p ée dans du
taffetas.
%. Vernir au vernis dur. La p lan che knmo ayant
été dégraiflee com m e nous avon s d it pour
l ’autre m anière d e vern ir , on procédera*
com m e il fu it. O n prendra l’efpèce d e v ern is
d on t il s’a g it, q u e l’on con ferv e dans un pot ;
o n en appliquera a v ec le b o u t d’un b â to n ,
■ aux différens en d ro its b-, 3 , b ? b , &c. d e la
p la n c h e . O n pofera fa p la n ch e fur le feu
com m e nous avo n s in d iq u é c i-d e flu s, & avec
u n e tap ette q ui n e fervira qu’à c e v ern is feule-;
t » e n t , <nj étendra le vernis fur sou te la ûiper*-
G R A
fic ie d e la p lan ch e. O n n o ir c it c e vern ï
com m e l’a u tre, & la d ern ière opération e ft
d e le faire cu ire ou durcir. : c’eft ce q u e
reprélente la fig. 5»
3* La tap ette d e coton en v elop p ée de taffetas.
4» L e flam beau q u i fert à n o ircir le v ern is.
5 . C ette figure reprélente com m en t on p lace la
p lan ch e fur le feu pour faire durcir le v ern is.
B le cô té fur leq u e l on étendra le v ern is ;
6*, c , le s pieds d es ch en ets fur lefq u els on a
p lacé la p lan ch e ; f f f le brafîer , qu ’on a foin
d’arranger d e m aniéré q u ’il £oit plus con fid é-
rab le lur le s bords q u e vers le m ilieu . O n
trou v era à Varticle Gr a v u r e , com m en t on
com pote ces d eu x fortes d e v ern is , les précau-
tio n s.à prendre en les em p lo y a n t, leu rs propriétés
, &c.
6 . P o in te -à g ra ver fur le v ern is, h la p o in te ;
i fon m a n ch e.
7 . Aurre p oin te plus groffe : il en fau t d e route
* g reffeu f & q u i fo ien t a ig u ifé e s, plus ou m o in s
cou pantes.
8'. E ch op p e a v ec fon m a n ch e, k le bifeau ou la
face de l’éch op e, Voye^ fig. 8 d e la p la n ch e
p récéd en te.
9 . A u tre efpèc.e de p o in te, form ée d e trois, &
q u elq u efo is quatre bouts .d’a ig u ille s em m anch
ées en fem b le en l , q ui pourroit lery ir à
g ra ver du pay.fage à l’e a u -fo r te .
Il, eft bon d’obferver q u e fi q u elq u es artiftes
fe fon t q u elq u efo is fery i a v ec une force d e
fu ccès d e c e tte p o in te , on doit n éanm oins e n
regarder l’u fage com m e v ic ie u x , & q u e l ’o n
n e d o it con fier ce tte pointe qu ’à u n e m ain
qu’un g o û t lib re & cap ricieu x d ir ig e , d on t
le s productions pafleront p lu tôt pour ün badin
a g e p itto reiq u e q u e pour de la gravure proprem
ent d ite. I l e ft aifé d e fe n tir q u e l’in con v
én ien t q ui en r é fu lte , v ie n t d e ce q u e l’on
fait trois traits à -la -fo is au lieu d’u n , & q u e
par c o n féq u en tîes form es des o b jets paroiftenc
d ou b les ou tr ip le s, fu iva n t le s c a s , -in d éciles
& m aniérées-, enfin il teroit im poffible en fe
liv ra n t à ce ca p rice, d’im iter le fe u ille du
fa u le , du c h ê n e , &c» oh n e s’en fervira d on c
poin t du to u t, fu r -to u t dans les ou vrages
férieux : o n v o it en m un effai d e fe u ille tait
a v ec ces p oin tes.
10. Gros pinceau d e poil d e c h e v r e , a vec leq u e l
on effuie le s en d roits gravés fur le v ern is ,
afin q u e le s parties q u ’on en a e n lev ées n e
ren tren t pas dans les h ach u res q u e la p oin te
r ie n t d e form er.
11. B o u te ille con ten an t te v ern is appelle vernis
de peintre ou vernis de Venife, pour cou vrir
le s petits a ccid en s q u i fera ien t arrivés au
v ern is de la p lan ch e en gravan t.
1 %. n c o q u ille à d élayer le vernis & le noir d e
> fum ée, o le p in ceau a vec leq u e l on ap p liq u e
le v ern is.
G R A
13. I l arrive q u e lq u e fo is q u e le defiin q u e l’on
a calq u é ou co n tre-tiré fur la p lan ch e v ern ie
s’efface e n certain s endroits ; on te fervira d e
b lan c d e céru fe ou de v erm illo n détrem pé
a v e c d e l’eau d e g o m m e , & on retracera a vec
le p in ceau p lés en d ro its effacés.
P L A N C H E I I I .
L es graveu rs fon t q u elq u efo is dans la néceffité
d e réduire le s déliras ou les tab lea u x q u ’ils
g ra ven t : on trou vera dans n os p lan ch es de
defiin le s in ftrum en s d o n t on fe fert pour ces
fortes d e r é d u â io n s, p l. I I , fig. 1 6 , & pl. I I I .
Fig- 1 • Préparation pour c a lq u er. A eft le defiin
qu ’i l s’a g it d e tran (m ettre fur la p lan ch e
y er n ie : on frottera d e poudre d e fan gu in e
ou d e m in e d e plom b le-d os b du defiin dans
to u te fon éten d u e.
%, Calquer. A près la préparation c i-d e ffu s on
a p p liq u era l e dos d u -d efiin fur le cô té v ern i
d e la p lan ch e c d, e f \ on attach era c e defiin
e n p lu fie a r s en droits ggg a v ec d e la cire fur
la p la n ch e. O n paflera en fu ite a v e c u n e
p o in te h fur tou s le s traits du d efiin A , fur
to u tes le s to u ch e s, & on déterm inera la form e
d es o m b r e s, d es d em i - tein tes , &c. C ette
opération fa ite ., on relevera le defiin d e deffus
la p la n c h e , & von aura fur le v ern is un fécon d
d efiin fem b lab le à A q u ’on v ie n t d e calq u er :
c ’e ft c e q u e nous repréfente la fig, 3. Voyez
à l’article Gravure une autre m an ière de
tran lm ettre fon defiin fur le c u iv r e , q u e l’on
a p p elle contrépreuver.
3 . Graver à Peau-forte. Cette figure repréfente
la m êm e tête g ra vée à la p o in te fur lé v ern is :
on fe n t d e q u e lle co n leq u en ce il e ft d’avoir
fur }e cu iv r e un ca lq u e correél 8c p r écieu x ,
p u ifq u e c ’eft p a r -là q u ’on parvient, à laifler
au x m affes d e lum ière la m êm e éten d u e
qu’e lle s o n t dans l’o r ig in a l, & à renferm er
le s om bres-& les demi-teintes dans leu rs ju ftes
lim ites : enfin à adm ettre dans la gra vu re le s
m éplats 8c le s fin effes de con tours q u i fo n t
le caraû ère d e c e qu’on te propofe d’im iter :
o n v e r r a , p l. I V , fig . 1 4 , u n ex em p le d e
gra vu re à l’e a u -fo r te , q u i d on n era u n e id ée
d e la préparation d es ch airs , d u méehanifme
d es ta ille s , &c.
N o u s n e d o n n on s c e t exem p le q u e com m e
u n e {im p ie é b a u c h e , afin qu’on p ulfie ju g er
d es c h o ies q u i d o iv e n t être réfervées à faire
au b u rin , & en m êm e tem ps pour fu ivre
l ’ordre des opérations. O n trouvera ce tte
m êm e têtë fin ie au b u rin dans la p l. X X II I
du defiin , fig. 1.
La figure 3 ayant été préparée à là p o in te ,
a in fi q u ’on la v o it, fera paffée à l’e a u -fo r te ,
c’e f t - a - d ir e q u e l’o n la fera m ordre , ce q ui
le fait a vec d e l’eau -fo rte à c o u le r , ou a y e c
G R A
1 ea u -fo r te de d ép a rt; c ’e ft c e q u ’on verra
dans la pl. V .
4 . M anière d e ten ir le b u rin . G m ain v u e e n -
defiou s pour laifler v o ir la p o litio n des d o ig ts
& la firuatîon du b u rin dans la m ain ; n ie
b u rin du cô té du v en tre ; m le m a n ch e cou p é
en c e t en d ro it.
5. g la m êm e m ain v u e dans l’aélion d e g ra v e r ;
i le burin v u par le dos ; p la p lan ch e -, o la
m atière q u e le burin en lèv e , q u i le rou le en.
form e d e cop eau ; n la ta b le.
Il e ft à .obierver- q u e dans q u e lq u e fitu a tio n
q u e foien t les ta illes q u e l’o n y e u t form er
par .rapport à la p lan ch e ou à l’a r tifte , le-
graveu r d o it tou rn er la p lan ch e fur fon cou ffin
d e m anière q u e les ta ille s q u ’il fe propofe d e
faire ainfi q u e fon burin , fo ien t dans u n e
fitu ation à -p eu -p r è s p arallèle au bord d e la
ta b le con tre leq u e l il s’appuie. L a m ain d oic
pouffer le burin d e d ro ite à g a u ch e , & on d oic
tou jou rs laiffer le s ta ille s.le s prem ières fa ites
du cô té du p o u c e , com m e on le s v o it e n ;m ,
G ravure au burin.
6 - Notions pratiques. T a ille s fur le fq u e lles o n
a paffé des fécon d és & des tro ifiim es. a a le s
prem ières t a ille s ; b b le s féco n d és ; c c le s
troilîèm es. Voye\ \zfig. 2.
7 . L e m êm e ex em p le q u a n t à la d én om in ation
d es taille# ; mais il e ft différent en ce qu’il
offre ce qu ’on ap p elle un grain de gravure
lofange» L e prem ier exem p le e ft u n e gravu re
quarrée : on v o it dans ces d eu x e x em p le s ,
q u e le s prem ières ta ille s fon t fortes & près
l’une d e l ’a u tre , le s fécon d és ta ille s un p eu
plus fin es & plus écartées q u e les prem ières ,
& le s troifièm es plus fin es & plus écartées
q u e le s d eu x autres : il en fera it d e m êm e
d es q u a trièm es, s’il y ep a vo it.
G n d it en général gravure ferrée , gravure
large , quand en con fidëran t les ta illes q u i
form eront la bâte du trav ail d’un fu je t, e lle s
feron t près l’u n e d e l’a u tre , ou écartées rela tiv
em en t à la grandeur d e c e fu jet. La gra vu re
ferrée rela tiv em en t e ft plus propre à p e in d r e ,
& don n e d e la d ou ceu r à u n e e ftam p e , & la
gra vu re large a lou rd it le s o b jets , le s rend
m o in s fou p îes en g én ér a l, & fa tig u e l’oe il du*
fp eélateu r.
La gravu re lo fa n g e {fig. 7 ) e ft c e lle d o n t
la féco n d é ta ille b b eft m ife o b liq u em en t fur
la première A A , ce q u i p roduit le s lofanges
qu ’on v o it en C .
La gravu re quarrée eft c e lle don t la féco n d é
taille^ eft m ite perp en d icu lairem en t fur la
prem ière a a* c e q ui form e les carreaux qu’on,
v o it en G , fig. 6 ; d e - là on dit en g é n ér a l,
q u ’un o b jet e ft g ra vé lo fa n g e ou q u a rré, lo r s q
u e les ta ille s d om in âm es q u i étab liflen t le s
fo rm e s , le s o m b r e s, ou le s d e m i-te in te s fis