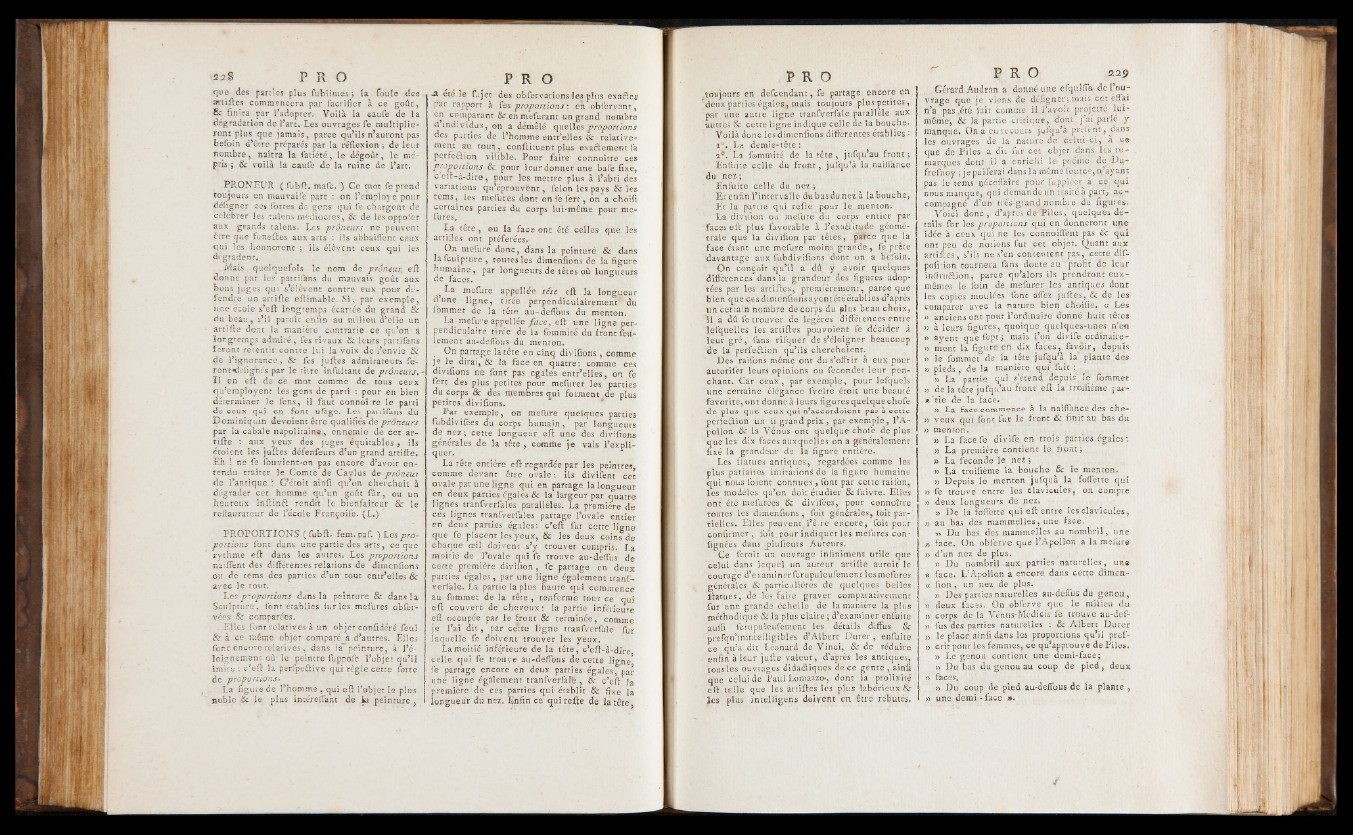
que des parties plus fublinies*, la foule des
artiftes commencera par facrifier à ce g oû t,
& finira par l’ adopter. Voilà la caufe de la
dégradation de l’art. Les ouvrages fe multiplieront
plus que jamais, parce qu’ ils n’auront pas
befoin d’être préparés par la réflexion -, de leur
nombre, naîtra la fatiété, le dégoût, le mépris
; & voilà la caufe de la ruine de l ’art.
PRONEUR ( fubft. mafc. ) Ce mot fe prend
toujours en rrvauvaife part : on l’employe pour
défigner ces fortes de gens qui fe chargent de
célébrer les talens médiocres , & de les oppofer
aux grands talens. Les prôneurs ne peuvent
être que funeftes aux arts : ils abbaiffenr ceux
qui. les honnorent ; ils élèvent ceux qui les
dégradent.
Mais quelquefois le nom de prôneur. eft
donné par les partifans du mauvais goût aux
bons juges qui s’élèvent contre eux pour défendre
un artifle eftimable. S i , par exemple,
une école s’eft longtemps écartée du grand &
du beau , s’ il paroît enfin au milieu d’elle un
artifle dont la manière contrarie ce qu’on a
longtemps admiré, fes rivaux & leurs partifans
feront retentir contre lui la voix de l’envie &
de l’ ignorance., & fes juftes admirateurs fe-
ront^dêfigncs par le titre infultant de prôneurs. -
I l en eft de ce mot comme de tous ceux
qu’employent les gens de parti : pour en bien
déterminer le fens, il faut connoî:re le parti
de ceux qui en font ufage. Les partifans du
Dominiquin dévoient être qualifiés de prôneurs
par la cabale napolitaine, ennemie de cet artifle
: aux yeux des juges équitables, ils
étoient les juftes défenfeurs d’ un grand artifle.
Eh ! ne fe fou vient-on pas encore d’avoir entendu
traiter, le Comte de Caylus de prôneut
de l’antique ? C’étoit ainfi qu’on cherchoit à
dégrader cet homme qu’ un goût fur, ou un
heureux inflïnêt rendit le bienfaiteur & le
reftaurateur de l’école Françoife. (L.)
PROPORTIONS ( fubfl. fem. paf. ) Les proportions
font dans une partie des arts, ce que
rythme eft dans les autres. Les proportions
naiffent des différentes relations de dimenfions
ou de tems des parties d’ un tout entr’ elles &
avec le tout.
L es proportions dans la peinture & dans la
Sculpture, font établies (urles mefures obler-
vées & comparées.
Elles font relatives à un objet confidéré feui
& à ce même objet comparé à d’autres. Elles
font encore relatives', dans là"peinture, à l ’éloignement
où le peintre fuppofe l’objet qu’ il
imite ; c'eft la perlpe&ive qui règle cette forte
de proportions. ’
La figure de l’ homme , qui eft l’objet le plus
noble & le plus intéreffant de ia peinture, i
si été le fa jet des obfervatîons lés plus ex aêtes
par rapport à fes proportions : en obfervant,
en comparant & en mefurant un grand nombre
d individus, on a démêlé quelles proportions
des parties de l ’homme entr’elles & relativement
au tout;, conftituent plus ex acte ment fa
perfection vifible. Pour faire connoître ces
proportions & pour leur donner une bafe fixe,
c e ll-à -d ire , pour les mettre plus à l’abri des
variations qu éprouvent, félon les pays 8c les
tems, les mefures dont on fe fe r t , on a choifi
certaines parties du corps lui-même pour mefures.
La tête , ou la face ont été celles q.ue les
artiiles ont préférées.
On mefure donc, dans la peinturé & dans
lafeuipture , toutes les dimenfions de la figure
humaine, par longueurs de têtes où longueurs
de faces.
9 mefure appelles tete eft la longueur
dune ligne, tirée perpendiculairement^ du
fommet de la tête au-deffous du menton.
La mefure appellée fa ce , eft une ligne perpendiculaire
tirée de la fommité du front feulement
au-deffous du menton.
On partage la tête en cinq divifions , comme
je le dirai* & la face en quatre: comme ces
divifions ne font pas égalés entr’ elles, on fe
fert des plus petites pour mefurer les parties
du corps & des membres qui forment de plus
petites^ divifions.
Par exemple, on mefure quelques parties
fubdivifées du corps humain , par longueurs
de nez ; cette longueur eft une des divifions
générales de la tête , comihe je vais l ’expliquer.
La tête entière eft regardée par les peintres,
comme devant être ovale : ils diyifent cec
ovale par une ligne qui en partage la longueur
en deux parties égales & la largeur par quatre
lignes tranfverfales parallèles. La première de
ces lignes tranfverfales partagé l’ovale entier
en deux parties égales: c’eft fur cette ligne
que fe ,placent les yeux, & les deux coins de
chaque oeil doivent, s’y trouver compris. La
moitié de l’ovale qui fe trouve au-deflus de
cette première divifion , fe partage en deux
parties égales, par une ligne également tranl-
verfale. La partie la plus haute qui commence
au fommet de la tê te , renferme tout ce qui
eft couvert de cheveux: la partie inférieure
eft occupée par le front & terminée, comme
je l’ai d i t , par cette ligne tranfverfale fur
laquelle fe doivent trouver les yeux.
La moitié inférieure de la tête, c’efl-à-dire
celle, qui fe trouve au-deffous de cette ligne,
fe partage encore en deux parties égales, par
une ligne également tranfverfal'e , tk c’eft Ja
première de ces parties qui établit & fixe la
longueur du nez. Enfin ce quirefte de la tête,
toujours en defeendant, fe partage encore en
deux parties égales, mais toujours plus petites,
par une autre ligne tranfverfale parallèle aux
autres & cette ligne indique celle ue la bouçhe.
Voilà donc les dimenfions differentes établies *•
i° . La demie-tête :
a 6. La féminité de la tê te , jufqu’au front ;
Enfuite celle du front, jufqu’ à la naifiànce
du nez;
Enfuite celle du n e z -,
Et enfin l’ intervalle du bas du nez à la bouche,
Et la partie qui refte pour le menton.
La divifion ou mefure du corps entier par
faces eft plus favorable à P exactitude géomé-
trale que la divifion par têtes, pâtée que la
face étant une mefure moins grande, fe prête
davantage aux fubdivifions dont on a bèfoin.
On conçoit qu’ il a dû y avoir quelques
différences dans la grandeur des figures- adoptées
par les artiftes, premièrement, parce que
bien que cés dimenfions ayent'étéëtablies>d’après
un certain nombre de corps du plus beau choix,
il a dû fe trouver de légères différences entre
lesquelles les artiftes pouvoient fe décider à
leur gré, fans rifquer de s’éloigner beaucoup
de la perfection qu’ ils cherchoient.
Des raifons même ont du s’offrir à eux pour
autorifer leurs opinions ou féconder leur penchant.
Car ceux, par exemple, pour lefquels
une certaine élégance fvelte étoit une beauté
favorite, ont donné à leurs figures quelque chofe
de plus que ceux qui n’accordoient pas a cette
•perfection un fi grand prix, par exemple, l ’A pollon
& la Vénus ont quelque chofe dé plus
que les dix faces auxquelles on a généralement j
fixé la grandeur dé là figure entière.
Les ftatues antiques, regardées comme les
plus parfaites imitations de la figure humaine
qui nous l’oient connues, font par cette raifon,
les modèles qu’on doit étudier & fuivre. Elles
ont été mefurées & d iv fié e sp o u r connoître
toutes les dimenfions , foit générales, l'oit par-'
tielles. Elles peuvent,l’être encore, foit pour
confirmer , l'oit.pour indiquer les mefures con-
fignées dans plufiéurs Auteurs.
Ce feroit un ouvrage infiniment utile que
celui dans lequel un auteur artifle auroit le
courage d’examiner fcrupuleufement les mefures
générales & particulières de quelques belles
itatues, de les faire graver comparativement
fur une grande échelle de la manière la plus
méthodique & la plus claire ; d’ examiner enfuite
suffi fcrupuleufement les détails diffus &
prefqu’inintelligibles d’Albert Durer, enfuite
ce qu’a dit Léonard de Vinci, & de réduire
enfin à leur jufte valeur, d’après les antiques,
tous les ouvrages didactiques de ce genre , ainfi
que celui de Paul Lomazzo*, dont la prolixité
eft telle que les artiftes les plus laborieux &
les plus intelligens doiyent en 'être rebutés. 1
Gérard Audran a donné une efquiffa de l’ouvrage
que je viens de défigner; mais cet èffai
n’a pas .été fait comme il l’avoit projette lui-
même, & la partie critique, dont j’ ai parlé y
manque. On a eu recours jufqu’ à préfent, dans
les ouvrages de la nature de celui-ci, a ce
que de Piles a dit fur cet objet dans les remarques
dont il a enrichi le poème de Dq-
fréfnoy ; jepuiferai dans la mêmëfource,n’àyarit
pas le tems oéceffaire pour fuppiéer à ce qui
nous manque, qui demande un traite a part, a c compagné
d’ un très-grand nombre; de figures.
Voici donc, d’apres de Piles, quelques détails
fur les proportions qui en donneront une
idée à^ ceux qui n,e les connoiffent pas & qui
ont peu de notions fur cet objet. Quant aux
artiftes,,s’ ils ne.s’en contentent pas, cette dif-
pofition tournera fans doute au"profit de leur
infini ction, parce qu’alors ils prendront eux-
mêmes le foin de mefurer les antiques dont
les copies moulées font affez juftes, & de les
comparer avec la nature bien choifie. « Les
» anciens ont pour l’ordinaire donné huit têtes
»3 à leurs figures, quoique quelques-unes n’en
» ayent q uefep t; mais l ’on divife ordinaire-
ï> ment la figure en dix faces, favôir, depuis
» le fommet dé la tête jufqu’à la' plante des
» pieds, de la maniéré qui fuit :
» La partie qui s’étend depuis, îé fommet
» de la tête jufqu’au front eft la troifième par-
»'tie de la face.
» La face commence à la naiffahee des che-
» veux qui font fur le front & finit au bas du
» menton,
» La facefe divife en trois parties égales*.
>3 La première contient le front ;
» La fécondé le nez -,
>3 La troifième la bouche & le menton.
>3 Depuis lé menton jufquà la foffette qui
» fe trouve entre les clavicules, on compte
» deux longueurs de nez*
» De la foffette qui eft entre les clavicules,
33 au bas des mammelles, une face.
n Du bas des.mammelles au nombril, une
».face. On obferve que l’Apollon a la mefure
» d’un nez de plus.
>3 Du nombril.aux parties naturelles, une
» face. L’Apollon à encore dans cette dimen-
« fion, un nez de plus.
» Des parties naturelles au-deffus du genou,
>3 deux faces. On obferve que le milieu du
» corps de la Vénus-Médicis fe trouve au-def-
>3 fus des parties naturelles : & Albert Durer
» le place ainfi dans les proportions qu’ il pref-
» crit pour les femmes, ce qu’approuve de Piles.
» Le genou contient une demi-face;
>3 Du bas du genou au coup de pied, deux
>3 faces, i
33 Du coup de pied au-deffous de la plante,
» une demi - face ».