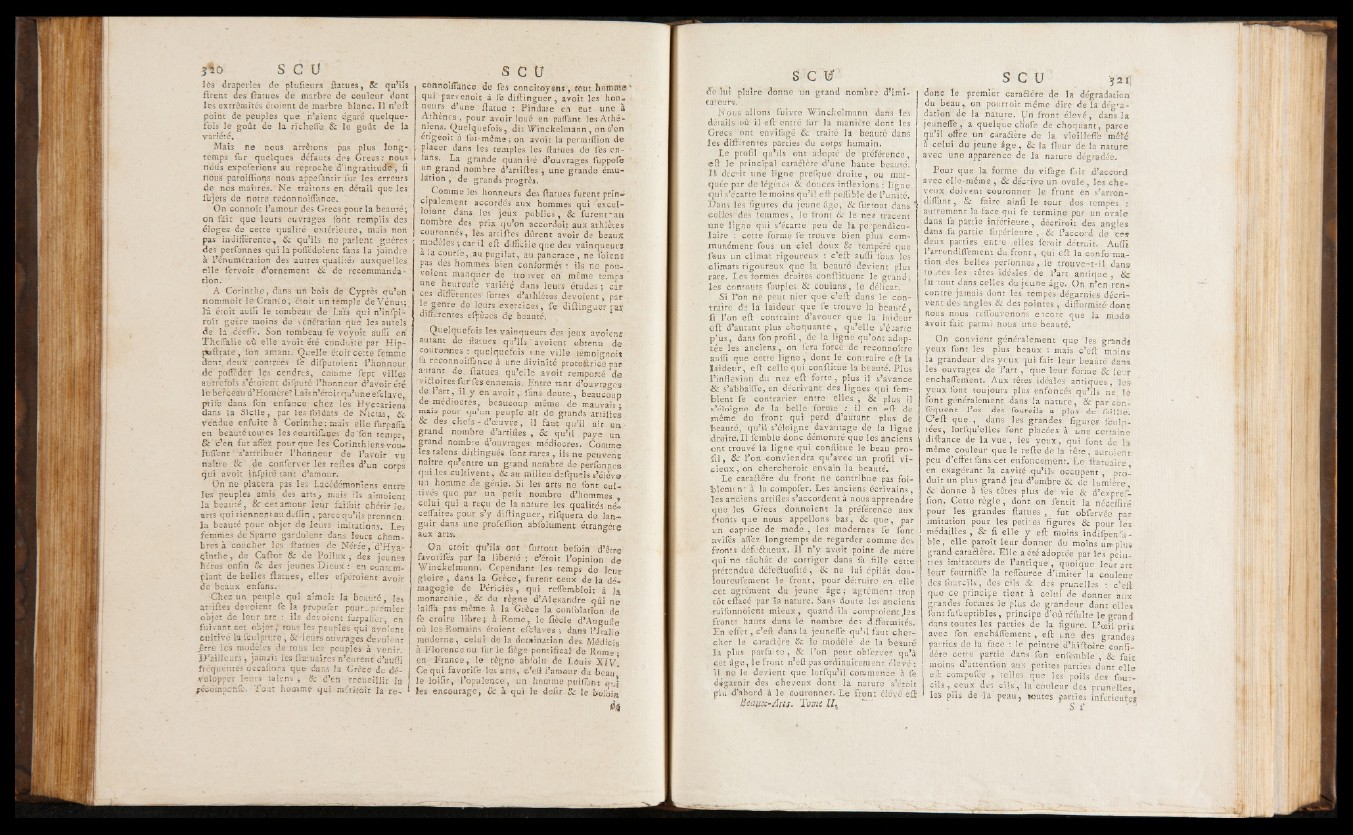
jto S C U
lès draperies de plufieurs flatues, & qu’ ils
firent des flatues de marbre de couleur dont
les extrémités étoient de marbre blanc. Il n’eft
point de peuplés que n’ aient- égaré quelquefois
le goût de la richeflè & le goût de la
variété..
Mais ne nous arrêtons pas plus longtemps
fur quelques défauts des Grecs: nous
nous expoferions au reproche d’ingratitude4, fi
nous paroiffioqs nous appelantir fur les erreurs
de nos maîtres. Ne traitons en détail que les
fiijets de notre reconnoiflance.
On connoît l ’amour des Grecs pour la beauté ;
on fait que leurs ouvrages font remplis: des
éloges de-cette qualité extérieure, mais non
pas indifférente:, & qu’ ils ne parlent gu ères
des perfonnes qui la poffédoient lans la joindre
à l’énumération des autres qualités auxquelles
elle fervoit d’ornement & de recommandation.
A Corinthe, dans un bois de Cyprès qu’on
nommoit le Crante, é’toit un temple de Vénus;
Là étoit au fil le tombeau' de Laïs qui n’infpi-
ro'it guère moins de vénération qué* les aute.îs
de là déefie. Son tombeau fe Voyoit aufii en
Thefialie où elle avoir été conduite par Hip-
psrftrare, ion amant. Quelle croit' cette femme
dont, deuk contrées fe difputoient l’honneur,
dé poffêder les cendres, comme fept villes
autrefois s’étoient difputé l’honneur d’avoir été 1 e berceau d’Homère? Laïs n’étoit qu’ uneefclave,
prife dans fon enfance chez les Hvccariens
dans la S ic ile , par les foldats de Nicias, Revendue
en fuite à Corinthe : mais elle furpafia
en beauté tout es les courtifaoes defbn temps,
& c’ en fut affez pour que les Corinthiens-vou-
Iuffént ‘s’attribuer l’honneur de l’avoir vu
naître & de çonferver les refies d’ un corps
qui avoir mfpiré tant d’amour.
On ne placera pas les Lacédémoniens entre
les peuples amis des arts3 mais ils aimoient
la beauté, & 'cet amour leur faifoït chérir les
arts qui tiennent au deffin, parce qu’ ils prennent
la beauté pour objet de leurs imitations. Les
femmes de Sparte gardaient dans leurs cham- j
b res à coucher les fiâmes de Nérée,’d’Hya- j
CÎnthej de Caflor & de Pollux , des jeunes i
héros enfin & des jeunes. D ieux : en contemplant
de belles flatues, elles efpéroïent avoir
de bçaux enfahs.
Chez un peuple qui aimait la beauté, les
arrifles dévoient fe la propofer pour,,premier
objet de leur art : ils dévoient furpaffer, en
fuivant cet objet ,' tous les peuples qui âyoient
cultivé la fculptùre, & leurs ouvj'âges dévoient
..être les modèles de tous les peuples à venir.
D ’ailleurs , jamais les flatuaires n’eurent d’ aufii
fréquentés occàfions que dans la Grcéë de développer
leurs talens j & d’en recueillir la
fécômpcftfib. Tout hoQime qui méritoic la re- 1
S C U
connôifiatîce de fes concitoyens, tout homme
qui ' par v en oit à fe diflinguer, avoit les honneurs
d’une fiatué : Pindaie en eut une à
Athènes , pour avoir loué en pafiant les Athéniens.
Quelquefois, dit Winckelmann , on s’ en
erigeoit à loi-même ; on avoit la permifiion de
placer dans les temples les flatues de lès cn-
rans. La grande quantité d’ouvrages fuppofe
un grand nombre d’artifles , une grande émulation
, de grands progrès.
. Comme les honneurs dès flatues furent priiw
cipalemenr accordés aux hommes qui excel-
<loient dans lès jeux publics , & .furent'-ail
nombre des prix qu’on accordoic aux athlètes
couronnes, lès artifles dûrent avoir de beaux
modèles ; car il efl difficile que des vainqueurs
a la courte,, au pugilat, au pancrace , ne loient
pas des hommes bien conformés : ils rie pou-
votent manquer de trouver on même temps
une h eu reufe variété dans leurs études ; car
ces différentes fortes d’athlètes dévoient, par
le genre de leurs exercices , fe diflinguer raç
différentes el^èces dg beauté.
Quelquefois les-vainqueurs des jeux avoienfi
autant de flatues qu’ils/ ayoient obtenu de
couronnes : quelquefois, une. v ille témoignoit
fa reconnoiflance à' une divinité proteôricé par
autant de. flatues qu’elle avoit' remporté de
victoires fur fés ennemis. Entre tant d’ouvrages
de l’art, il y en avoir, fans doute., beaucoup
de médiocres, beaucoup même de mauvais;
mais pour qu’un peuple ait de grands artifles
& des chefs - d’oeuvre, il faut qu’il ait un
grand nombre d’artifles , 8c qu’ il paye un
grand nombre d.’ouvrages médiocres. Comme
les talens diflingues font rares, ils ne peuvent
naître qu’ entre un grand nembre de perfonnes
qui les cultivent, & au milieu dsfquels s’élève
un homme de génie. Si les arts ne font cultivés
que par un petit nombre d’hommes
celui qui a reçu de la nature les qualités né^
cefiaires pour s’ y diflinguer, rifquera de. languir
dans une profefîion abfolument étranger©
aux artSi
On croit cju’ ils ont furtout bëfoin d’être
favorifés par la liberté ; çfétoit l’opinion de
Winckeîmann. Cependant les temps de leur
gloire , dans la Grèce,- furent ceux de la dé-r
magogie de Péri c lé s , qui reffembloit à Ja
monarchie., & du règne d’Alexandre qui ne
laifla pas même à la Grèce la confolatfon de
fe croire libre.; à Romé, le fiècle d’Augufle
où les Romains étoient efclàves ; dans l’It-ali©
moderne, celui de la domination des Médîcis
à Florence ou fur le fiège pontifical de Rome -
en France, le règne abfolu de Lôuis XIV*
Ce qui favorife les'arts, ‘c’ eft l’amour du beau*
le loifir, l ’opulence, un homme puifFant
tes encourage, 8c à qui le defir 3c le befoia
h
dô lui plaire donne un grand nombre d’ imitateurs.
_
Nous allons fuivre Winckelmann dans les
détails où il efl entré fur la manière dont les
Grecs ont envifagé 8c traire la beauté dans
les differentes parties du corps humain.
Le profil qu’ ils ont adopté de préférence,
efl: le principal caractère d’une haute beauté.
I l décrit une ligne prefque droite , ou marquée
par de légères & douces inflexions : ligne
qui s’écarte le moins qu’ il efl poffible de l’ unité.
Dans lés figures du jeune âge, & furtout dans '
celles des femmes , le front & le nez tracent
une ligne qui s’écarte peu de la perpendiculaire
: cette forme fe trouve bien plus communément
fous un ciel doux & tempéré que
fous un climat rigoureux : c’efl aufii fous les
climats rigoureux que la beauté devient plus
rare. Les formes droites conflitùent le grand;
les contours fouples & coulans, le délicat.
Si Fon ne peut nier que c’efl dans le contraire
de la laideur que fe trouve la beauté,
fi l’on efl contraint d’avouer que la laideur
e fl d’autant plus choquante , qu’elle s’écarte
p’ us, dans fon profil, de la ligne qu’ont adoptée
les anciens, on fera forcé de reconnoître
aufii que cette ligne , dont le contraire efl la
laideur , efl celle qui conflitae la beauté. Plus
l’ inflexion du nez efl forte, plus il s’avance
& s’abbaiflè, en décrivant des lignes qui fem-
blent fe contrarier entre elles., & plus il
s’éloigne de la belle forme :^il en efl de.
même du front qui perd d’autant plus dé
beauté, qu’ il s’éloigne davantage de la ligne
droite. I l femble donc démontré que les anciens
ont trouvé la ligne qui conftitue le beau profil
, & l’otuconviendra qu’ avec un profil v ic
ieu x, ort chercheroit envain la beauté.
Le caractère du front ne contribue pas foi-
blement a la compofer. .Les anciens écrivains,
les anciens artifles s’accordent a nous apprendre
que les Grecs donnoient la préférence aux
fronts que nous appelions bas, & que, par
un caprice de mode , les modernes fe font
avifés affez longtemps de regarder comme des
fronts défectueux. I l n’y avoit point de mère
qui ne tâchât de corriger dans fa fille cette
prétendue défeéiuofité , & ne lui épilât dou-
îoureufemen-t le front, pour détruire en elle
cet agrément du jeune âge ; agrément trop
tôt effacé par l a nature. Sans doute les anciens
raifonnôient mieux, quand ils comproient.les
fronts hauts dans lé nombre des difformités.
En effet, c’efl dans la jeuneffe qu’ il faut cher-,
cher le càraêtère & le modèle de la beauté
J a plus parfaite , 8c l’on peut obier ver qu’à
cet âge, le front n’ eft pas ordinairement élevé :
il ne le devient que lorfqu’ il commence à fe
dégarnir des cheveux dont la nature s’étoit
plu d’abord à le couronner. Le front cl éyé èft
Meaux-Art s. Tome . ■ :v f
donc le premier caraêlère de la dégradation
du beau, on pourroit même dire de la dégradation
de la nature. Un front é levé , dans la
jeuneffe , a quelque cnofe de choquant, parce
qu’il offre un'caraétère de la vieilleffe mêlé
à celui du jeune â g e , & la fleur de la nature
avec une apparence de la nature dégradée.
Pour que la forme du vifage foie d’accord
avec elle-même , & décrive un ovale , les cheveux
doivent couronner le front en s’arron-
diflant, & faire ainfi le tour des tempes :
autrement la face qui fe termine par un ovale
dans fa partie inférieure,, décriroit des angles
dans fa partie fupérieure , & l’accord de te s
deux parties entre .elles feroit détruit. Aufii
l’arrondiffement du front, qui éfl la confirmation,
des belles per,'onnés, fie trouve-t-il dans
ro.ites les têtes idéales de l’arc antique, &
lu coût dans celles du jeune âge.. On n’ en rencontre
jamais dont les tempes dégarnies décrivent
des angles & des pointes , difformité donc
nous nous reffouvenons encore que la mode
avoit fait parmi nous une beauté.
On convient généralement que les grands
yeux font lès plus beaux : mais c’efl moins
la grandeur des yeux qui fait leur beauté dans
les ouvrages de l’a r t , que leur forme & leur
enchaffeiïient. Aux fêtes idéales antiques, les
yeux font toujours plus enfonces qu’ ils ne le
font généralement dans la nature , & par conr
féquent l ’os des fourcils a plus de-faillie.
C’efl: que., dans les grandes figures ficulp-
tées, lorfqu’elles font placées à une certaine
diflance de la vu e , les yeu x, qui font de la
même couleur que le refie de la tête, auroient
peu d’effet fans cet enfoncement. Le flatuaire
en exagérant la cavité qu’ ils occupent, produit
un plus grand jeu d’ombre & de lumière
& donne à les têtes plus de vie & d’ expref-
fion. Cette règle , dont on fentit la nécefiité
pour les grandes flatues , fut obfervée par
imitation pour les petites figures & pour les
médailles , & fi elle y efl moins indifpenfa-
ble, elle paroît leur donner du moins un-plus
grand caraêlère. Elle a été adoptée par les peintres
imitateurs de l’antique , quoique leur art
leur fourniffe la reffource d’ imiter la couleur
des lburcils, des cils 3c des prunelles : c’efl
que ce principe tient à celui de donner aux
grandes formes le plus de grandeur dont elles
font fufceptibles, principe d’où réfulte le grand
dans toutes les parties de la figure. L’oeil pris
avec fon enchâffement, efl une des grandes
parties de la face : le peintre d’ hifloire confi-
d.ère cette partie dans fon en femble , & fait
moins d’attention aux petites parties dont elle
efl compofée , telles que les poils des fournils
, ceux des c ils , la couleur des ; Dr un elles
les plis de la peau, toutes parties inférieures