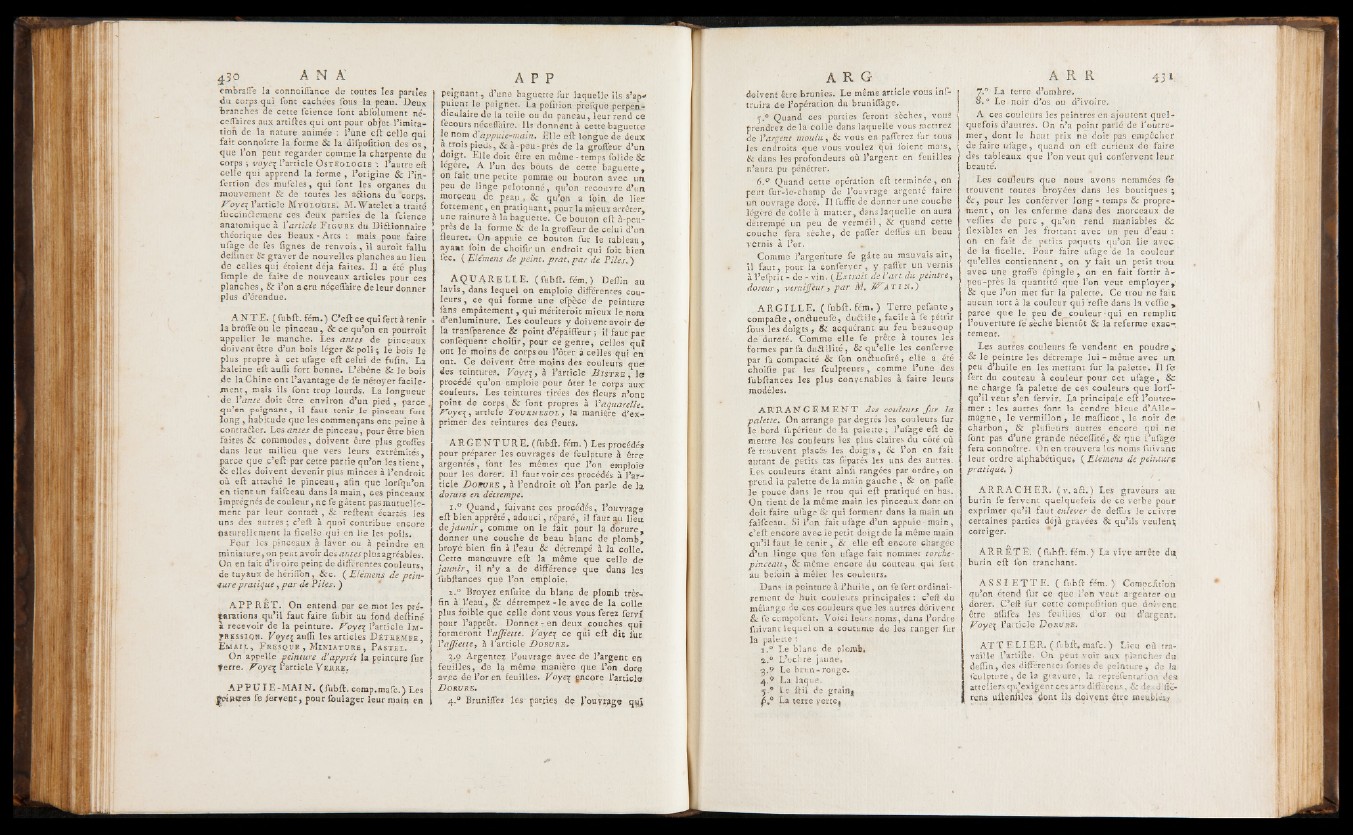
embraffe la connoiffance de toutes les parties
du corps qui font cachées fous la peau. Deux
branches de cette fcience font abfoluraent né-
ceffaires aux artiftes qui ont pour objet l’imitation
de la nature animée : l’ une eft celle qui
fait connoître la forme & la difpofition des o s ,
que l’on peut regarder cpmme la charpente du
corps ; voye\ l’ article Ostéologie l ’autre eft
celle qui apprend la forme , l’origine & l’in-
fertion des mufcles, qui font les organes du
mouvement & de toutes les allions du corps.
Foye^ l’article Myolo'gie. M. Watelet a traité
luccindement ces deux parties de la fcience
anatomique à 1*article Figure du Di&ionnaîre
théorique des Beaux-Arts : mais pour faire
ufage de fes lignes de renvois, il auroit fallu
defliner &: graver de nouvelles planches au lieu
de celles qui étoient déjà faites. I l a été plus
fimple de faiVe de nouveaux articles pour ces
planches, & l ’on a cru néçeffaire de leur donner
plus d’étendue.
A N T E . ( fubft. fém. ) C’eft ce qui fort à tenir
la broffe ou le pinceau, & ce qu’on en pourrait
appeller le manche. Les antes de pinceaux
doivent être d’ un bois léger & poli ; le bois le
plus propre à cet ufage eft celui de fufin. La
baleine eft aulîi fort bonne. L’ébène & le bois
de la Chine ont l’avantage de fe nétoyer facilement,
mais ils font trop lourds. La longueur
de Vante doit être environ d’un pied , parce
qu’en peignant, il faut tenir le pinceau fort
lo n g , habitude que les commençans ont peine à
contra&er. Les antes de pinceau, pour être bien
laites & commodes, doivent être plus greffes
dans leur milieu que vers leurs extrémités,
parce que p’eft par cette partie qu’on les tient,
& elles doivent devenir plus minces à l’endroit
où eft attaché le pinceau, afin que lorfqu’on
en tient un faifeeau dans la main, ces pinceaux
imprégnés de couleur, ne fe gâtent pas mutuellement
par leur con ta i , & relient éçarfés Jes
uns des autres ; c’eft à quoi contribue encore
naturellement la ficelle qui en lie les poils.
Pour les pinceaux à laver ou à peindre en
miniature, on peut avoir devantes plus agréables.
Ôn en fait d’ ivoire peint; de différentes couleurs,
de tuyaux de hériffon, & c. ( Elémens de peinture
pratique, par de Piles. )
A P P R Ê T . On entend par ce mot les peé-
tarations qu’ il faut faire fubir au fond deftiné
a recevoir de la peinture. Foyer l’article Impression.
V_Qyei aulîi les articles Détrempe ,
Email, Fresque , Miniature, Pastel.
On appelle peinture d’apprêt la peinture fur
ferre. Foye-^ l ’article V e^ re»
A P P U IE -M A IN , (fubft. comp.mafc.) Les
|p»sres fe ferrent, pour Ibulager leur irçain en
peignant, d’une baguette fur laquelle ils s’ap-*
puient le poignet. La polirion prefque perpendiculaire
de la toile ou du paneau, leur rend ce
fecours neceffaire. Ils donnent à cette baguette
le nom d appuie-main, Elle eft longue de deux
i * t.rois pieùs, & à-peu-près de la groffeur d’un
doigt. Elle doit être en même-temps folide &
i légère. A l’ un des bouts de cette baguette,
’ on fait une petite pomme ou bouton avec un
peu de linge pelotonné, qu’on recouvre d’ un
morçeau de peau » 8c qu’on a loin de lier
! fortement, en pratiquant, p.our la mieux arrêter,
; une rainure a labagiiette. Ce bouton eft à-peu-
près de la forme & de la groffeur de celui d’un
| fleuret. On appuie ce bouton fur le tableau,
i ayant foin de choifir un endroit qui foit bien
fec. ( Elémens de peint, prat, par de Piles, )
A Q U A R E L L E , (fubft. fém.) Deflïn au
lavis, dans lequel on emploie différentes couleurs,
ce qui forme une efpèce de peinture
fans empâtement, qui mériteroit mieux le nom
. d’ enluminure. Les couleurs y doivent avoir de
la tra-nfparenee & point d’épaiffeur -, il faut par
conféquent choifir, pour ce genre, celles qui
ont le moins de corps ou l ’ôter à celles qui en
ont. Ce doivent être moins des couleurs que
des teintures. Voye^, à l’article B i s tre , le
procédé qu’on emploie pour ôter le corps aux
couleurs. Les teintures tirées des fleurs n’ont
point de corps N & font propres à Vaquarelle,
Foye-{, article T o u r n e s o l , la manière d’ exprimer
des teintures des fleurs.
A R G E N T U R E . ( fubft. fém. ) Les procédés
pour préparer les ouvrages de fculpture à être
argentés, font les mêmes que l’on emploie
pour les dorer; Il faut voir ces procédés à l’article
D o ru re. , à l’endroit où l’on parle de la
dorure en détrempé.
i .° Quand, fuivant ces procédés, l’ouvrage
eft bien apprêté, adouci, réparé, il faut ap lieu
do jaunir y comme on le fait pour la dorure-
donner une couche de beau blanc de plomb,
broyé bien fin à l’eau & détrempé à la colle.
Cette manoeuvre eft la même que celle de
jaunir y il n’y a de différence que dans les
iubllances que l’on erçiploie.
t.° Broyez enfuite du blanc de plomb très-?
fin à lfeau, & détrempez-le avec de la colle
plus foible que celle dont vous vous ferez fervi
pour l’apprêt. Donnez 7 en deux couches qui
formeront Vaffiette. Voye% Ce qui eft dit fur
VaJJiettc, à l ’article D o r u r e ,
3,P Argente? l’ouvrage àvec de l ’argent en
feuilles, de la même manière que l’on dore
avec de For en feuilles. Voye% çncore Partiel«
D o ru r e ,
4.0 Bruniffez les parties de ^ouvrage quji
doivent être brunies. Le même article vous inf-
truira de l’opération du bruniffage.
5.0 Quand ces parties feront sèches, vous
prendrez de la colle dans laquelle vous mettrez
de Vargent moulu, & vous en pafferez fur tous
les endroits que vous voulez qui l’oient mats,
& dans les profondeurs où l’argent en feuilles
n’ aura pu pénétrer.
6.° Quand cette opération cfl terminée, on
peut fur-le-champ de l ’ouvrage argenté faire
un ouvrage doré. Il fuffit de donner une couche
légère de colle à matter, dans laquelle on aura
détrempé un peu de v erméil, & quand cette
couche fera sèche, de paffer deffus un beau
vernis à l’or.
Comme l’argenture fe gâte au mauvais air,
il faut, pour la conferver , y palier un vernis
à l’efprit - de - vin. ( Extrait de l ’art du peintre y
doreur, vtrnijfeur , par M, T F a t i n ,)
A R G I L L E . (fub ft. fém. ) Terre pefante ,
compare, on&ueufe, duélile , facile à fe pétrir
fous les doigts , & acquérant au feu beaucoup
de"Üureté. Comme elle fe prête, à toutes les
formes par fa duftilite, & qu’elle les conferve
par fa compacité & fon on&uofité, elle a ete
choifie par les fculpteurs, comme l’ une des
lubftances les plus convenables à faire leurs
modèles.
A R R A N G E M E N T des couleurs fu r la
palette. On arrange par degrés les couleurs fur
le bord lupérieur de la palette ; l’ ufage eft de
mettre les couleurs les plus claires du côté où
fe trouvent placés les doigts, & l’on en fait
autant de petits tas féparés les uns des autres.
Les couleurs étant ainfi rangées par ordre, on
prend la palette de la main gauche , & on paffe
le pouce dans le trou qui eft pratiqué en bas.
On tient de la même main les pinceaux dont on
doit faire ufage & qui forment dans la main un
faifeeau. Si l’on fait ufage d’ un appuie*main,
c’eft .encore avec ie petit doigt de la même main
qu’ il faut le tenir , & elle eft encore chargée
d’ un linge que fon ufage fait nommer torche-
pinceau y & même encore du couteau qui fert
au befoin à mêler les couleurs»
Dans la peinture à l’huile, on fe fert ordinairement
de huit couleurs principales : c’ eft du
mélange de ces couleurs que les autres dérivent
Si. fe ccmpofcnt. Voici leurs noms, dans l’ordre
fuivant lequel on a coutume de les ranger fur
la palette t
i . ° Le blanc de plomb«
2..0 L’ochre jaune«
3 . ? Le brun-rouge.
4, :? La laque.
y.° Le ftil de graift|
p.° La terre vertej
j 7.° La terre d’ombre.
o.° Le noir d’os ou d’ ivoire.
\ A ces couleurs les peintres en ajoutent quelquefois
d’autres. On n’a point parlé de l’outremer,
dont le haut prix ne doit pas empêcher
( de faire ufage, quand on eft curieux de faire
des tableaux que l ’on veut qui confervent leur
beauté.
Les couleurs que nous avons nommées fe
trouvent toutes broyées dans les boutiques ;
& , pour les conferver long-temps & proprement,
on les enferme dans des morceaux de
vefties de porc , qu’on rend maniables 8c
flexibles en les frottant avec un peu d’eau :
oh en fait de petits paquets qu’on lie avec
de la ficelle. Pour faire ufage de la couleur
qu’elles contiennent, on y fait un petit trou,
avec une groffe épingle, on en fait fortir à-
peu-près la quantité que l’on veut employer y
& que l’on met fur la palette. Ce trou ne fait:
aucun tort à la couleur qui ’relie dans la veflie %
parce que le peu de^ couleur-qui en remplie
l’ouverture fe sèche bientôt & la referme exactement.
. .
Les autres couleurs fe vendent en poudre y
& le peintre les détrempe lu i-m êm e avec un
peu d’huile en les mettant fur la palette. I l fe
fert du couteau à couleur pour cet ufage, &
ne charge fa palette de ces couleurs que lorf-
qu’ il veut s’en fervir. La principale eft l ’outremer
; les autres font la cendre bleue d’A lle magne
, le vermillon, le mafficot, le noir de
charbon, & plufieurs autres encore qui ne
font pas d’une grande nécefllté, & que F ufage
fera connoître. On en trouvera lés noms fuivanc
leur ordre alphabétique« ( Elémens de peinture
pratique, )
A R R A C H E R . ( v. aél. ) Les graveurs au
burin fe fervent quelquefois de ce verbe pour
exprimer qu’ il faut enlever de deffus le cuivre
certaines parties déjà gravées & qu’ ils veulent;
corriger.
A R R E T É , (fubft. fém.) La vive arrête du,
burin eft fon tranchant.
A S S I E T T E . ( fubft fém. ) Compcütîon
qu’on étend fur ce que l ’on Veut argenter ou
dorer. C’ eft fur cette compofition que doivent
être afîifes les feuilles; d’or ou d’ argent.
Foye\ l’article D o r u r e .
A T T E L IE R . (,fubft.mafe. ) Lieu où travaille
l’artifle. On peut voir aux planches du
deflïn, des différentes fortes de peinture, de la
fculpture, de la gravure, la repréfentarion des
attelier.s qu’exigent ces arts diffère.h s., & de>d'fte-
rens uftenfiles dont ils doivent être meublés^