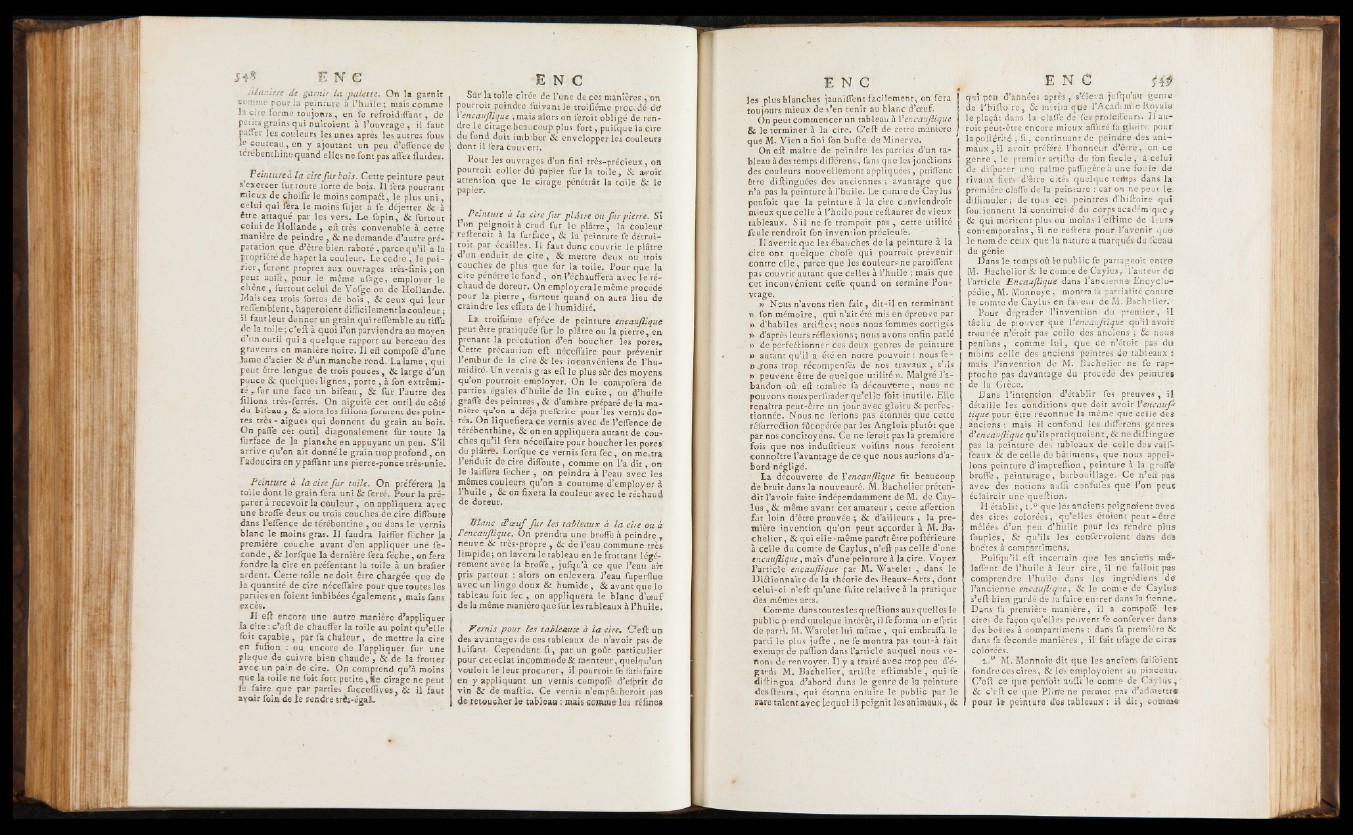
e n e
Jilaniere de garnir La palette. On la garnît
somme pour la peinture à l’ huile; mais comme
la cire forme toujours., en fe refroidiflant , de
petits grains qui nuiroient à l’ouvrage, il faut
paner les couleurs les unes après les autres fous
le couteau, en y ajoutant un peu d’cflence de
térébenthine quand elles ne font pas affez fluides.
i ’Peinture à la cire fur bois. Cette peinture peut
s exercer lur toute lorte de bois. Il fera pourtant
mieux de choiflr le moins compaél, le plus u n i,
celui qui fera le moins fuj.et à fe déjetter & à
être attaqué par les vers. Le fapin, & furtout
celui de Hollande , eft très convenable à cette
manière de peindre , & ne demande d’autre préparation
que d’être bien raboté , parce qu’ il a la
propriété de haperla couleur. Le cedre , le poirier
, feront propres aux ouvrages très-finis ; on
peut aufli, pour le même ufage, employer le
chêne , furtout celui de Vofge ou de Hollande.
Idaîs ces trois fortes de bois & ceux qui leur
reflemblent, haperoient difficilement la couleur ;
il faut leur donner un grain quireflemble au tiffu
de la toile; c’ eft à quoi l’on parviendra au moyen
d’un outil qui a quelque rapport au berceau des
graveurs en manière noire. I l eft compofé d’une
lame d’acier & d?un manche rond. La lame-, qui
peut être longue de trois pouces, & large d’ un
pouce & quelques lignes, porte , à fon extrémité
,, fur une face un bifeau, & fur l’autre des
filions très-ferrés. On aiguiie cet outil du côté
du bifeau , & alors les filions forment des pointes
très - aigues qui donnent du grain au bois.
On pafle cet outil diagonal ement fur toute la
furface de la planche en appuyant un peu. S’il
arrive qu’on ait donné le grain trop profond , on
Tadoucira en y partant une pierre-ponce très-uniel
Peinture à la cire fu r toile. On préférera la
toile dont le grain fera uni & ferré. Pour la préparera
recevoir la couleur , on appliquera avec
une brolfe deux ou trois couches de cire diffoute
dans l’effence de térébentine , ou dans le vernis
blanc le moins gras. I l faudra laiffer fécher la
première couche avant d’en appliquer une fécondé
, & lorfque la dernière fera féehe, on fera
fondre la cire en préfentant la toile à un brafier
ardent. Cette toile ne doit être chargée que de
la quantité de cire néceffaire pour que toutes les
parties en foient imbibées également , mais fans
excès.
Il eft encore une autre manière d’appliquer
la cire : c’eft de chauffer la toile au point qu’ elle
foit capable ? par fa chaleur, de mettre la cire
en fufion : ou encore de rappliquer fur une
plaque de cuivre bien chaude , & de la frotter
avec un pain de cire. On comprend qu’à moins
que la toile ne foit fort petite , He cirage ne peut
fe faire que par parties fuccefïïves, & il faut
zxo.it foin de le rendre très-ë&aL
e n c
Sûr la toile cirée de l’une de ces manières ,'on
pourroit peindre fuivant le troifiéme procédé dé
1 encaujlique ; mais alors on feroit obligé de rendre
le.cirage beaucoup plus fo r t, puifque la cire
du fond doit imbiber & envelopper les couleurs
dont il fera couvert.
Pour les ouvrages d’un fini très-précieux, on
pourroit coller dû papier fur la toile, & a-voir
attention que le cirage pénétrât la toile & le
papier.
? Peinture a la cire fier plâtre ou fur pierre. Sî
1 on peignoit à crud fur le plâtre, la couleur
refteroit a la furface, & la peinture fe détrui-
roit par écaillés. Il faut donc couvrir le plâtre-
d’un enduit de cire , & mettre deux ou trois
couches de plus que lur la toile. Pour que la
cire pénétre ie fond , on l’échauffera avec le'réchaud
de doreur. On employeralemême procédé
pour la pierre , furtout quand on aura lieu de
craindre les effets de l ’humidité.
La troifiéme efpéee de peinture encaujlique
peut être pratiquée fur le plâtre ou la pierre, en:
prenant la précaution d’en boucher les pores*
Cette précaution eft néceflaire pour prévenir
l’embut de la cire & les in-cenvéniens de l’humidité.
Un vernis gras eft le plus sûr des moyens
qu on pourroit employer. On le eompofera de
parties égales d’huile de lin cuite , ou d’huile
grafTe des peintres , & d’ambre préparé de la manière
qu’on a déjà preferite pour'les vernis dorés.
On liquéfiera ce vernis avec de l’elfence de
térébenthine, & on en appliquera autant de couches
qu’ il fera néceflaire pour boucher les pores'
du plâtre. Lorfque ce vernis fera fe c , on mettra
l’enduit de cire difloute , comme on l ’a d i t , on
le^laiflera fécher , on peindra à l’eau avec les
memes couleurs qu’ on a coutume d’employer à
l’huile , & on fixera la couleur aveç le réchaud
de doreur.
Plane' iVceuf fur les tableaux à la cire ou à
Pencaujlique, On prendra une brofle à peindre ,
neuve 8c très-propre , & de l’eau commune très
limpide; on lavera le tableau en le frottant légèrement
avec la broffe, jufqu’à ce que l’eau ait
pris partout : alors on enlevera l’eau fuperflue
avec un linge doux & humide, & avant que le
tableau foit lec , on appliquera le blanc d’oeuf
de la même manière que fur les tableaux à l’huile.
Vernis pour les tableaux à la cire, C ’eft un
des avantages de ces tableaux de n’avoir pas de*
luifanr. Cependant fi, par un goût particulier
pour cet éclat incommode & menteur, quelqu’ un
vouloit le leur procurer, il pourroit fe fatisfaire
en y appliquant un vernis com-pofe d’èfprit de
vin & de maftic. Ce vernis n’empécheroit pas-
de retoucher le tableau r mais comme les réfine»
E N C
les plus blanches jauniflenc facilement, on fera
toujours mieux de s’en tenir au blanc d’oeuf.
On peut commencer un tableau à l’encaujlique
& le terminer à la cire. G’eft de cette manière
que M. Vien a fini fon buftç de Minerve.
On eft maître de peindre les parties d’un tableau
à des temps différens, fans que les jonélions
des couleurs nouvellement appliquées, puifient
être diftinguées des anciennes ; avantage que
n’a pas la peinture à l’huile. Le comte de Caylus
penfoit que la peinture à la cire conviendroit
mieux que celle a l ’huile pour reflaurer de vieux
tableaux. S il ne fe trompoit pas , cette utilité
feule rendroit fon invention précieufe.
Il avertit que les ébauches de la peinture à la
cire ont quelque chofe qui pourroic prévenir
contre e lle , parce que les couleurs ne paroiflent
pas couvrir autant que celles à l’huile ; mais que
cet inconvénient cefle quand on termine l’ouvrage.
'» Nous n’avons rien fa it , dit-il en terminant
» fon mémoire, qui n’ait été mis en épreuve par
» d’habiles artiftes ; nous nous fommes corrigés
» d’après leurs réflexions; nous avons enfin parlé
>> de perfectionner c es deux genres de peinture J
» autant qu’il a été en notre pouvoir : nous feutrons
trop récompenfés de nos travaux , s’ ils
» peuvent être de quelque utilité». Malgré l’abandon
où eft tombée fa découverte, nous ne
pouvons nousperfuader qu’elle foit inutile. Elle
renaîtra peut-être un jour avec gloire & perfectionnée.
Nous ne ferions pas étonnés que cette
réfurreéllon fût opérée par les Anglois plutôt que
par nos concitoyens. Ce ne feroit pas la première
fois que nos induftrieux voifins nous feroient
connoître l ’avantage de ce que nous aurions d’abord
négligé.
La découverte de l’encaujlique fit beaucoup
de bruit dans la nouveauté. M. Bachelier prétendit
l’avoir faite indépendamment de M. de Caylus
, & même avant cet amateur ; cette aflertion
fut loin d’être prouvée \ & d’ailleurs , la première
invention qu’on peut accordera M. Bachelier,
&qui elle-même paraît être poftérieure
à celle du comte de Caylus, n’eft pas celle d’une
encaujlique, mais d’une peinture à la cire. Voyez
l ’article encaujlique par M. Watelet , dans^ le
Di&ionnaire de la théorie des Beaux-Arts, dont
celui-ci n’eft qu’une fuite relative a la pratique
des mêmes arts.
Gomme dans toutes les queftions auxquelles le
public prend quelque intérêt, il fe forma un efprit |
de parri, M. Watelet lui même , qui embrafla le
parti le plus jufte , ne fe montra pas tout-à fait
exempt de paflion dans l’article auquel nous venons
de renvoyer. Il y a traité avec trop peu d’égards
M. Bachelier, artifte eftimable , qui fe
diftingua d’abord dans le genre de la peinture
desfleurs, qui étonna enfuite le public par le
rare talent avec lequel il peignit les animaux,. & i
E N C ƒ#
j qui peu d’années après, s’éleva jufqu’au geme
I de l ’hifto.re, & mérita que l’Academie Royale
| le plaçât dans la dalle de lès profefl’eurs. Il au-
) roit peut-être encore mieux alfuré la gloire pour
lapoflérité, fi, continuant de peindre des animaux
, il avoit préféré l’honneur d’être, en ce
genre , le premier artifte de fon fieéle , à celui
'de difputer une palme paflagère à une foule de
rivaux fiers d’être cités quelque temps dans la
première clafle de la peinture : car on ne peut le.
diflimuler; de tous ces. peintres d’hiftoire qui
fou tiennent là continuité du corps académique *■
& qui méritent plus ou moins Teftime de leurs
contemporains, il ne reliera pour l’avenir que
ie nom de ceux que la nature a marqués du fceau
du génie
Dans le temps où le public fe partageoit entre
M. Bachelier & le Comte de Caylus, l’auteur de'
l’article Encaujlique dans l’ancienne- Encyclopédie
, M. Monnoye, montra fa partialité contre
le comte de Caylus en faveur de M. Bachelier.
Pour dégrader l’invention du premier, il
tâcha de prouver que Yéneauftique, qu’il avoit
trouvée n’étoit pas celle des anciens ; & nous
penfons , comme lu i , que ce n’étoit pas dit
moins celle des anciens peintres de tableaux i
mais l’ invention de M. Bachelier ne fe rap-'
proche pas davantage du procédé des peintre»
de la Grèce.
Dans l ’ intention d’établir fes preuves, il
détaille les conditions que doit avoir Ÿencauf*
tique pour être reconnue la même que celle des
anciens : mais il confond les^différens genres
d’encaujlique qu’ ils pratiquoient, & ne diftingué
pas la peinture des tableaux de celle des vaift
féaux & de celle de bâtimens, que nous appelions
peinture d’ impreffion, peinture à la grofiTé
brofle, peinturage, barbouillage. Ce n’eft pas
avec des notions aufli confufes que l’on peut
éclaircir une queftion.
Il établit, i.° que lès anciens peignaient avec
des cires colorées, qu’ elles étoient peut-être
mêlées d’ un peu d’ huile pour les rendre plus
fouplès, & qu’ils les confervoient dans de»
boëtes â' compartimens.
Puifqu’ il eft incertain que les anciens me*
laflent <fe l’huile à leur cire, il ne falloit pas
comprendre l’huile dans les ingrédiens dé’
l’ancienne encaujlique, & le comte de Caylus
s’ eft bien gardé de la faire entrer dans la fienne*
Dans fa première manière, il a compofé les
cires de façon qu’elles peuvent fe conferver dans
des boëtes à compartimens : darfs fa première &
dans fa fécondé manières , il fait ufage de cires
colorées.M
. Monnoie dit que les anciens faifoient
fondre ces cires, & lés employaient au pinceau.-
C ’eft ce que penfoit aufli le comte de Càylus , ■
& c’eft ce que Pline ne permet pas d’ admettr«
pour la- peinture des tableaux: il- d it, comme