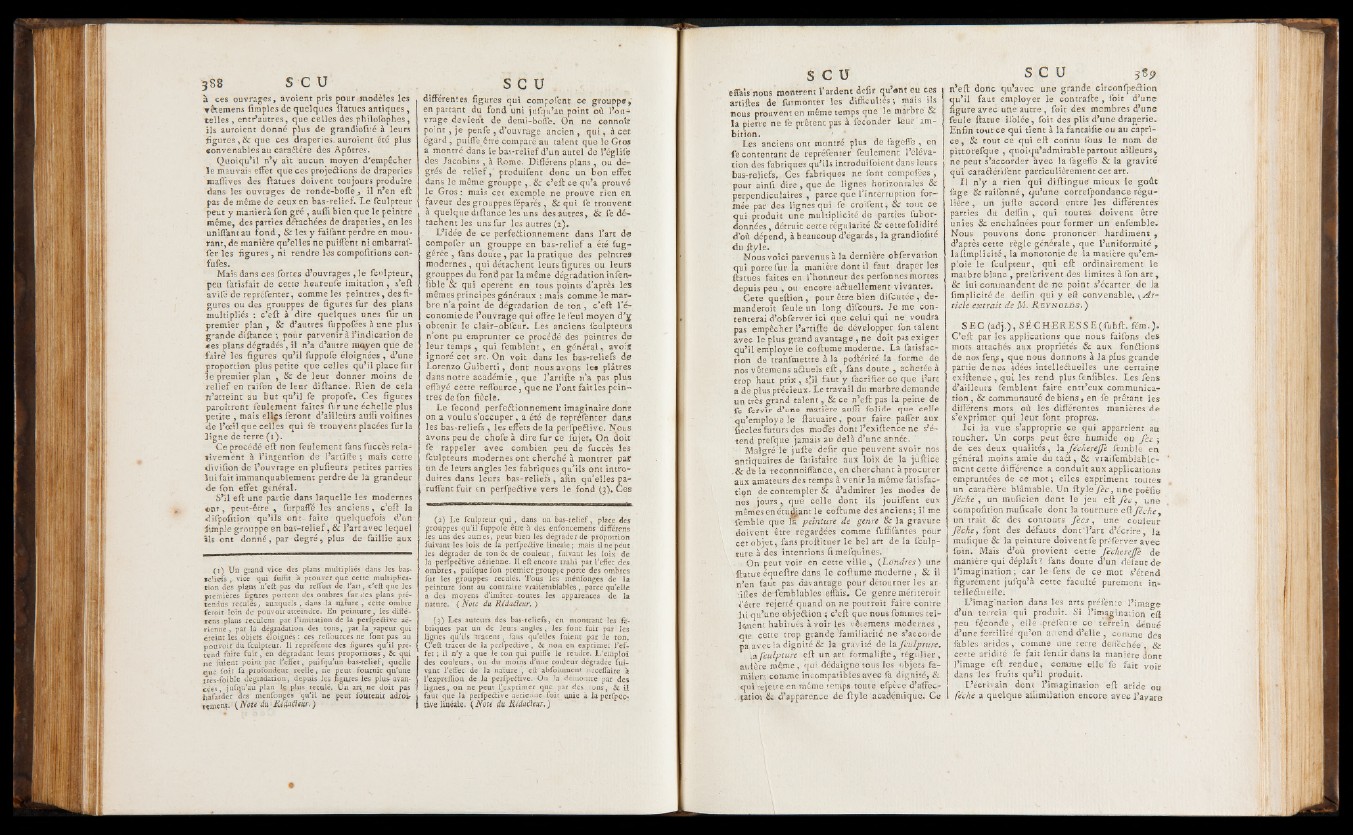
à ces ouvrages, avoient pris pour modèles les
vêtemens fimples de quelques ftatues antiques ,
te lle s , entr’ autres, que celles des philofophes,
ils auroient donné plus de grandiofité à leurs
figures , & que ces draperies, auroient été plus
convenables au caraCtère des Apôtres.
Quoiqu’ il n’y ait aucun moyen d'empêcher
le mauvais effet que ces projetions de draperies
mafiïves des ftatues doivent toujours produire
dans les ouvrages de ronde-boffe , il n’en eft
pas de même de ceux en bas-relief. Le fculpteur
peut y maniera fon gré , aufli bien que le peintré
même, des parties détachées de draperies, en les
unifiant au fon d , & les y faifant perdre en mourant,
de manière qu’elles ne puiflent ni embarraf-
fer les figures, ni rendre les compofitîons con-
fufes.
Mais dans ces fortes d’ouvrages , le fculpteur,
peu fatisfait de cette heureufe imitation, s’eft
av ’ifé de repréfenter, comme les peintres, des figures
ou des grouppes de figures fur des plans
multipliés : c’eft à dire quelques unes fur un
premier plan , & d’autres fuppofées à une plus
grande diftance *, pdûr parvenir à l’ indicatioji de
ces plans dégradés, il n’a d’autre mqyen que de
faire1 les figures qu’ il fuppofe éloignées , d’une
proportion plus petite que celles qu’ il place fur
le premier plan , & de leur donner moins de
relief en raifon de leur diftance. Rien de cela
n’atteint au but qu’ il fe propofe. Ces figures
paroîcront feulement faites fur une échelle plus
petite , mais ellçs feront d’ailleurs aufli voifines
de l’oeil que celles qui fe trouvent placées fur la
ligne de terre ( i ) .
Ce procédé efl non feulement fans fuccès relativement
à l’ intention de' l’artifte ; mais cette
divifion de l’ouvrage en plufieurs petites parties
lui fait immanquablement perdre de la grandeur
de fon effet général,
S’ il eft une partie dans laquelle les modernes
©nt, peut-être , furpaffé les anciens, c’eft la
difpofition qu’ils ont faite quelquefois d’un
limple grouppe en bas-relief, & l’art avec lequel
ils ont donné, par degré, plus de faillie aux
(1 ) Un grand vice des plans multipliés dans les bas-
ie liefs vice qu i fuffit à prouver que cette multiplication
des plans n’ eft pas du reffort de l’art, c’eft que les
premières figures portent des ombres fur des plans prétendus
reculés, auxquels, dans-la naîure , cette ombre
feroit loin de pouvoir atteindre. En p e in tu r e lé s diflfé-
rens .plans reculent par l’imitation de la perfpe&ive aerienne,
par la dégradation des tons, par. la vapeur qui
éteint les objets éloignés : ces reffources ne font pas au
pouvoir du fculpteur. Il repréfente des figures qu’i l prétend
faire fu i r , en dégradant leurs proportions , & qui
ne fuient point par l’effet, puifqu’un bas-relief, quelle
que fo it fa .profondeur rée lle , ne peut fournir qu’une
très-foible dégradation, depuis lés figures les plus- avancées
, jufqn’au plan lç plus reculé. Un artf .ne doit pas
hafarder des menfongès qu’ il ne peut fo’utenir adroitement.
( Nçte du Ré&fieur. )
differentes, figures qui compofent ce grouppe»
en partant du fond uni jufqu’au point où l’ouvrage
devient de demi-boffe. On ne connote
point , je penfe , d’ouvrage ancien , q u i, à cet
égard , puiffeaêtré comparé au talent que le Gtos
a montré dans le bas-relief d’un autel de l’églife
des Jacobins , à Rome. Différens plans , ou degrés
de relief," produifent donc un bon effet
dans le même grouppe ,. 8c c’ eft ce qu’a prouvé
le Gros : mais cet exemple ne prouve rien en
faveur des grouppes féparés , & qui fe trouvent
a quelque diftance les uns des autres, & fe détachent
les uns fur les autres (2).
/ L’idée de ce perfectionnement dans l ’art de
compofer un grouppe en bas-relief a été fug-
gérée , fans douce , par la pratique des peintres
modernes , qui détachent leurs figures ou leurs
groiippes du fond par la même dégradation infen-
lible 8c qui opèrent en tous points d’après les
mêmes principes généraux : mais comme-le marbre
n’a point de dégradation de ton , c’eft l’économie
de l’ouvrage qui offre le feiil moyen d’g
obtenir le clair-obfcur. Les anciens fculpteurs
n’ont pu emprunter cè procédé des peintres de
leur temps , qui femblent, en general, avoiï
ignoré cet arc. On voit dans les bas-reliefs de
Lorenzo Guib.erti, dont nous avons le* plâtres
dans notre académie , que l’artifte n’a pas plus
effayé cette reffource, que ne l’ont fait les peintres
de fon fiècle.
Le fécond perfectionnement imaginaire dont
on a voulu s’occuper, a été de repréfenter dans
les bas-reliefs , les effets de la perfpeCtive. Nous
avons peu de chofe à dire fur ce fujer. On doit
fe rappeler avec combien peu. de fuccès lés
fculpteurs modernes ont cherché à montrer pat
un de leurs angles les fabriques qu’ ils ont introduites
dans leurs bas-reliefs j afin qu’elles panifient
fuir en perfpeélive vers le fond (3). Ces
(2) L e fculpteur q u i , dans un bas-relief, place des
grouppes qu’i l fuppofe être à des enfoncemens différens
les uns des aunes, peut bien les dégrader de proportion
fuivant les loix de la perfpeélive linéale ; mais il ne péut
les dégrader de ton & de couleur, fuivant les loix de
la perlpeÊfcive aerienne. Il eft encore trahi par l’effet des
ombres , puifque fon premier grouppe porte des ombres
fur les grouppes reculés. Tous les ménfonges de la
peinture font au contraire vraifetnblables ,, parce qu’elle
a des moyens d’imiter toutes les apparences de la
nature. ( Note du Rédaéîeur. )
(3) Les auteurs, des bas-reliefs, en montrant les fabriques
par un dé leurs angles , les font fuir par ie.s
lignes qu’ils tra c en t, fans qu’elles fuient par le ton.
» C ’eft tracer de la perfpective, & non en exprimer l’ef-
Ifet ; i l n’y a que le ton qui puiffe le rendre. L ’emploi
des couleurs, ou du* moins d’ une couleur dégradée fuivant
l’effet de la nature , eft abfolument néceffaire à
l’exprelfion de la perfpeélive. On la démontre par des
lignes, on ne peut l’exprimer que par des .tons, & i l
j faut que la perfpeélive aérienne, foie vyiie à laperfpçc-;
{ tive linéale. ( Note du Rédafîeur, )
S C U
effais nous montrent l’ardent defir qu’ont eu ces
artiftes de furmontèr les difficultés ; mais ils
nous prouvent en même temps que le marbre &
la pierre ne fe prêtent pas à féconder leur ambition.
* ’
Les anciens ont montré plus de fagefle ^ en
fe contentant de repréfenter feulement l’élévation
des fabriques qu’ ils introduifoient dans leurs ;
bas-reliefs. Ces fabriques ne font compofées, i
pour ainfi dire , que de lignes horizontales &
perpendiculaires, parce que l ’interruption formée
par des lignes qui fe c-roifent 3 8c tout ce
qui produit une multiplicité de -parties fubor-
données, détruit cette régularité &: cette folidite
d’où dépend, à beaucoup d’égards, la grandiofité
du ftyle.
Nous voici parvenus à la dernière obfervation
qui porte fur la manière dont il faut draper les
ftatues faites en l’honneur des perfonnes mortes
depuis peu , ou encore actuellement vivantes.
Cete queftion J pour être bien difeutée , de-
manderoit feule un long difeours. Je me contenterai
d’obferver ici que celui qui ne' voudra
pas empêcher l’artifte de développer fon talent
avec le plus grand avantage , ne doit pas exiger
qu’ il employé le coftume moderne. La fatisfac-
tion de tranfmettre à la poftérité la forme de
nos vêtemens aCtuels e f t , fans doute , achetée a
trop haut prix , s’ il faut y facrifier ce que l’-art
a de plus précieux. Le travail du marbre demande
un très grand talent, & ce n’eft pas la peine de
fe fervir d’ une matière aufli folide que celle
qu’employe le ftatuaire, pour faire pafier aux
fiècles futurs des modes dont l’ exifter.ee ne s’ étend
prefque jamais au delà d’une année. "
Malgré le jufte defir que peuvent avoir nos
antiquaires de latisfaire aux loix de la juftice
,8c t e la reconnoiflance, en cherchant à procurer
aux amateurs des temps à venir la même fatisfac-
tion de contempler & d’admirer les modes de
nos jours, que celle dont ils jouifient eux
mêmes enétudjant le coftume des anciens; il me
lemble que la pe in tu r e d e genre 8c la gravure
doivent être regardées comme fuffifantes pour
cet objet, fans proftituer le bel art de la fculp-
ture à des intentions fimefquines.
On peut voir en cette v i l le , (L o n d r e s ) une
ftatue équeftre dans le coftume moderne , & il
n’en faut pas davantage pour détourner les ar
tiftes de’femblabiés effais. Ce genre mériteroit
J’être rejette quand on ne pourroit faire contre
lû qu’une objeCtion ; c’eft que nous femmes tellement
habitués avoir les vêtemens modernes ,
d e cette trop grande 'familiarité ne s’accorde
pa; avec la dignité & la gravité de la f c u lp tu r e .
iaf c u lp tu r e eft un arc formalifte, régulier,
auière même, qui dédaigne tous les objets fa-
milWs comme incompatibles avec fa dignité, &
■ quiVe j.e.tte en même temps toute efpèce d’affec-
jatioi & d’apparence de ftyle académique. Ce
SCU 3gp
n’ eft donc qu’avec une grande circonfpection
qu’ il faut employer le contrafte, foit d’une
figure avec une autre, foit des membres d’ une
feule ftatue ifolée, foit des plis d’une draperie-
Enfin tout ce qui tient à là fantaifie ou au capric
e , 8c tout ce qui eft connu fous le nom de
pittorefqtie , quoiqu’admirablepartout ailleurs,
ne peut s’accorder avec la fageffe & la gravité
qui caraCtérifent particulièrement cet art.
Il n’y a rien qui diftingue mieux le goût
fage &raifonné, qu’une correfpondance régulière
, un jufte accord entre les différentes"
parties du deflin,, qui routés- doivent être
unies & enchaînées pour former un enfemble.
Nous pouvons donc prononcer hardiment ,
d’après cette règle générale , que l’uniformité ,
lafimplicité, la monotonie de la matière qu’emploie
le fculpteur, qui eft ordinairement le
marbre blanc , prefcrivenc des limites à fon a r t,
& lui commandent de ne point s’écarter de la
fimplicité de deflin qui y eft convenable. \Ar- ticle extrait de M. Reynolds.)
S E C (adj.), S É CH E R E S S E ( fu b f t . fém.}.
C’eft par les applications que nous faifons des
mots attachés aux propriétés & aux fondions
de nos fer^s, que nous donnons à la plus grande
partie de nos idées intellectuelles une certaine
exiftence , qui les rend plus fenfibles. Les fens
d’ailleurs femblent faire entr’ eux communication,
& communauté de biens, en fe prêtant les
différens mots où les différentes manières de
s’exprimer qui leur font propres.
Ici la vue s’approprie ce qui appartient au
toucher. Un corps peur, être humide ou fe c ;
de ces deux qualités , la Jéchereffe femble en
i général moins amie du ta& , & vraîfemblable-
ment cette différente a conduit aux applications
empruntées de ce mot; elles expriment toutes
un caraCtère blâmable. Un ftyle f e c , une poëfie
féche , un muficien dont le jeu eft f e c , une
compofition muficale dont la tournure e& fêchey
un trait & des contours f e c s , une couleur
fèchey font des défauts dont'l’art d’écrire, la
mufique & la peinture doivent fe préferver avec
foin. Mais d’où provient cette fécherejfe de
manière qui déplaît ? fans doute d’un défaut de
l’ imagination; car le fens de ce mot s’étend
figurément jufqu’à cette faculté purement intellectuelle.
L’ imagination dans les arts préfénre l’ image
d’ un terrem qui produit. Si l’imagination efl
peu féconde, elle .préfénre ce terrein dénué
d’une fertilité qu?on attend d’e l le , comme des
fables arides, comme une terre deitéchée &
cette aridité fe fait femir dans la manière dont
l’image eft rendue, comme elle fe fait voir
dans les fruits qu’ il produit.
L’écrivain dont l’ imagination eft aride ou feche a quelque aüimilation encore avec l ’ayare