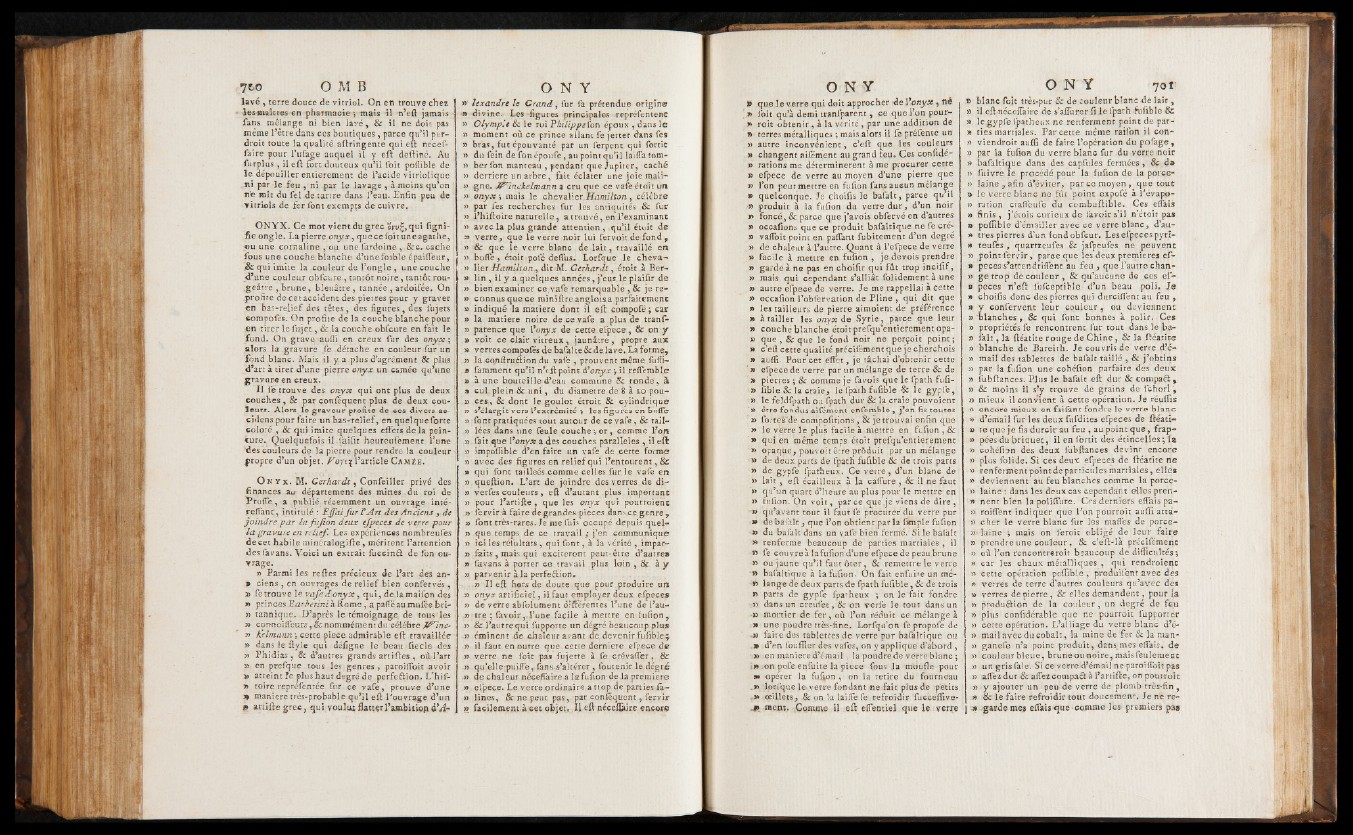
la v é , terre douce de vitriol. On en trouve chez
les maîtres en pharmacie; mais il -n’ eft jamais;
fans mélange ni bien la v é , & il ne doit pâs
meme l’etre dans ces boutiques , parce qu’ il per-
droit toute la qualité aftringente qui eu nécef-
faire pour l’ufage auquel il y eft deftiné. Au
furplus , il eft fort douteux qu’ il foit poflible de
3e dépouiller entièrement de l’acide vitriolique
ni par le feu , ni par le lavage , à moins qu’on J
n’e mît du fel de tartre dans l’ eau. Enfin peu de
vitriols de fer font exempts de cuivre.
O N Y X . Ce mot vient du grec cw£,quî figni-
fte ongle. La pierre onyx, quecefoicuneagathe, !
«u une cornaline , ou une fardoine , & c . cache !
fous une couche blanche d’une foible épaiffeur,
,8c qui imite la couleur de l’ongle , une couche
d’ une couleur obfcure , tantôt noire, tantôtrou-
.geâtre , brune, bleuâtre, tannée, ardoifée. On
..profite de cet accident des,piet res pour y graver
en bas-relief des têtes, des figures, des lu jets
eompofés. On profite de la couche blanche pour
en tirer le fu je t, 8c la couche obfcure en fait le
fond. On grave aufli en creux fur des onyx ;
alors la .gravure je-détache en couleur fur un
fond blanc. Mais il y a plus d’agrément & plus
d’art à tirer d’une pierre onyx un camée qu’ une
gravure en creux.
Il le trouve des onyx qui ont plus de deux
couches , & par confëquent plus de deux couleurs.
Alors, le graveur profite de ces divers ac-
cidenspour faire un bas-relief,'en quelque forte
coloré., & qui imite quelques effets delà pein-
cure..-Quelquefois il f^ific heureufement l’une
des couleurs de la pierre pour rendre la couleur
propre d’un objet. Voyc{ l’ article Camée.
O n y x . M. Gerhardt, Confeiller privé des
finances au' département des mines , du roi de
Pruffe, a publié. récemment un ouvrage int-é-
refiant , intitulé : EJfai fur VArt des Anciens , de
joindre par lafujion deux efpeces de verre pour
la gravure en relief. Les expériences nombreufes
de cet habile minêralogifte, méritent l’attention
des favans. V-oici un extrait fuccinél de ion ouvrage.
» Parmi les reftes précieux de l’art des an- .9 ciens , en ouvrages de relief bien confervés ,
3) Ce trouve le vafe f o n y x , qui, de la maifon des
» princes Barherinià Rome, a pafleau mufée bri-
» tannique. D’après le témoignage de tous les
» connoiffeurs, & nommément du célébré JP^inc-
?> felmiinn \ cette piece admirable eft travaillée
» dans le ftyle qui défïgne le beau fiecle des
» Phidias , & d’autres grands artiftes , où l ’art
» en prefque tous -les genres , paroiffoit avoir
» atteint fe plushaut degré de perfection. L’hif-
7> toire repréfentée fur ce v afe, prouve d’une
3» maniéré très-probable qu’ il eft l'ouvrage d’un
» artifte g re c , qui voulut flatter l’ambitiop
» lexandre îe Grand, fur la prétendue origine
» divine. Les-figures principales repréfentenc
» Olympie & le roi PhilippeCon époux , dans le
» moment où ce prince allant fe jetter dans fes
» bras, fut épouvanté par un ferpent qui fortit
» du fein de fon époufe, au point qu’il laiffa tom-
» ber fon manteau , pendant que Jupiter, caché
» derrière un arbre, fait éclater une joie mali-
» gne. JP'inckelmann a cru que ce vafe étdit un
»• onyx ; mais le chevalier.Hamilton , célèbre
» par fes recherches fur les antiquités 8c fur
» l’hiftoire naturelle, a trouvé, en l’examinant
» avec la plus grande attention , qu’il étuit de
» verre , que le verre noir lui fervoit de fond ,
» & que le verre blanc de la it , travaillé en
» boffe, étoit pôle deffus. Lorfque le cheva-
» lier Hamilton,, Gerhardt, étoit à Ber-
» lin , il y.a quelques années, j’eus.l.e plaiiir de
» bien examiner ce.:vafe remarquable , & je re-
» connus que ce miniftr.eangloi&a parfaitement
» indiqué la matière dont il eft compofé ; car
» la matière noire de ce .vafe a plus de tranf-
» parence que l’ onyx de cette efpece, & on y
» voit ce clair vitreux, jaunâtre, propre aux
» verres eompofés de bafalte&rdelave. La forme,
» la cojiftruélion du vafe , prouvent même fuffi-
» famment qu’ il n’ tft point à’onyx vil reffembl.e
» à une bouteille d’eau commune 8c ronde, à
» cul plein & u n i, du diamètre de 8 à xo pou-
» ces, & dont le goulot étroit & cylindrique
» s’élargit vers l’extrémité •, les figures en bofle
» font pratiquées tout autour de ce vafe, & tail-
» lées dans une feule couche; o r , comme l’on
» fait que P onyx a des couches parallèles , il eft
» impolfible d’ en faire un vafe de cette forme
» avec des figures en relief qui l’ entourent, &
» qui font tailleés.comme celles fur le vale en
» queflion. L’ art de joindre des verres de di-
» verfes couleurs, eft d’autant plus important
» pour l’artifte , que les onyx qui pourraient
» iervirà faire de grandes-pieces dans ce genre,
» font très-rares. Je me fuis occupé depuis quel-
» que temps de ce travail j’en communique
» ici les réi’ultats, qui font, à la vérité, impar-
» faits, mais qui exciteront peut-être d’autre»
» favans à porter ce. travail plus loin , & à y » parvenir à la perfe&ion.
- » Il eft hors de doute que pour produire un
.» onyx artificiel, il faut employer deux efpeces
» de verre abfolument différentes l ’une de l’aù-
-»tre ; lavoir,-Tune facile -à mettre en fufion,
.» & l’autre qui fupporte un dégré beaucoup plus
éminent -,de chaleur avant de devenir fufible5
» il faut en outre que . cette derniere efpece de
» verre ne foit pas fujette à fe crévaffer, &
» qu’eïle puiffe, fans s’aîtérer , foutenir ledég-ré
» de chaleur néceffaire à lafufion de la première
.» . efpece. Le verre ordinaire.a trop de parties: fo-
» lines, & ne peut pas, par confëquent, fervir
» facilement à cet objet, J1 eft néceflàire encore
ü que le verre qui doit approcher de Pcnyst, né
» foit qu’à demi tranfparent, ce que l ’on pour-
» roit obtenir , à la vérité , par une addition de
» terres métalliques ; mais alors il fe préfentc un
» autre inconvénient, c’eft que les couleurs
» changent aifément au grand feu. Ces confidé-
» rations me déterminèrent à me procurer cette
» efpece de verre au moyen d’une pierre que
» l’on peut mettre en fufion fans aucun mélange
» quelconque. Je choifis le bafalt, parce qu’ il
» produit à la fufion du verre dur, d’un noir
» foncé, & parce que j’avois obfervé en d’autres
» occafions que ce produit bafaltique ne fe cré-
» vaffoit point en paffant fubitement d’un degré
» de chaleur à l’ autre. Quant à refpece de verre
» facile à mettre en fufion, je devois prendre
» garde à ne pas en choifir qui fût trop incifif , ■.
» mais qui cependant s’alliât folidement.a une
» autre efpece de verre. Je me rappellai à cette 1
» occafion l’obfervation de P lin e , qui dit que
» les tailleurs de pierre aimoient.de préférence
» à tailler les onyx de S y r ie , parce que leur
» couche blanche étoit prefqu’entierement opa-
» q u e , & que le fond noir ne perçoit point;
» c ’eft cette qualité précifémenc que je cherchois
» aufft. Pour cet effet, je tâchai d’obtenir cette
» efpece de verre par un mélange de terre & de
» pierres ; & comme je favois que le fpath fufi-
» fible & la craie, le fpath fufible 8c le gyple ,
» le feldfpath ou fpath dur & la craie pouvoient
» être fondus aifément enfemble, j’ en fis toutes
» fortés'dè.conipofitions , & je trouvai enfin que
» le verre le plus facile à mettre en fufion , &
» qui en même çernps étoit prefqu’entierement
» opaque, pouvoir être prôduit par un mélange
» de deux parts de fpath fufible & de trois parts
» de gypfe fparheux. Ce v erre, d’un blanc de
» la it , eft écailleux à la caflure , 8c il ne faut
» qu’un quart d’heure au plus pour le mettre'en
» fufion. On vo it, parce que.je viens de dire, i
» qü’avant tout il faut fe procurer du verre pur
» de bafalt, que l’on obtient parla fxnple fufion
» du bafalt dans un vafe bien fermé. Silebalàlt
» renferme beaucoup de parties martiales, il
» Ce couvreà lafufion d’une efpece de peau brune
» offjaune qu’ il faut ôter, & remettre le verre
» bafaltique à lafufion. On fait enfuire un mê-
» lange de deux parts de fpath fufible , & de trois
» parts de gypfe fparheux ; on le fait fondre
» dans un creulet, 8c on verfe le tout dans un
» mortier de fe r , où l’on réduit ce mélange à
» une poudre très-fine. Lorfqu’on fe propofe de
.» faire des tablettes de verre pur bafaltique ou
9 d’en i'ouffler des vafes, on y applique d’abord ,
» en maniéré d’ émail la poudre de verreblanc ;
s» on pofe enfuire la piece fous la moufle pour
» opérer la fufton , on la retire du fourneau
-» lorfque le-verre fondant -ne fait plus de petits,
oeillets} & on la l.aiffe fe refroidir TucGeftive-
ment. .Comme il :eft effentiel que le verre
0 blanc foit très*pur & de couleur blanc de la it ,
» il eft néceffaire de s’affûter fi ie fpath fufible &
» le gypfe fpatheux ne renferment point de par-
» ties martiales. Par cette même raifon il con-
» viendroit aulfi de faire l’opération du pûfage,
» par la fufion du verre blanc fur du verre .noir
» bafaltique dans des capfules fermées, & d»
» fuivre le procédé pour la fufion de la porce-
» la in e , afin d’éviter, par ce moyen, que tout
» le verre blanc ne fût point expofé ù l’évapo-
>3 ration craffeufe du ccmbuftible. Ces effais
» finis , j ’écoîs curieux de lavoir s’il n’étoir pas
» poflible d’émailîer.avec ce verre blanc, d’au-
» très pierres d’un fond obfcur. Les efpeces pyri-
* teufes , quartzeufes 8c jafpeufes ne peuvent
» point fervir, parce que les deux premières eft-
s peces s’artendriffent au feu , que l’autre chan-
» getrop de cou leur , & qu’aucune de ces ef-
» peces n’eft l ’ufceptible d’un beau poli. Je
» choifis donc des pierres qui durciflent au feu ,
» y confervent leur couleur , ou deviennent
» blanches, 8c qui font bonnes à polir. Ces
» propriétés Ce rencontrent fur tout dans le ba-
9 fa it , la ftéatite rouge de Chine , 8c la ftéatiçe
» blanche de Bareith. Je couvris de verre d’é-
» mail des tablettes de bafalt taillé , & j’obtins
» par la fufion une cohéfion parfaite des deux
» fubftances. Elus le bafalt eft dur & compaét,
» 8c moins il s-y trouve de grains de fch o r l,
» mieux il convient à cette opération. Je réuflis
a encore mieux en fai font fondre le verre blanc
« d’émail fur les deux fufditea efpeces de ftéati-
» te que je fis durcir au feu , au point que, frap-
» pées du briquet, il en fortit des étincelles ; la
>3 cohéfion des deux fubftances devint encore
>3 plus folide. Si ces deux efpeces de ftéatite ne
» renfermentpointdeparticules martiales, elles
» deviennent au feu blanches comme la porce-
>3 laine : dans les deux cas cependant elles pren-
» nent bien la poliflure. Crs derniers effais part
roiffent indiquer que l'on pourroit aufii attà-
» cher le verre blanc fur les maffes de porce-
»• laine ; mais on feroit obligé de leur faire
» prendre une couleur, & c’eft-la précifémenc
33 où l’ on rcncontreroit beaucoup de difficultés ;
>3 car les chaux métalliques , qui rendroienc
>3 cette opération poflible , produilent avec des
» verres de terre d’autres couleurs qu’avec des
» verres de pierre , 8c elles demandent, pour la
» produ&ion de la couleur, un degré de feu
>3 plus confidérable que ne pourroit fupporteY
>3 cette opération. L’alliage du verre blanc d’é-
>3 mail avec du cobalt, la mine de fer & la man-
» ganefe n’a point produit, dans.mes effais, de
» couleur b leue, brune ouuôire, mais feulement
.» un gris laie. Si ce verre d’émail ne paroiffoit pas
» aflèz dur & affez compaéb à l’artifte, on pourroit
>3 iy ajouter un peu de verre de plomb très-fin ,
» & le faire refroidir tout doucement. Je ne re-
| » -garde mes effais que comme lés- premiers pas