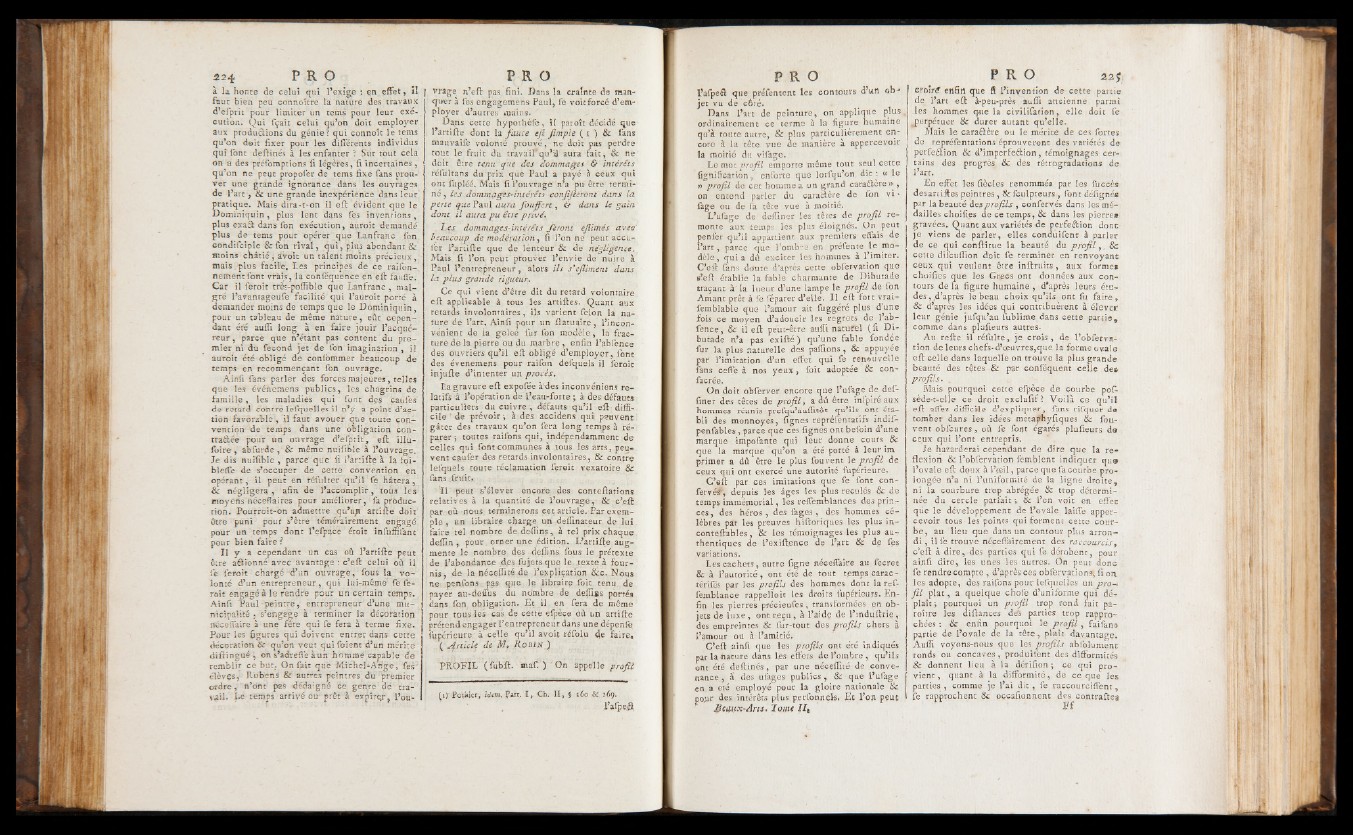
à la honte de celui qui l’ exige : en effet, il
fout bien peu connoître la nature des travaux
d’efprit pour limiter un tems pour leur exécution.
Qui fçait celui qu’on doit employer
aux productions du génie? qui connoît le tems
qu’on doit fixer pour les différents individus
qui l'ont deftinés à les enfanter ? Sur tout cela
on a des‘préfomprions fi légères, fi incertaines,
qu’on ne peut propofer de tems fixe fans prouver
une grande ignorance dans les ouvrages
de l’ a r t , & une grande inexpérience dans leur
pratique. Mais dira-t-on il eft évident que le
Dominiquin, plus lent dans fes invenrions,
plus exad dans fon exécution, auroit demandé
plus de-tems pour opérer que Xanfranc fon,
condifciple & fon r iv al, q ui, plus abondant &
moins châtié, âvoit un talent moins précieux,
mais plus facile. Les principes de çe rai fon-,
nement font vrais, la conlequence en eft fauflé.
Car il feroit très-polfible que Lanfranc, malgré
l ’avantageufe facilité qui l’auroit porté à
demander moins de temps que le Dominiquin,
pour un tableau de même nature, eût cependant
ét‘é aufti long à en faire jouir l’acquéreur,
parce que n’étant pas content du premier
ni du fécond jet de fon imagination , il
auroit été obligé de conlommer beaucoup -de
temps en recommençant fon ouvrage.
Ainfi fans parler des forces majeures, telles
que les événemens publics, les chagrins de
fam ille , les maladies qui font des caillés
de retard contré lefquelles il n’ y a point d’action
favorable, il faut avouer que toute çon^
venciori de temps dans une obligation contractée
pour un ouvrage d’efprit, e ft lllu -
foire , abfurde, & même nuifibîe à l’oüvrage.
Je dis nuifibîe , parce' que fi l’arrifte à la foi-
blelfe de s’occuper de cette convention en
opérant, il peut en réfulter qu’ il fe hâtera,
& négligera, afin de l’accomplir, fous les
moyens néceflaires pour améliorer, fa production.
Pourroit-on admettre qu’un artifte doit
être puni pour s’ être témérairement, engagé,
pour un temps donc l’efpice étoit infuffifant
pour bien faire ?
Il y a cependant un cas où l ’artifte peut
être aétionné avec avantage : c’ eft celui oit il
fè feroit chargé d’un ouvrage, fous la volonté
d’ un entrepreneur , qui lui-même fe feroit
engagé à le rendre pour un certain temps.
Ainfi Paul peintre,* entrepreneur d’une municipalité
, s’engage à terminer la décoration
néceffaire à une fête qui fe fera à terme fixe.
Pour les figures qui doivent entrer dans cette
décoration & qu’on veut qui (bient d’ un mérité
diftingué , on s’adreflê à un homme capable de
remblir ce but, On fait que Michel-Ar?ge, fes*
élèves, Rubens & autres peintres d u ’premier
ordre, n’ont pas dédaigné Ce genre’ dé travail.
Le temps arrivé ou- prêt à expirqr l*ouj
vrage n’eft pas fini. Dans la crainte de manquer
à fes engagemens Paul, fe voie forcé d’employer
d’autres mains.
Dans cette hypotfièfe, il paraît décidé que
> l’artifte dont la faute ejî fimple ( i ) & fans
mauvaife volonté prouvé, ne doit pas perdre
tout le fruit du trava'ifqu’ü aura fait, & ne
doit être tenu que des dommages & intérêts
réfui tan s du prix que Paul a payé à ceux qui
ont fupléé. Mais fi l’ouvrage n’a pu être termin
e , les dommages-intérêts confieront dans la
perte que Paul aura fouffert, & dans le gain
dont il aura pu être privé.
Les dommages-intérêts Seront ejlimés avec
beaucoup de modération, fi l’on ne peut acculer
l’artifte que de lenteur & de négligence.
Mais fi l’on peut prouver l’ envie de nuire à
Paul l’entrepreneur, alors ils s ’efiiment dans
la plus grande rigueur.
Ce qui vient d’être dit du retard volontaire
eft applicable à tous les artiftes. Quant aux
retards involontaires, ils varient félon la nature
de l’art. Ainfi pour un ftatuairé, l’inconvénient
de ia geleé fur fon modèle, là fracture
de la pierre ou du marbre , enfin i’abfence
des ouvriers qu’il eft obligé d’employçr, lont
des évenemens pour raifon defquels i\ feroit
injufte d’ intenter un procès.
La gravure eft expofée à'des inconvéniens relatifs
à l’opération de l’eau-forte ; à des défauts
particuliers du cuivre', défauts q.u’il eft.-difficile
1 de prévoir; à des accidens qui peuvent
gâter des travaux qu’on fera long temps à réparer
; toutes raifons qui, indépendamment de
celles qui font communes à tous les arts, peuvent
caufer des retards involontaires, & contre
lefquels toute réclamation feroit vexatoire &
fans ; fruit,, .
I l peut s’élever encore des conteftations
relatives à la quantité de l ’ouvrage, & c’eft:
par où nous, terminerons cet article. Par exemple
, un libraire charge un deflinateur. de lui
faire tel nombre de.defiinç, à tel prix chaque
deflin , pour. orner une édition. L’artifte augmente
le nombre des défit ns, fous le prétexte
de l ’abondance dps .fu jets que le .texte à fournis
, de la néeefiTité.^de. l’explication &c. Nous
ne penfons pgs que le libraire .foit. tenu de
: payer au-deffus du nombre de deflijs portés
dans.fo.n. obligation. Et il en fera de même
pour tpus les cas de cettè efpèce où un artifte
prétend engager l’entrepreneur dans une dépenfo
fupérieure - à celle qu’ il avoit réfolu 4e faire,
( Article de M. R obin )
PROFIL (fubft. maf ) On appelle profil
(i)'Pothier, idem. Paît. I, Cfa. II, § 160 & 169.
l ’afpe#
l ’afpeét que préfentent les contours d’ un objet
vu de côté.
Dans l’art de peinture, on applique plus
ordinairement ce terme à la figure humaine
qu’à toute autre, & plus particulièrement encore
à la tête vue de manière à appercevoir
la moitié du vifage. ;
Le moi profil emporte même tout seul cette
lignification, enforte que lorfqu’on dit : « le
» profil de cet homme a un grand cara&ere» ,
on entend parler du caractère de Ion vi *
fage ou de fa tête vue à moitié.
L’ ufage de defliner les têtes de profil remonte
aux temps les plus éloignés. On .peut,
penfer qu’ il appartient aux premiers eifais de
l’a r t, parce que l’ombre en prélente le modèle,
q u ia dû exciter les hommes à l’ imiter.
C’eft fans doute d'après cette obfer-vation que1
s’eft établie la fable charmante de Dibutade
traçant à 'la lueur d’ une lampe le profil de fon
Amant prêt à fe féparer d’elle. I l eft fort vrai-
fembiable que l’amour ait fuggéré plus d’une
fois ce moyen d’adoucir les regrets de 1 ab-
lence, & il eft peut-être aufli naturel (fi D ibutade
n’ a pas ex ifté) qu’une fable fondée
fur la plus naturelle des pallions, & appuyée
par l’imitation d’ un effet qui fe renouvelle
fans ceffe à nos y e u x , foit adoptée & con-
facrée.
On doit obferver encore que l’ ufage de def-
finer des têtes de profil, a dû être inipiré aux
hommes réunis prefqu’aufiitôt qu’ ils ont établi
des monnoyes, lignes repréfentatifs indif-
penfables, parce que ces lignes ontbefoin d’une
marque impofante qui leur donne cours &
que la marque qu’on a été porté à leur im
primer a dû être le plus fouvent le profil de
ceux qui ont exercé une autorité fupérieure.
C ’eft par ces imitations que fe font çon-
ferré#, depuis les âges les plus reculés & de
temps immémorial, les reffemblances des prinr
ces, des héros , des fages , des hommes célèbres
par les preuves hiftoriques les plus in-
conteftables, & les témoignages les plus authentiques
de l ’exiftence de l’art & de fes
variations.
Les cachets, autre figne néceffaire au fecret
& à l’autorité, ont été de tout t.emps carac-
térifés par les profils des hommes donc la ref-
femblance rappelloit les droits fupérieurs. Enfin
les pierres précieufes, transformées en objets
de lu x e , ont reçu, à l’aide de l’ induftrie,
des empreintes & fu,r-tQut des profils chers à
l ’amour ou à l’amitié.
C’eft ainfi que les profils ont été indiqués
par la nature dans les effets de l’ombre , qu’ ils
ont été deftinés, par une nécçflité de convenance,
a des ufages publics, & que l’ ufage
en a été employé pour la gloire nationale &
pmir des intérêts plus perfonnels. Et l’on peut
fi eaux-Arts. Tome IIt
croira enfin que fî l’ inyention de cette partie
de ’art eft à-peu-près aufli ancienne parmi
, .les hommes que la civilifarion, elle doit fe
perpétuer & durer autant qu’elle.
Mais le caraâère ou le mérite de ces fortes
1 de repréfentations éprouveront des variétés de
perfection & d’ imperfeélion, témoignages certains
des progrès & des rétrogradations de
l’art.
En effet les fiècles renomme» par les fuccès
des artiftes peintres, & fculpteurs, font défignéc
par la beauté des profils , confervés dans les médailles
choifies de ce temps, & dans les pierre*
gravées. Quant aux variétés de perfection donc
je viens de parler, elles conduifent à parler
de ce qui conftitue la beauté du p ro fil,, &
cette diîcuflion doit fe terminer en renvoyant
ceux qui veulent être inftruits, aux formes
choifies que les Gnecs ont données aux contours
de la figure humaine , d’ après leurs études,,
d’après le beau choix qu’ils ont fu faire,
& d’apres les idées qui contribuèrent à élevée
leur génie jufqu’au lùblime dans cette partie,
comme dans plufieurs autres.
Au refte il réfulte, je crois, de l’obferva-
tion de leurs chefs-d’oguvres,que la forme ovale
eft celle dans laquelle on trouve la plus grande
beauté des tçtes & par conféquent celle des
profils. .
Mais pourquoi cette efpèce de courbe pof-
sède-t-elle çe droit, exclufif? Voilà ce qu’ il
eft affez difficile d’expliquer, fans rifquer de
tomber dans les idées métaphyfiques & lou-
vent obfcures, où fe font égarés plufieurs de
ceux qui l’ont entrepris.
Je hazarderai cependant de dire que la reflexion
& l ’obiervarion femblent indiquer qu®
l’ovale eft doux à l’oeil, parce que fa courbe prolongée
n’ a ni l’uniformité de la ligne droite,
ni la courbure trop abrégée & trop déterminée
du cercle parfait ; & l’on voit en effet
qiie le développement de l’ovale laiffe appercevoir
tous les points qui forment cette courbe
, au lieu que dans un contour plus arrondi
, il fe trouve néceffairement des raccourcis,
c’eft à dire, 4 es parties qui fe dérobent, pour
ainfi dire, les unes les autres. On peut donc
fe rendre compte , d’ après ces obfervations1; fi on
les adopte, des raifons pour lefquelles un pro-i
f i l p la t, a quelque chofe d’uniforme qui dé»
plaît ; pourquoi un profil trop rond fait paraître
les diftances de’s parties trop rapprochées
: & enfin pourquoi le p ro f il, faifano
partie de l’ovale de la tê te , plaît davantage.
Aufli voyons-nous que les profils abihlument
ronds ou concaves, produilènt des difformités
& donnent lieu à la dérifion ; ce qui prov
ien t, quant à la difformité, de ce que les
parties , comme je l’ ai d i t , fe raccourciffent,
fe rapprochent & oçcafionnent des contraftç§