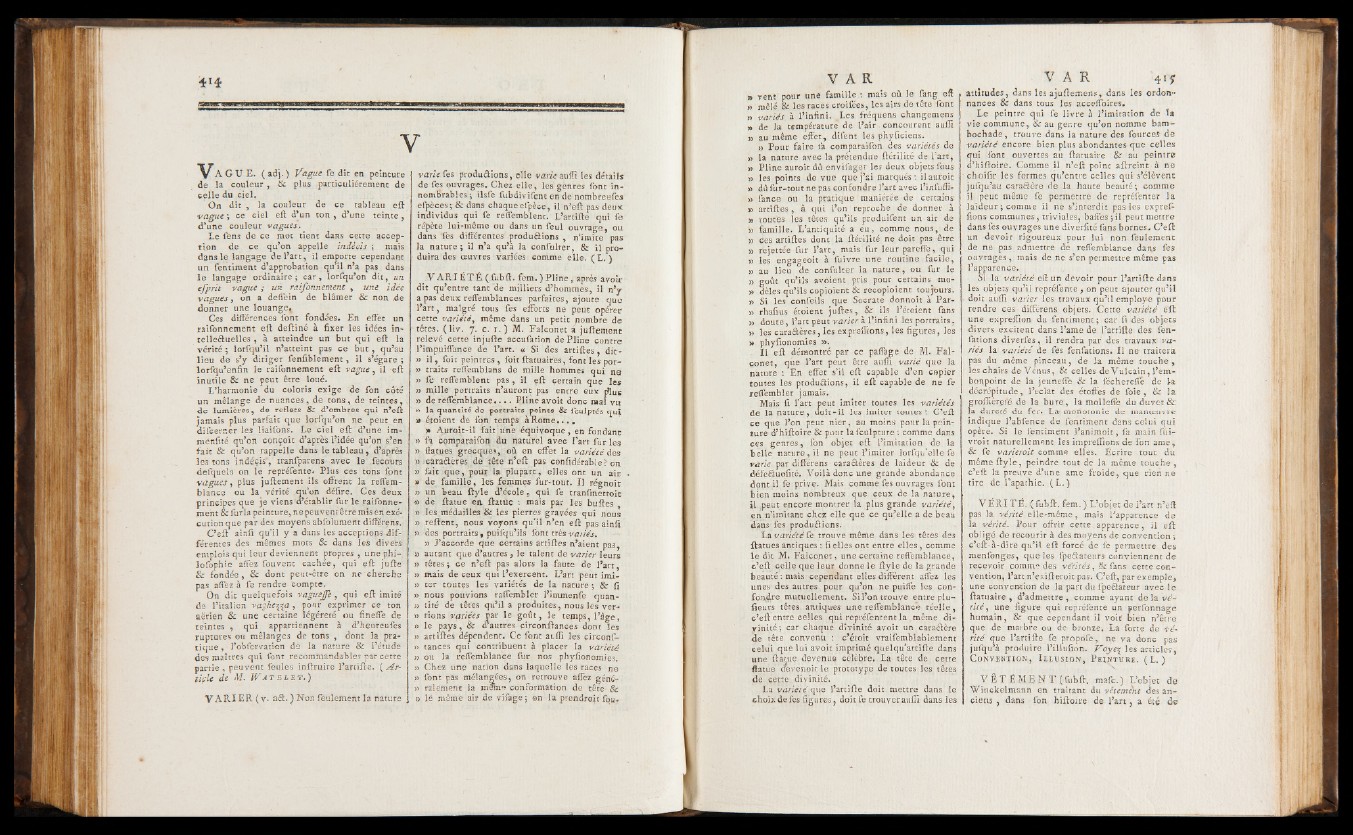
Y
* V A G U E. ( adj. ) Vague fe dit en peinture
de la couleur , & plus particuliérement de
celle du ciel.
On dit , la couleur de ce tableau eft
•vague ; ce ciel eft d’ un ton , d’une te in te ,
d’une couleur vagues.
Le fens de ce mot tient dans cettç acception
de ce qu’on appelle iudèçis \ mais
dans le langage de l’art, il emporte cependant
un fentiment d’approbation qu’il n’ a pas dans
le langage ordinaire; c a r , lorfqu’on d it, un
efprit vague ; un raifonnement , une idée
vagues, on a deflein de blâmer & non de
donner une louange..
Ces différences font fondées. En effet un
raifonnement eft deftiné à fixer les idées in-
telle&uelles , à atteindre un but qui eft la
vérité ; lorfqu’ il n’atteint pas ce b u t , qu’au
lieu de s’y diriger fenfiblement, il s’égare ;
lorfqu’enfin le raifonnement eft vague, il eft
inutile & ne peut être loué.
L ’harmonie du coloris exige de fon côté
un mélange de nuances, de tons, de te in te s ,.
de lumières, de reflets & d’ombres qui n’eft
jamais plus parfait que lorfqu’on ne peut en
difcerr.er les liaifons. Le ciel eft d’ une im-
ménfité qu’on conçoit d’après l ’ idée qu’on s’ en
fait & qu’on rappelle dans le tableau, d’après
lestons indéçis', tranfparens avec leTecours
defqueîs on le repréfente* Plus ces tons font
vagues, plus juftement ils offrent la reflem-
blance ou la vérité qu’on délire. Ces deux
principes que je viens d ’établir fur le raifonne-
ment & fur la peinture, ne peu vent être mis en exécution
que par des moyens abfolument différens.,
C’ eft ainfi qu’il y a dans les acceptions différentes
des mêmes mots & dans les divers
emplois qui leur deviennent propres , une phi-
lofophie affez fouvent cachée, qui eft jufte
& fondée, & dont peut-être on ne cherche
pas affez à fe rendre 'compte,
On dit quelquefois vaguejjh , qui eft imité
de l’ italien va°he\\a, pour exprimer ce ton
aerien & une certaine légéreté ou fineffe de
teintes , qui appartiennent à d’heureufes
ruptures ou mélanges de tons , dont la prat
iq u e , l’obfervation de la nature & l ’ étude
des maîtres qui font recommandables par cette
partie, peuvent feules infrruire l’artifte. ( Ar-:
tiçle de M. Wa t e l e t . )
| varie fes produ&ions, ©lie varie aufli les détails
de fes ouvrages. Chez e lle , les genres font innombrables1;
ilsfe fubdivifent en de nombreufes
efpèces; & dans chaqueefpèce, il n’eft pas deux
individus qui fe reffemblent. L’artifte qui fe
répète lui-même ou dans un feul ouvrage, ou
dans Tes différentes produ&ions , n’imite pas
la nature; il n’ a qu’a la confulter, & il produira
des oeuvres variées comme elle. (L . )
V A R IÉ T É (T u b f t . fem .) Pli ne j| après avoir
dit qu’entre tant d e milliers d’hommes, il n’y
a pas deux reffemblances parfaites, ajoute que
l’art, malgré tous fes efforts ne peut opérer
cette variété, même dans un petit nombre de
têtes, ( l iv . 7. c. 1 . ) M. Falconet â juftement
relevé cette injufte accufation de Pline contre
l’impuiffance de l’art. « Si des artiftes, dit -
» i l , foit peintres, foit ftatuaires, font les por-
» traits reffemblans de mille hommes qui ne
» fe reffemblent pas, il ■ çft certain que les
» mille portraits n’auront pas entre eux fftus
» de reffemblance.. . . Pline avoit donc mal vu
» la quantité de portraits peints & fculptés qui
» éfoient de fon temps àR om e ....
* Auroit-il fait ’une équivoque, en fondant
» fa comparaifon du naturel avec l’art fur les
» ffatues grecques, où en effet la variété des
» cara&ères dé tête n’ eft pas confidérable? on
» fait que, pour la plupart, elles ont un air
» de famille, les femmes fur-tout. I l régnoit
» un beau ftyle d’ école« qiii fe tranfmettoit
» de ftatue en ftatüe : mais par les buftes ,
» les médailles & les pierres gravées qui nous
» reftent, nous voyons qu’il n’en eft pas ainfi
» des portraits, puifqu’ ils font très variés,
» J’accorde que certains artiftes n’aient pas
» autant que d’autres , le talent de varier leurs
» têtes ; ce n’eft pas alors la faute de l’art
» mais de ceux qui l’exercent. L’art peut imi-
» ter toutes les variétés de la nature ; & fi
», nous pouvions raffembler l’immenfe quan-
» tiré de têtes qu’ il a produites, nous les ver*
» rions variées par le g oû t, le temps, l ’âge ,
» le pays, èc d'autres pirconftances dont les
» artiftes dépendent. Ce font aLlîi les çirconf-
» tances qui contribuent à placer la variété
» pu la reffemblance fur nos phyfionomies.
» Chez une nation dans laquelle lès races ne
.» font pas mélangées, on retrouve affez géné-
» râlement la m in s conformation de tête &
» lé même air de V A R I E R ( v* a&. ) Non feulement la nature vifage ; on la prendront fou.
» vent pour une famille : mais où le fang eft
» mêlé & les races croifées, les airs de tête font
» variés à l’ infini. Les fréquens changemens
» de la température dè l’air concourent aufli
» au même effet, difent les phyficiens.
» Pour faire fa comparaifon des variétés de
» la nature avec la prétendue ftérilité de l ’art,
» Pline auroit dû envifager les deux objets fous
» les points de vue que j’ai marqués : il auroit
» dû fur-tout ne pas confondre l’art avec l’infuffi-
» fance ou la pratique maniérée de certains
» artiftes , à qui l’on reproche de donner à
» toutes les têtes qu’ ils produifent un air de
i) famille. L’antiquité a eu, comme nous, de
» Ces artiftes dont la ftérilité ne doit pas être
» r'ejettée fur l’art, mais fur leur pareffe, qui
» les engageôit à lu ivre une routine-facile,
» au lieu de confulter la nature, ou fur le
» goût qu’ ils avdient pris pour certain s^ mo-
» dèles qu’ ils copioient & recopioient toujours.
» Si les confeils que Socrate donnoit à Par-
» rhafius étoient juftes, & ils l’étoient fans
» doute, l’art peut varier à l’ infini les portraits.
» les cara&ères, les expreffions, les figures, les
» phyfionomies ».
. I l eft démontré par ce paffage de M. Fal-
çonet, que l ’ art peut être aufli varié que la
nature : En effet s’ il eft capable d’en copier
toutes les produ&ions, il eft capable de ne fe
reffembler jamais.
Mais fi fart peut imiter toutes I es variétés
de la nature, d oit-il les imiter toutes? C’eft
ce que l’on peut nier, au moins pour la peinture
d’ hiftoire &pour lafculpture : comme dans
ces genres, fon objet eft l ’imitation de la
belle nature, il ne peut l’ imiter lorfqu’elle fe
varie par différens cara&ères de laideur & de
défe&uofité. Voilà donc une grande abondance
dont il fe prive. Mais comme fes ouvrages font
bien moins nombreux que ceux de la nature,
il jpeut encore montrer la plus grande va riété,
en n’imitant chez elle que ce qu’ elle a de beau
dans fes produ&ions.
La variété fe trouve même dans les têtes des
ftatues antiques : fi elles ont entre elles, comme
le dit M. Falco.net, une certaine reffemblance,
c’eft celle que leur donne le ftyle de la grande
beauté : mais cependant elles diffèrent affez les
unes des autres pour qu’on ne puifle les con-
fofj^re mutuellement. Siï’on trouve entre plusieurs
têtes, antiques une reffemblance réelle ,
c’eft entre celles qui repréfentent la même divinité',
car chaque divinité avoit un cara&ère
de tête convenu : c’étoit vraifemblabiement
celui que lui avoit imprimé quelqu’artifte dans
une ftatue devenue célèbre. La tête de cette
ffatue devenoit le prototype de toutes les têtes
de cette divinité..
La variété .-que l’artifte doit mettre dans le
choix de fes figures, doit fe trouver aufli dans les
attitudes, dans les ajuftemens, dans les ordonnances
& dans tous les acceflbires.
Le peintre qui fe livre à l’ imitation de îa
vie commune, 8c au genre qu’on nomme bam-
bochade, trouve dans la nature des fourceS de
variété encore bien plus abondantes que celles
qui l’ont ouvertes au ftaruaire & au peintre
d’ hiftoire. Comme il n’eft point aftreint à ne
çhoifir les formes qu’entre celles qui s’élèvent
jufqu’au cara&ère de la haute beauté; comme
il peut même fe permettre de repréfenter la
laideur ; comme il ne s’interdit pas les expreX-
fions communes, triviales, baffes ; il peut mettre
dans fes ouvrages une diverfité fans bornes. C ’eft
un devoir rigoureux pour lui non.feulement
de ne pas admettre de reffemblance dan.s fes
ouvrages, mais de ne s’ en permettre même pas
l ’apparence.
Si la variété eff un devoir pour l’artifte dans
les objets qu’il repréfente, on peut ajouter qu’ il
doit aufli varier les travaux qu’ il employé pour
rendre ces-différens objers. Cette variété eft
une exprefiion du fentiment; car fi des objets
divers excitent dans l’ame de l’artifte des fen-
fations diverfes, il rendra par des travaux va~
ries la variété de fes fenfations. Il ne traitera
pas du même pinceau, de la même touch e,
les chairs de Vénus, & celles de Vulcain, l’embonpoint
de la jeuneffe & la féchereffe de la
décrépitude, l’eclat des étoffes de fo ie , & la
groffièrgte de la bure, la molleffe du duvet &
la dureté du fer. La- monotonie de manoeuvre
indique l’abfence de fentiment dans celui qui
opère. Si le fentiment l’anîmoit, fa main füi-
vroit naturellement les impreflions de fon ame,
& fe varieroit comme elles. Ecrire tout du
même fty le , peindre tout de la même touche,
c’eft la preuve d’ une ame froide, que rien ne
tire de l ’apathie* .( L. )
V É R IT É , (fubft. fem. ) L’objet de l’ art n’ eft
pas la vérité elle -même, mais l ’apparence de
la vérité. Pour offrir cette apparence, il eft
obligé de recourir à des moyens de convention ;
c’ eft-à-dire qu’ il eft forcé de fe permettre des
menfonges, que les fpe&ateurs conviennent de
recevoir comme des vérités, & fans cette convention,
l’art n’exifteroit pas. C’eft, par exemple,
une convention de la'part du fpe&ateur avec le
ftatuaire , d’admettre , comme ayant de la vérité,
une figure qui repréfente un perfonnage
humain, & que cependant il voit bien n’ être
que de marbre ou de bronzei La forte de mérité
que l’artifte fe propofe, ne va donc pas
jufqu’ à produire l ’illufion. Voye\ les article?,
C o n v en t io n , I l l u s io n , P e in tu r e . ( L. )
V E T Ê M E N T ( fubft. mafe.) L’objet de
Winckelmann en traitant du vêtemekt des anciens
, dans fon hiftoire de l’a r t , a été de