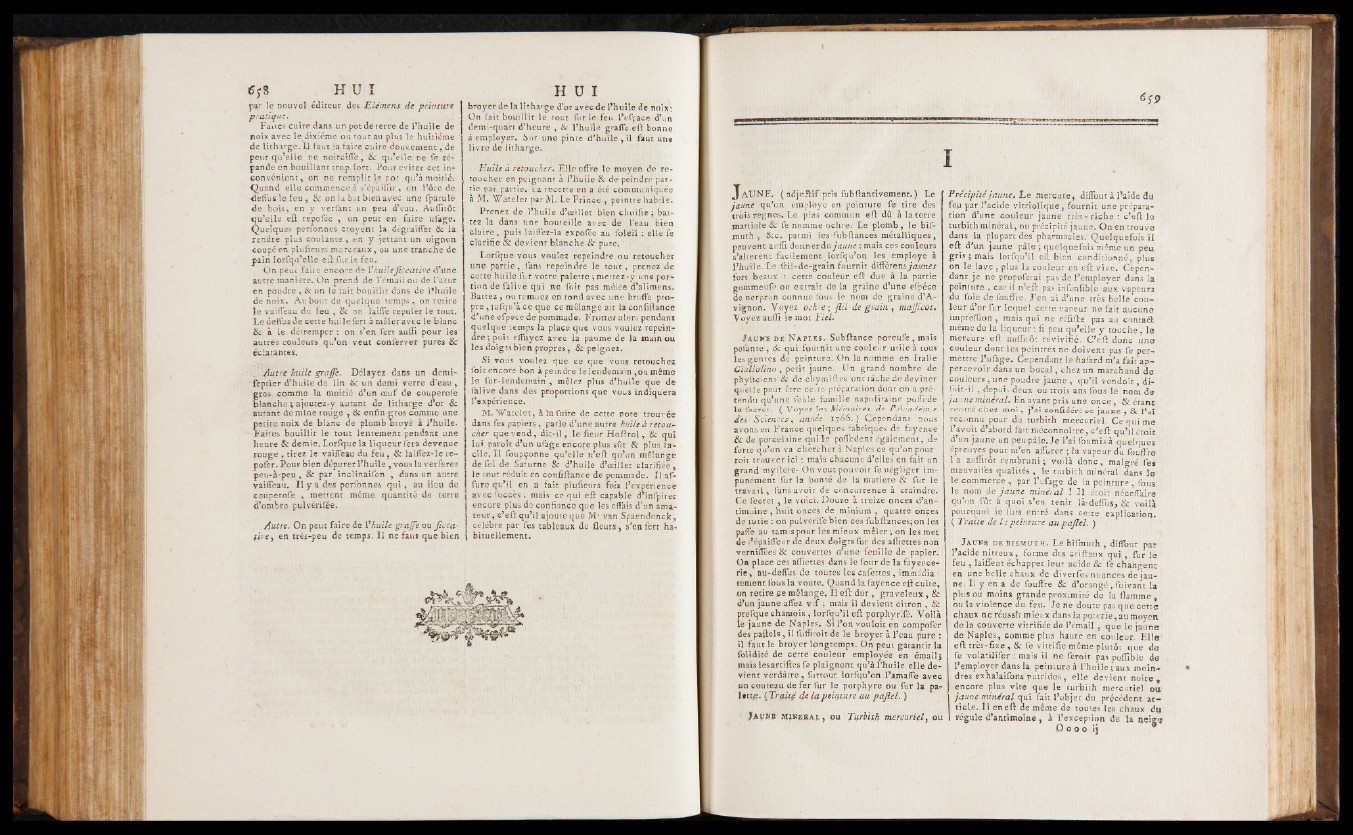
HUI
par le nouvel éditeur des Elémens de peinture
pratique.
Faites cuire dans un pot de terre de l’huile de
noix avec le dixiéme ou tout au plus le huitième ;
de litharge. XI faut .la faire cuire doucement, de
peur qu’elle ne noireiffe, & qu’ elle ne fe répande
en bouillant trop fort. Pour éviter cet inconvénient,
on ne remplit le pot qu’à moitié.
Quand elle commence à s’épaiffir, on l’ôte de
d e flu s le feu , & on U bat bien avec une fpatule
de bois, en y verfant un peu d’eau. Auffitôt
qu’elle eft repofée , on peut en faire ul’age.
Quelques peribnnes croyent la dégraiffer 8c la
rendre plus coulante, en y jettant un oignon
coupé en plufieurs morceaux, ou une tranche de
pain îorfqu’ elle èit fur le feu.
On peut faire encore de l ’ huileficcative d’une
autre maniéré. On prend de Peinai} ou de l’azur
en poudre , & on le la it bouillir dans de l ’huile
de noix. Au bout de quelque temps , on retire
le vaifTeau du feu , & on laiffe repofer le tout.
Le deffus de cette huile fert à mêler avec le blanc
& à le détremper : on s’en fert aulli pour les
autres couleurs qu’on veut conferver pures &
éclatantes.
Autre huile grajfe. Délayez dans un demi-
feptier d’huile de lin 8c un demi verre d’eau ,
groSv comme la moitié d’un oeuf de couperofe
blanche ; ajoutez-y autant de litharge d’or &
autant-de mine rouge , & enfin gros comme une
petite noix de blanc de plomb broyé à l’huile.
Faites bouillir le tout lentement pendant une
heure & demie. Lorfque la liqueur fera devenue
rouge , tirez le vaifleau du fe u , & laiffez-îe repofer.
Pour bien dépurer l’ huile , vous la verferez
peu-à-peu, & par inclinaifon , dans un autre
vaifTeau. I l y a des perfonnes q u i , au lieu de
couperofe , mettent même quantité de terre
d’ombre pulvérifée.
Autre. On peut faire de l'huile grajfe ou ficcative
y en très-peu de temps. I l ne faut que bien
H U I
broyer de la litharge d’or avec de l’ huile de noix*.
On fait bouillir le tout fur le feu l’ efpace d’ un
demi-quart d’ heure , & l’huile grafle-eft bonne
à employer. Sur une pinte d’huile, il faut une
livre de litharge.
Huile à retoucher. Elle offre le moyen de retoucher
en peignant à l’ huile & de peindre partie
par partie, la recette en a été communiquée
à M. Watelec par M. Le Prince , peintre habile.
Prenez de l’ huile d’oeillet bien choifïe ; battez
la dans une bouteille avec de l’eau bien
claire, puis laiflez-la expofée au loleil : elle fe
clarifie & devient blanche & pure.
Lorlque vous voulez repeindre ou retoucher
une partie, fans repeindre le tout, prenez de
cette huile fur votre palette ; mectez-y une portion
de falive qui ne loir pas mêlée d’alimens.
Battez , ou remuez en rond avec une broffe propre
, lufqu’à ce que ce mélange ait la confiflance
d’ une efnece de pommade. Frottez alors pendant
quelque temps la place que vous voulez repeindre,
puis efïuyez avec la paume de la main ou
les doigts bien propres, & peignez.
Si vous voulez que ce que vous retouchez
foit encore bon à peindre le lendemain , ou même
le fur-lendemain , mêlez plus d’huile que de
falive dans des proportions que vous indiquera
l’expérience.
M. Watelet, à la fuite de cette note trouvée
dans fes papiers, parle d’une autre huile à retoucher
que vend, dit- il, le fieur H oflro l, & qui
lui paroît d’ un ufage encore plus sûr & plus facile.
Il foupçonne qu’elle n’ eft qu’un mélangé
de fel de Saturne & d’huile d’oeillet clarifiée,
le tout réduit en confiflance de pommade. Il af-
fure qu’ il en a fait plufieurs fois l’expérience
avec luccès ; mais ce qui eft capable d’ infpirer
encore plus de confiance que les eflais d’un amateur,
c’eft qu’ il ajoute que M* van Spaendonck,
célébré par fes tableaux de fleurs, s’en fert habituellement.
4ÉIÉlilpé
a
6$ 9
I
JA U N E , (ad je ftif pris fubftantivement.) Le
jaune qu’on employé en peinture fe tire des
trois régnés. Le pins commun eft dû à la terre
martiale & fe nomme ochre. Le plomb, le bif- ,
muth , & c . parmi les fubftances métalliques,
peuvent aufii donner du jaune: mais ces couleurs
s’altèrent facilement lorfqu’on les employé à
l ’huile. Le ftil-de-grain fournit diffèrens^z/mej-
fort beaux : cette couleur eft due à la partie
gommeufe ou extrait de la graine d’ une efbéce
de nerprun connue fous le nom de graine d’Avignon.
Voyez ochre; fiil-de grain , majficot.
Voyez aufii le mot Fiel.
Jaunie de Naples. Subftance poreufe,mais
pelante , 8e qui fournit une couleur utile à tous
les genres de peinture. On la nomme en Italie
Ciallolino , petit jaune. Un grand nombre de
phyliciens & de çhymifles ont tâché de deviner
quelle peut être ce.te préparation dont on a prétendu
qu’ une feule famille napolitaine poiïede
le fecret. ( Voyez les Mémoires de. VAcadém.e
des Sciences, année 1766.) Cependant nous
avons en France quelques fabriques de fayence
8c de porcelaine qui le pofTedent également, de
forte qu’on va chercher à Naples ce qu’on pour
roit trouver ici : mais chacune d’ elles çn fait un
grand myftere- On veut pouvoir fe négliger impunément
fur la bonté de la matière & fur le
trav a il, fans avoir de concurrence à craindre.
Ce fècret, le voici. Douze à treize onces d’an-
tinu.ûne , huit onces de minium, quatre onces
de tutie : on pulvérile bien ces fubftances;on les
paffe au tamis pour les mieux mêler ; on les met
4e i’ép'aiffeur de deux doigts fur des affiettes non
verniflees 8c couvertes d’ une feuille de papier.
Oa place ces affiettes dans le four de la fayence-
rie, au-deffus de toutes les cafettes , immedia
tement fous la voûte. Quand la fayence eft cuite,
on retire çe mélange. Il eft dur , graveleux , 8c
d’un jaune iftfez v i f -, mais il devient citron , &
prefque chamois , lorfqu’ il eft porphyr'.fé. Voilà
le jaune de Naples, Si l’on vouloit en compofer
des paftels, il fuffiroit de le broyer à l’eau pure :
il faut le broyer longtemps. On peut gatantirla
folidité de cette couleur employée en émailj
piais lesartifies fe plaignent qu’àrh uile elle devient
verdâtre, furtout lorfqu’on l’amafle avec,
un couteau de fer fur le porphyre ou fur la par
îtttp. ( Tryitç 4e l<lpeinture au pafiel. )
Précipité jaune. L e mercure, diffout à l’aide du
fevu par l ’acide vitriolique, fournit une préparation
d’une couleur jaune très-riche : c’eft le
turbithminéral, ou précipité jaune. On en trouve
dans la plupart des pharmacies. Quelquefois il
eft d’ un jaune pâle ; quelquefois même un peu
gris ; mais lorfqu’ il eft bien conditionné, plus
on le ja v e , plus la couleur en eft vive. Cepèn-
dant je ne propoferai pas de l’ employer dans la
peinture , car il n’eft pas infenfible aux vapeurs
du foie de fouflre. J’en ai d’une très-belle couleur
d’or fur lequel cette vapeur ne fait aucune
impreffion , mais qui ne réfifte pas au contaét
même de la liqueur : fi peu qu’elle y touche , le
mercure eft auffitôt revivifié. C’eft donc une
couleur dont les peintres ne doivent pas fe permettre
l’ ufage. Cependant le hafard m'a fait ap-
percevoir dans un bocal, chez un marchand de
couleurs, une poudre jaune , qu’ il vendoit, di-
loit-il , depuis deux ou trois ans fous le nom de
janne minéral. En ayant pris une once , & étant
rentré chez moi, j’ ai confidéréce jaune, & l’ai
reconnu pour du turbith mercuriel. Ce oui me
l’avoit d’abord fait méconnoître, c’eft qu’il étoic
d’ un jaune un peu pâle. Je l’ai fournis à quelques
épreuves pour m’en afturer ; la vapeur du fouffre
Ta auffitôt rembruni ; voilà donc, malgré fes
mauvaifes qualités , le turbith minéral dans le
le commerce , par l’ufage de la peinture , fous
le nom de jaune minéral ! I l croit néceffaire
qu’on fût à quoi s’ en tenir là-deffus, & voilà
pourquoi je fuis entré dans cette explication.
( Traité de ls peinture au pafiel. )
Jaune de bismuth. Le bifmuth , diflbut par
l’ acide nitreux, forme des çriftaux qui , fur le
feu , laiffent échapper leur acide & fe changent
en une belle chaux de diverfes nuances de jaune.
U y en a de fouflre & d’orangé, fui van t la
plus ou moins grande proximité de la flamme,
ou la violence du feu. Je ne doute pas que cette
chaux ne réussît mieux dans la poterie, au moyen,
delà couverte vitrifiée de l’émail , que le jaune
de Naples, comme plus haute en couleur. Elle
eft très-fixe , & fe vitrifie même plutôt que de
fe volatilifer : mais il ne feroit pas poffiblc de
l’employer dans la peinture à l’huile; aux moindres
exhalaifons putrides, elle devient noire %
encore plus vite que le turbith mercuriel on
jaune minéral qui fait l’objet du précédent, article.
Il en eft de même de toutes les chaux dt*
: régule d’antimoine, à l’exception de la neigç
O o 0 o ij
J A V W P minera;,, p u Turbith mercuriel, o u