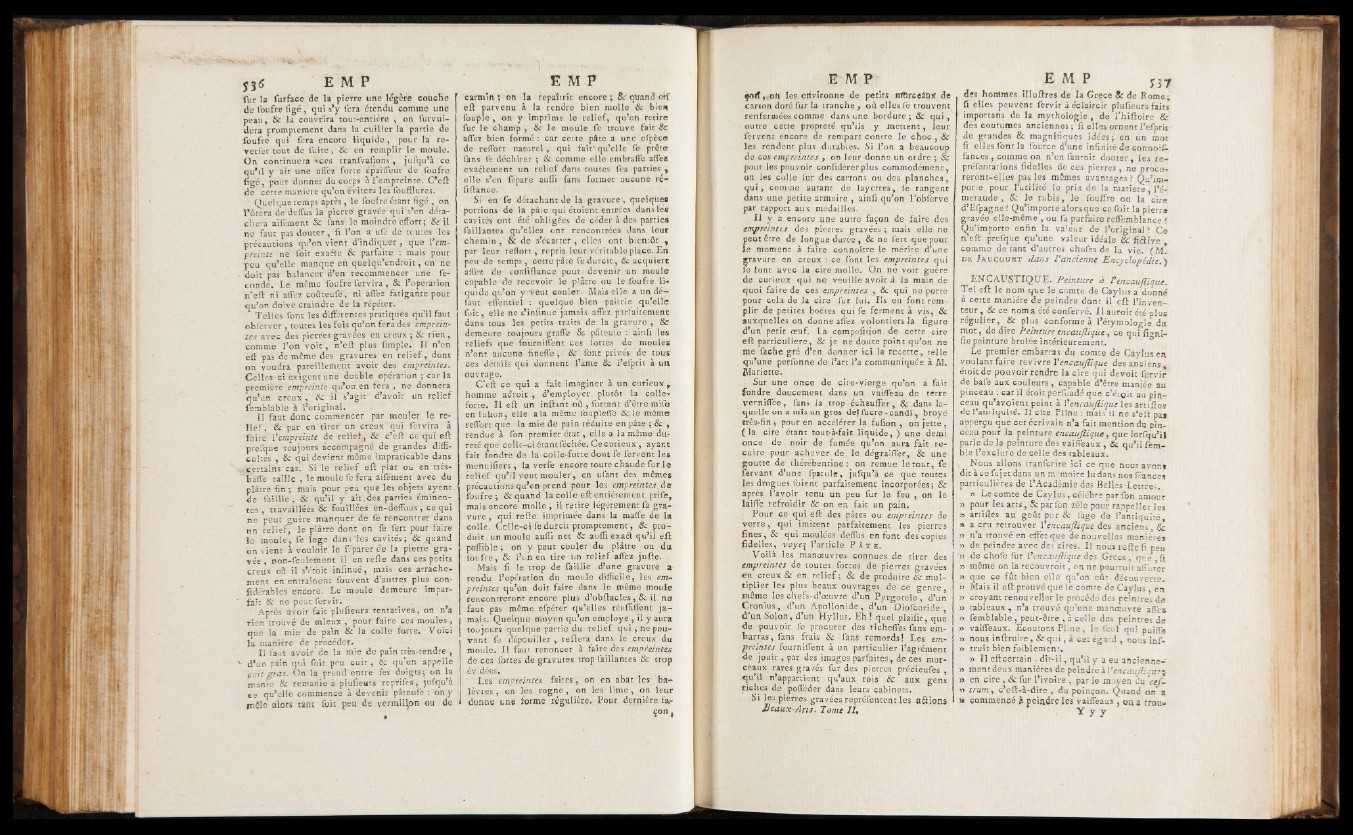
fur la furface de la pierre une légère couche
de loufre figé , qui s'y fera étendu comme une
peau, & la couvrira tout-entière , on furvui-
dera promptement dans la cuiller la partie de
foufre qui fera encore liq u id e , pour lia re-
▼ erfer tout de fuite , & en remplir le moule.
On continuera *ces tranfyafions , jufqu’ à ce
qu'il y ait une allez forte épaiffeur de foufre
fig é , pour donner du corps à l'empreinte. C’ cft
de cette manière qu’on évitera les foufflures.
Quelque temps après, le foufre étant figé , on
l'ôtera de deffus la pierre/ gravée qui s’en détachera
aifëment & fans le moindre effort; & il
ne faut pas douter, fi l’on a ufë de toutes les
précautions qu’on vient d’indiquer , que Yem-
preinte ne foit exa&e & parfaite : mais pour
peu qu’ elle manque en quelqu’endroit, on ne
- doit pas balancer d’en recommencer une fécondé.
Le même foufre fervira , & l’opération
n’eft ni affez coûteufe, ni affez fatigante pour
qu’on doive craindre de la répéter.
Telles font les différentes pratiqués qu’il faut
oblerver , toutes les fois qu’on fera des empreintes
avec des pierres gravées en creux ; & rien,
comme l’on v o i t , n’eft plus fimple. Il n’ en
eft pas de même des gravures en r e l ie f , dont
on voudra pareillement avoir des empreintes.
Celles-ci exigent une double opération ; caria
première empreinte qu’ on en fera ne donnera
qu’ un creux , 8c il s’agit d’avoir un rçlief
femblable à l’original.
I l faut donc commencer par mouler le rel
i e f , & par en tirer un creux qui fervira à
faire Y empreinte de relief,- & c’ eft ce qui eft
prefque toujours accompagné de grandes difficultés
, & qui devient même impraticable dans
certains cas. Si le relief eft plat ou en ttès-
baffe taille , le moule fe fera aifément avec du
plâtre fin ; mais pour peu que les objets ayent
de fa illie , & qu’ il y ait.des parties éminentes
travaillées & fouillées en-deffous , ce qui
ne peut guère manquer de fe rencontrer dans
un relief, le plâtre dont on fe fert pour faire 3e moule, fe loge dans Tes cavités; & quand
on vient à vouloir le réparer ce la pierre grav
é e , non-feulement il en refte dans ces petits
creux où il s’étoit infinué, mais ces arrache-
mens en entraînent fouvent d’autres plus con-
fidérables encore. Le moule demeuré imparfait
& ne peut fervir.
Après avoir fait plufieurs tentatives, on n’a
rien trouvé de mieux , pour faire ces moules,
que la mie de pain & la colle forte. Voiçi
la manière de procéder.
Il faut avoir de la mie de pain très-tendre ,
v d’ un pain qui foit peu cuir , & qu’on appelle
çiiitgjas. On la prend entre fes doigts; on la
manie & remanie à plufieurs reprifes, jufqu’à
ce qu’elle commence à devenir pâteufe : on y
mêle alors tant foit peu de vermillon ou de
carmin ; pn la repaîtrit encore ; 8c quand on
eft parvenu à la rendre bien molle & bien
fouple, on y imprime le relief, qu’on retire
fur le champ , & le moule fe trouve fait &
affez bien formé : car cette pâte a une efpèce
de reflort naturel, qui fait*“qu’elle fe prête
fans fe déchirer ; & comme elle embrafie affez
exactement un relief dans toutes fes parties ,
e lle s’en fépare aufli fans former aucune rc-
fiftance.
Si en fe détachant Je la gravure , quelques
portions de la pâte qui étoienc entrées dans les
cavités ont été obligées de céder à des parties
faillantes qu’elles ont rencontrées dans leur
chemin , & de s’écarter , elles ont bientôt ,
par leur reflort, repris leur véritable place. En
peu de temps, cette pâte fe durcit, & acquiert
allez de confiftance pour devenir un moule
capable de recevoir le plâtre ou le foufre liquide
qu’on y/vèut couler. Mais elle a un défaut
effentiel : quelque bien paîtrie qu’elle
foit, elle ne s’ infmue jamais affez parfaitement
dans tous les petits traits de la gravure , &
demeure toujours graffe 8c pâteulè : ainfi les
reliefs que fourniffent ces fortes de moules
n’ ont aucune fineffe , & font privés de tous
ces détails qui donnent l’ame & l ’efprit à un
ouvrage.
C’ell ce qui a fait imaginer à un curieux,,
homme adroit , d’ employer plutôt la colle-
forte. I l eft un inftant où , fortant d’être mife
en fufion, elle alâ même foupleffe & l e même
reffoft que la mie de pain réduite en pâte ; & ,
rendue à fon premier éta t, elle a la même dureté
que* celle-ci étant féchée. Ce curieux , ayant
fait fondre de la colle-forte dont fe fervent les
menuifiers , la verîe encore toute chaude fur le
relief qu’ il veut mouler, en ufant des mêmes
précautions qu’on prend pour les empreintes, de
foufre; & quand la colle eft entièrement prife,
mais encore molle ; il retire légèrement fa gravure
, qui refte imprimée dans la maffe de la
colle. Celle-ci fe durcit promptement, & produit,
un moule aufli net & aufli exaét qu’ il eft
poffible ; on y peut couler du plâtre ou du
foufre, & l ’on en tire un relief affez jufte.
Mais fi le trop de faillie d’une gravurè a
rendu l’opération du moule difficile, les empreintes
qu’on doit faire dans le même inouïe
rencontreront encore plus d’obftacles, & il ne
faut pas même efpérer qu’elles réufliffent jamais.
Quelque moyen qu’on employé , il y aura
toujours quelque partie du relief qui , ne pouvant
fe dépouiller , reliera dans le creux du
moule. Il faut renoncer à faire des empreintes
de ces fortes de gravures trop faillantes & trop
évidées.
Les empreintes faites, on en abat les ba-
lèvres , on les rogne, on les lim e , on leur
donne une forme régulière. Pour dernière façon
,
foif ,,oh les environne de petits nrbrceâD* de
carton doré fur la tranche y où elles fe trouvent
renfermées comme dans une bordure ; & qui ,
outre cette propreté qu’ ils y mettent, leur
fervent encore de rempart contre le choc , &
les rendent plus durables. Si l’ on a beaucoup
de ces empreintes , on leur donne un ordre ; oc
pour les pouvoir confidérer plus commodément,
on les colle fur des cartons ou des planches,
q u i, comme autant de layettes, fe rangent
dans une petite armoire , ainfi qu’on l ’obferve
par rapport aux médailles.
I l y a encore une autre façon de faire des
empreintes des pierres gravées ; mais elle ne
peut être de longue durée , & ne fert que pour
le moment à faire connoître le mérite d’une
gravure en creux : ce font les empreintes qui
le font avec la cire molle. On ne voit guere
de curieux qui ne veuille avoir à la main de
quoi faire de ces empreintes , & qui ne porte
pour cela de la cire fur lui. Ils en font remplir
de petites boëtes qui fe ferment à vis, &
auxquelles on donne aflez volontiers la figure
d’ un petit oeuf. ta compoficion de cette cire
eft particulière, 8c je ne doute point qu’on ne
me fâche gré d’ en donner ici la recette, telle
qu’une perfonne de l’ art l’a communiquée à M.
Mariette.
Sur une once de cire-vierge qu’on a fait
fondre doucement dans un vaiffeau de terre
verniffée, fans la trop échauffer, & dans laquelle
on a mis un gros deffucre-candi, broyé
très-fin s, pour en accélérer la fufion , on jette ,
( l a cire étant tout-à*fait liq u id e ,) une demi j
once de noir de fumée qu’on aura fait recuire
pour achever de le dégraiffer, & une
goutte de thérébentine : on remue le tout, fe
fervant d’une fpatule, jufqu’à ce que toutes
les drogues foient parfaitement incorporées; 8c
après l’avoir tenu un peu fur le feu , on le
laiffe refroidir & on en fait un pain.
Pour ce qui eft des pâtes ou empreintes de ■
v e r re , qui imitent parfaitement les pierres :
fines, & qui moulées deffus en font des copies !
fideîles, voye% l’article P â t e .
Voilà les manoeuvres connues de tirer des
empreintes de toutes fortes de pierres gravées
•en creux & en relief; & de produire & multiplier
les plus beaux ouvrages de ce genre,
même les chefs-d’oeuvre d’ un Pyrgotele, d’un
Cronius, d’ un Apollonide, d’un Diofcoride
d ’un Solon, d’un Hyllus. Eh ! quel plaifir, que
de pouvoir fe procurer des richeffes fans embarras,
fans frais 8c fans remords! Les empreintes
fourniffent à un particulier l’agrément
de jouir , par des images parfaites, de ces morceaux
rares gravés fur des pierres précieufes ,
qu’ il n’appartient qu’aux rois & aux gens
riches de pofféder dans leurs cabinets.
Si les pierres gravées repréfentenc les aSions
Meaux-Arts. Tome II,
des hommes illuftres de la Grece 8c de Rome;
fi elles peuvent fervir à éclaircir plufieurs faits
importans de la mythologie , de l’hiftoire 8c
des coutumes anciennes; fi elles ornent l’efpric
de grandes & magnifiques idées; en un mot
fi elles font la fource d’une infinité de connoifi-
fances, comme on n’en fauroit douter, les re-
préfentâtions fideîles de ces pierres , ne procureront
elles pas les mêmes avantages? Qu’importe
pour futilité le prix de la matière, l’émeraude
, 8c le rubis, le fouffre ou la cire
d’Efpagne ? Qu’importe alors que ce foit la pierre
gravée elle-même , ou fa parfaite reffemblance ?
Qu’importe enfin la valeur de l’original? Ce
n’eft prefque qu’une valeur idéale 8c ûâive
comme de tant d’autres chofes de la vie. (M .
de Ja u c o u r t dans Vancienne Encyclopédie.)
ENCAUSTIQUE. Peinture à P encaujliquc.
T e l eft le nom que le comte de Caylus a donné
à cette manière de peindre dont il eft l’ inventeur
, & ce nom a été confervé. I l auroit été plus
régulier, & plus conforme à l’étymologie du.
mot, de dire Peinture encaujliquc, ce qui lignifie
peinture brûlée intérieurement.
Le premier embarras du comte de Caylus en
voulant faire revivre Yencauftique des anciens
étoit de pouvoir rendre la cire qui devoit fervir
de bafe aux coulëurs , capable d’être maniée au
pinceau : car il étroit perfuadé que c’éroit au pinceau
qu’avoient peint à Y encaujliquc les arciftes
de l’antiquité. Il cite Pline : mais il ne s’eft pas
apperçu que cet écrivain n’a fait mention du pinceau
pour la peinture encaujliquc, que lorfqu’ il
parle de la peinture des vaifleaux , & qu’ il fem-
ble l’exclure de celle des tableaux.
, Nous allons tranferire ici ce que nous avons
dit à ce fu jet dans un mémoire lu dans nos féances
particulières de l’Académie des Belles-Lettres.
» Le comte de Caylus, célébré par fon amour
» pour les arts, & parfon zélé pour rappelîer les
y> ardftes au goût pur & Page de l’antiquité,
» a cru retrouver Yencauftique des anciens, 8c
» n’a trouvé en effet que de nouvelles manières
» de peindre avec des cires. Il nous refte fi peu
'» de chofe fur Yencaujlique des Grecs, que fi
» même on la recouvroit, on ne pourroit affurer
» que ce fût bien elle qu’on eût découverte.
» Mais il éft prouvé que le comte de Caylus , en
» croyant renouveller le procédé des peintres de
» tableaux, n’a trouvé qu’une manoeuvre affez
» femblable, peut-être , à celle des peintres de
» vaifleaux. Ecoutons P lin e , le feul qui puiffe
» nous inftruire, & q u i, à cet égard , nous inf-
» truit bien foiblemenr.
» Il eft certain - d ît- il, qu’il y a eu ancienne-
» ment deux manières de peindre à Vencaujliqu:\
» en cire , & fur l’ ivoire , par le moyen du cef-
v> trum, c’eft-à-dire , du poinçon. Quand on a
» commencé à peindre les vaifleaux, on a trou-
Y y y