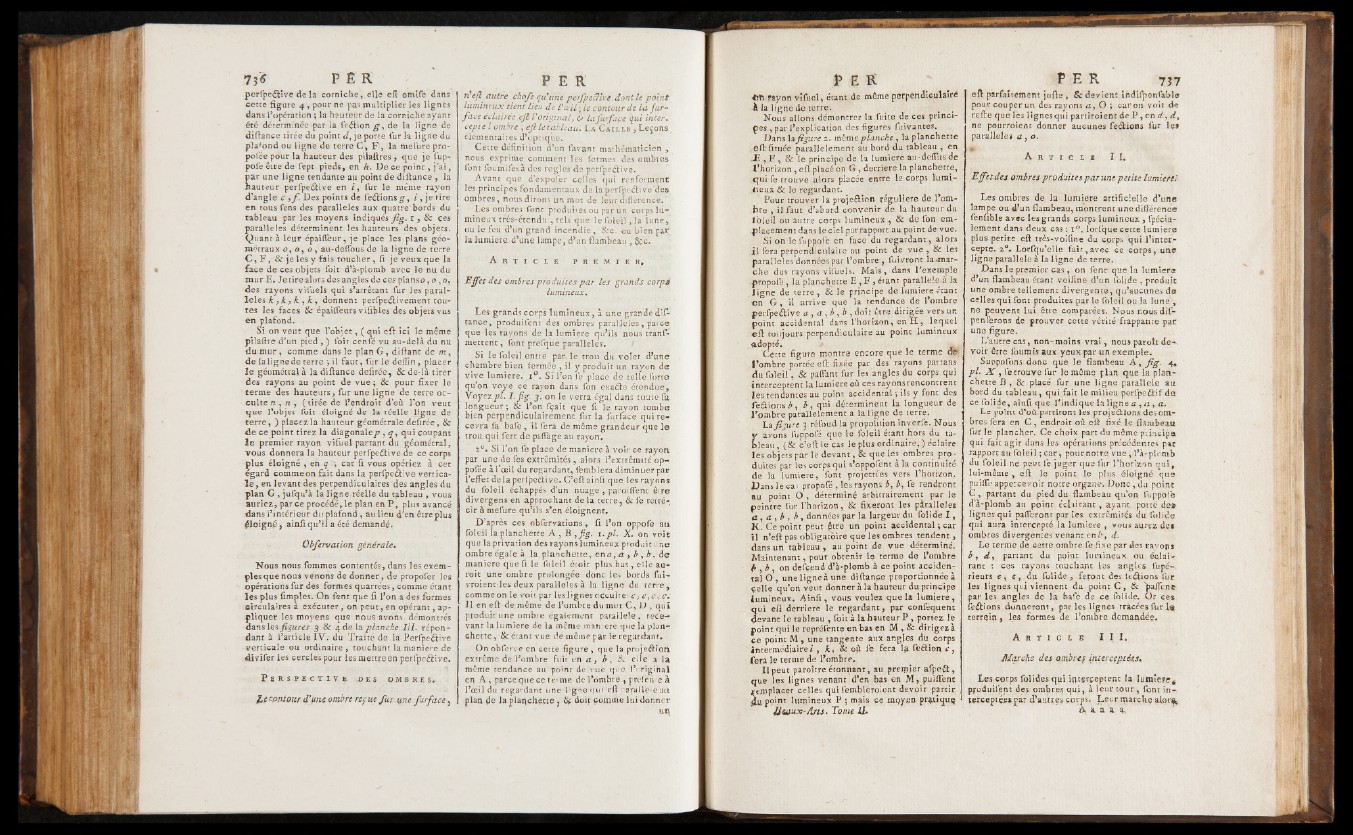
perfpe&ive de la corniche, elle eft omife dans
cette figure 4 , pour ne pas multiplier les lignés
dans l’opération ; la hauteur de la corniche ayant
été déterminée par la feélion g , de la ligne de
diflance tirée du point d, je porte fur la ligne du
plafond ou ligne de terre C, F , la melure pro-
pofée pour la hauteur des pilaftres , que je fup-
pol'e être de fept pieds, en h. De ce point, j’ai,
par une ligne tendante au point de diflance , la
hauteur perfpedlive en £, lur le même rayon
d’angle c y fi. Des points de feélions g y i , je tire
en tous fens des parallèles aux quatre'bords du
tableau par les moyens indiqués fig . 1 , & ces
parallèles déterminent les hauteurs des objets.
Quant à leur épaifleur, je place les plans géo-
mérraux 0 ,0 ,0 , au-dertous de la ligne de terre
C , F , & je les y fais toucher , fi je veux que la
face de ces objets foit d’à-plomb avec le nu du
mur E. Je tire alors des angles de ces plans 0, o , 0,
des rayons viluels qui s’arrêtant fur les parallèles
k , k , k , k , donnent perfpeélivement tou^
tes les faces & épaifleurs vüibles des objets vus
en plafond.
Si on veut que l’objet, ( qui efl ici le même
pilaftre d’un pied , ) foit cenl'é vu au-delà du nu
du mur, comme dans le plan G , difiant de m,
de la ligne de terre -,.il faut, fur le deffin, placer
le géométral à la diflance defirée, & de-la tirer
des rayons au point de vue ; & pour fixer le
terme des hauteurs, fur une ligne de terre occulte
n , n , (tirée de l’endroit d’où l’on veut
que l’objet foit éloigné de la réelle ligne, de
terre, ) placez la hauteur géométrale defirée, &
de ce point tirez la diagonale/;, qy qui coupant
le premier rayon vifuel partant au géométral,
vous donnera la hauteur perfpeétive de ce corps
plus éloigné , en q car fi vous opériez à cet
égard comme on fait dans la perfpeclive verticale
, en levant des perpendiculaires des angles du
plan G , jufqu’à la ligne réelle du tableau , vous
auriez, parce procédé,le plan en P, plus avancé
dans l’intérieur du plafond , au lieu d’en être plus
éloigné, ainfi qu’il a été demandé»
Qbfervation générale»
Nou9 nous fbmmes contentés, dans les exemples
que nous venons de donner, de propofer les
opérations fur des formes quarrées, comme étant
les plus fimples. On fent que fi l’on a des formes
circulaires à exécuter, on peut, en opérant, appliquer
les moyens que nous avons démontrés
dans les figures 3 & 4 de la planche III. répondant
à l’article IV. du Traité de la Perfpeétive
verticale ou ordinaire, touchant la maniéré de
divifer les cercles pour les mettre en perfpeélive.
P e r s p e c t i v e des ombres ,
U cpntour d'une onibre reçue fu r une furface,
n e jl autre chofe qu'une perfpeclive dont le point
lumineux tient lieu de Va il-Je contour de la fur-
face éclairée efl Voriginal, & lafurface qui inter.
cepte l ’ombre , efl le tableau. La Caille , Leçons.
élémentaires d’optique.
Cette définition d’un favant mathématicien ,
nous exprime comment les formes des ombres
font foumifesà des réglés"de perfpeélive.
Avant que. d’expofer celles qui renferment
les principes fondamentaux de la perfpeélive'des
ombres, nous dirons un mot de leur différence.'
Les ombres l'ont produites ou par un corps lu.^*
mtneux très-étendu , tels que le foleil ,.la lune,
ou lé feu d’un grand incendie, & c. ou bien pat
la lumière d’une lampe, d’un flambeau , 8cc.
A r t i c l e p r e m i e r .
Effet des ombres produites par les grands corps
lumineux.
Les grands corps lumineux, à une grande distance
, produifent des ombres parallèles, parce
que les rayons de la lumière qu’ils nous tranf-
mettent, font prefque parallèles. I
Si le foleil entre par* le trou du volet d’une
chambre bien fermée , il y produit un rayon de
vive lumière.^0. Si l’on le place de telle forte
qu’on voye ce rayon dans fon exaéle étendue,
Voyezpl. I. fig. 3. on le verra égal dans toute fa
longueur; & l’on fçait que fi le rayon tombe
bien perpendiculairement fur la furface qui recevra
fa bafe, il fera de même grandeur que le
trou, qui fert de palfage au rayon.
20. Si l’on fe place de maniéré à voir ce rayon
par une de fes extrémités , alors l’extrémité op-
pofée à l’oeil du regardant, femblera diminuer par
l’effet delàperf'pedive. C’efl ainfi que les rayons
du foleil échappés d’un nuage, paroiflent être
divergens en approchant de la terre», & fe rétrécir
à mefure qu’ils s’en éloignent.
D’après ces obfervations, fi l’on oppofe au
! foleil la planchette A , B , fig. 1. pl. X. on voit
que la privation des rayons lumiheux produit une
ombre égale à la planchette, enat a , b yby de
maniéré que fi le foleil étoit plus bas , elle au-
roit une ombre prolongée dont les bords fui-
vroient les deux parallèles à la ligne de terre,
comme on le voit par les lignes occulte.1c } c~,e, c.
Il en efl de même de l’ombte du mur C, D , auï
produit une ombre également parallèle, rece-“
vant la lumière de la même maniéré que la planchette
, & étant vue de même par le regardant.
On obferve en cette figure , que la projeélioù
extrême de l’ombre fuit en a , b , & elle a la
même tendance au point de vue que l’t rigihal
en A , parce que ce terme de l’ombre , préfén e à
l’oeil du regardant une I gné qui-eft parallèle au
plan de la planchette, & doit çomnie lui donner
urç
♦ rtï rayon vifuel, étant de même perpêndieulairé
-à la ligné de terre. |
Nous allons démontrer la fuite de ces principes
, par l’explication des figures jfuivantes.
Dans la figure 2. même planche, la planchette
éft fituée parallèlement au bord du tableau , en
-E , F , & le principe de la lumicre au-deffusde
l ’horizon , efl placé en G , derrière la planchette,
■ qui fe trouve alors placée entre le corps lumineux
& le regardant.
Pour trouver la proje&ion régulière de l’ombre
, il faut d’abord convenir de la hauteur du
lbleil ou autre corps lumineux , & de fon emplacement
dans le ciel par rapport au point de vue.
Si on le fuppofe en face du regardant, alors
.il fera perpendiculaire au point de vue , & les
parallèles données par l’ombre , fuivront la-marche
des rayons viluels. Mais , dans l’exemple
.propofé , la planchette E , F , étant parallèles la
ligne de terre, & le principe de lumière étant
«n G , il arrive que la tendance de l’ombre
perfpeétive a , a fa fa , doic être dirigée vers un
point accidentai dans l’horizon, en H , lequel
e fl toujours perpendiculaire au point lumineux
«dopté.
Cette figure montre encore que le terme de
l ’ombre portée efl fixée par des rayons partans
du fo le il, & partant fur les angles du corps qui
interceptent la lumière où ces rayons rencontrent
les tendantes au point accidentai ■, ils y font des
feélions b , b , qui déterminent la longueur de
l’ombre parallèlement à la ligne de terre.
Lafigure 3 réfoud la propolition inverfe. Nous
avons luppofé que le foleil étant hors du ta-
leau, (& c’efl le cas le plus ordinaire, ) éclaire
les objets par le devant, & que les ombres pro •
duites par les corps qui s’oppofent à la continuité
de la lumière, font projettées vers l’horizon,
pans le ca ; propofé , les rayons b, b> fe rendront
au point O , déterminé arbitrairement par le
peintre fur l’horizon, & fixeront les pàralleles
c. , a , b , b , données par la largeur du folide I ,
K . Ce point peut gtre un point accidentai ; car
il n’efl pas obligatoire que les ombres tendent ,
dans un tableau , au point de vue déterminé.
Maintenant, pour obtenir le terme de l’ombre
£ b , on defçpnd d’à-plomb à ce point accidentai
O , une ligne à une diftanpc proportionnée à
çelle qu’on veut donner à la hauteur du principe
lumineux. A in fi, vous voulez que la lumière,
qui eft derrière le regardant, par conféquent
devant le tableau , foit à la hauteur P , portez le
point qui le repréfente en bas en M , & dirigez à
ce point M , une tangente aux angles du corps
intermédiaire £ , £, & ojl fe fera feélion c ,
fera le terme de l’ ombre.
Il peut paroître étonnant, au premier afpe&,
que les lignes venant d’en bas en M, puiffent
fe.ipplacer celles qui fembleroîent devoir partir
Ju point ltirçnneux P ; mpis ce mpyso pratique
J?taux-Arts- Tome IL
efl parfaitement jnfle , & devient indifpenfable
pour couper'un des rayons a , O ; caron voit de
refie que les lignesqui partiroient de P , en dydy
ne pourroient donner aucunes feélions fur les
parallèles a , o.
A r t i c l e II.
Effet des ombres produites par une petite lumière!
Les ombres de la lumière artificielle d’une
lampe ou d’un flambeau, montrent une différence
fenfible avec les grands corps lumineux , fpécia-
lement dans deux cas : i°. lorfque cette lumière
plus petite efl très-voifine du corps qui l’intercepte.
2.0. Lorfqu’elle fait,avec ce corps, une
ligne parallèle à la ligne de terre.
Dans le premier cas , on fent- que la lumière
d’un flambeau étant voifine d’un folide , produit
une ombre tellement divergente, qu’aucunes de
celles qui font produites par le foleil ou la lune ,
ne peuvent lui être comparées. Npusnousdif-
penferons de prouver cette vérité frappante par
une figure.
L’autre cas, non-moins vrai, nous paroît de-,
voir être fournis aux yeux par un exemple.
Suppofons donc que le flambeau A, fig . 4.
p l. X , fe trouve fur le même plan que la planchette
B , & placé fur une ligne parallèle au
bord du tableau, qui fait le milieu perfpeélif de
ce folide, ainfi que l’indique la ligne a , a , a.
Le point d’où partiront les projetions des ombres
fera en C , endroit où efl fixé le flambeau
fur le plancher. Ce choix part du même principe
qui fait agir dans les opérations précédentes par
rapport au foleil ; car, pournorre vue, l’à-plomb
du foleil ne peut fe juger que fur l ’horîxon qui,
lui-même, efl le point le plus éloigné que
puiffe appercevoir notre organe. Donc, du point
C , partant du pied du flambeau qu’on fuppofe
d’à-plomb au point éclairant, ayant porté de»
lignesqui pafferont par les extrémités du folide
qui aura intercepté la lumière , vous aurez des
ombres divergentes venant en b, d-
Le terme de cette ombre fe fixe par des rayons
b , d y partant du point lumineux ou éclairant
: ces rayons touchant les angles fupé--
rieurs e, e , du lblide^ feronc des feélions fur
les lignes qui viennent du point C , & Raflent
par les angles de la bafe de ce loi i de. Or ces
iéélions donneront, par les lignes tracées fur
terre in , les formes de l’onibre demandée.
A r t i c l e I I I *
Afarcfis des ombres interceptées»
Les corps folides qui intgrçeptent la Iumïefeé
produifent des ombres qui» à leur tour ? font in-
wrceptées par d’autres corps. Leur marche aioret
 a a a a.