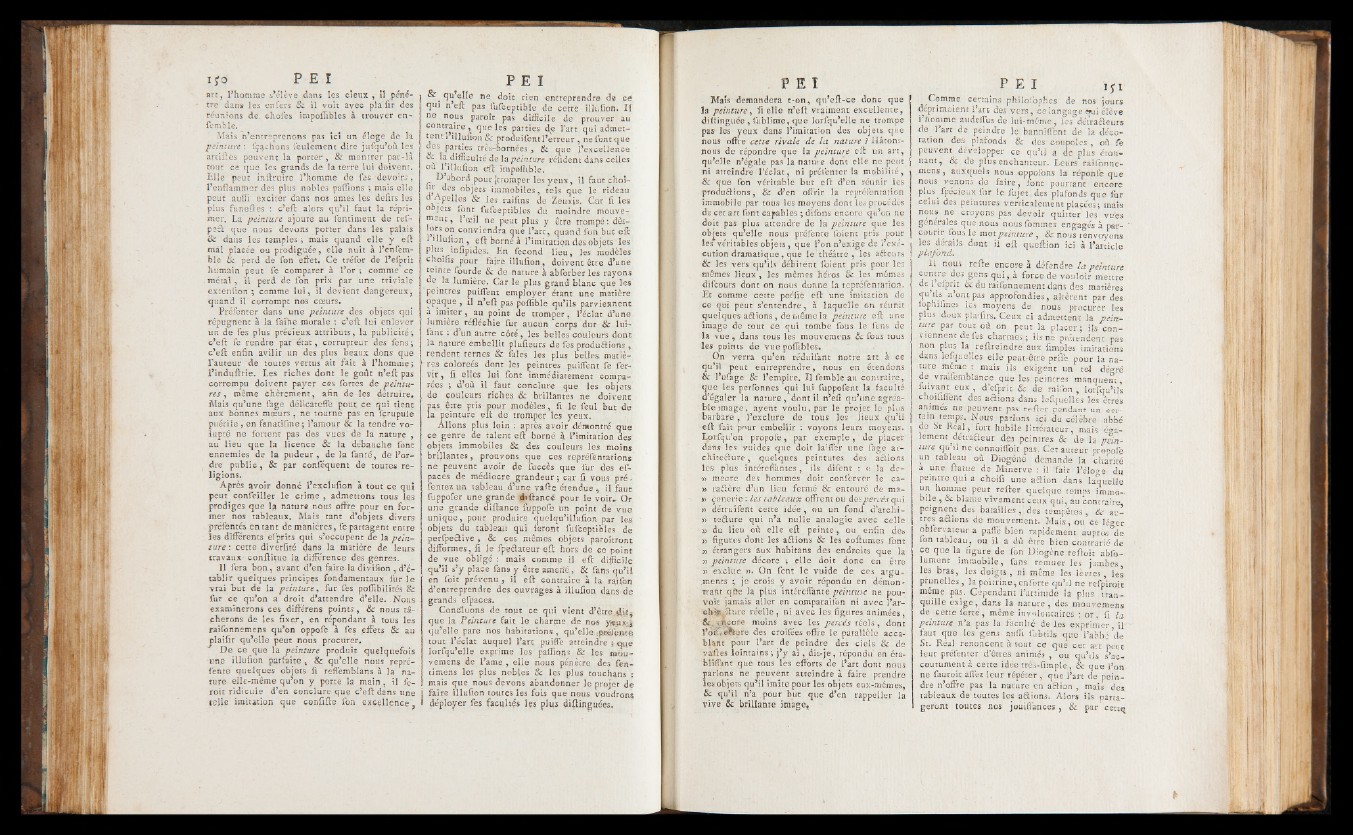
arc, l’ homme s’élève dans les cîeux , îl pénétre
dans- les enfers 8c il voit avec pla'fir des
réunions de. choies impofîibles à trouver en-
fernble.
Mais n’entreprenons pas ici un éloge de l a .
peinture : fça.chons l’eulement dire jufqu’ où les
arciffes peuvent la porter, & montrer par-là
tout ce que les grands de la terre lui doivenr.
E lle peut inftruire l ’homme de les devoirs,
l ’enflammer des plus nobles pallions j mais elle
peut aulli exciter dans nos âmes les defirs les
plus funeftes : c’ eft alors qu’ il faut la réprimer.
La peinture ajoute au fentiment de ref-
ped que nous devons porter dans les palais
& dans les temples -, mais quand elle y eft
mal placée ou prodiguée, elle nuit à l’enfem-
ble & perd de fon effet. Ce tréfor de l’ efprit
humain peut le comparer à l’or -, comme ce
. métal, il perd de fon prix par une triviale
extenlion ; comme lu i, il devient dangereux,
quand il corrompt nos coeurs.
Préfenter dans une peinture des objets qui
répugnent à la fafne morale : c’eft lui enlever
un de fes plus précieux attributs, la publicité-,
c’eft fe rendre par~ état, corrupteur des fens ;
c’eft enfin avilir un des plus beaux dons que
l’auteur de toutes yertus ait fait à l’homme ;
l ’ induftrie. Les riches dont le goût n’eft pas
corrompu doivent payer ces fortes de peintures
, même Chèrement, afin de les détruire.
Mais qu’une fage déliçatelfe pour ce qui tient
aux bonnes moeurs , ne tourne pas en fçrupulë
puérile , en fanatifme; l’amour & la tendre volupté
ne forcent pas des vues de la nature ,
au lieu que la licence & la débauche font
ennemies de la pudeur , de la fan té, de l’ordre
pub lic, & par conféquent de toutes religions.
Après $voir donné l’exclufion à tout ce qui
peut çonfeiller le prince , admettons tous les
prodiges que la nature nous offre pour en former
nos tableaux. Mais tant d’objets divers
préfentés entant de manières, fe partagent entre
le s differents efprits qui s’occupent de la pein-
sure : cette diverfité dans la matière de leurs
travaux conftitue la différence des genres.
11 fera bon, avant d’en faire la divifion , d’établir
quelques principes fondamentaux fur le
vrai but de la peinture, fur fes polfibilités &
fur ce qu’on a droit d’attendre d’elje. Nous
examinerons ces différens points, & nous tâcherons
de les fixer, en répondant à tous les
raifonnemens qu’on oppofe à fes effets & au
plaifir qu’elle peut nous procurer.
De ce que la peinture produit quelquefois
une illufion parfaite , & qu’elle nous repréfente
quelques objets fi reffemblaiis à la nature
elle-même qu’on y porte la main, il feront
ridicule d’en conclure que c’eft dans une
telle imitation que çonfifte fon excellence,
qu’elle ne doit rien entreprendre de ce
qui n eft pas fufceptible de cette illufion. I l
ne nous paroît pas difficile de prouver au
contraire, que les parties d^e l’art qui admettent
l’ i 11 ulîon 8c produifentl’erreur , ne font que
des^ parties très-bornées, & que l’excellence
& la difficulté de la peinture rélident dans celles
ou 1 illufion eft impofiibîe.
D abord pour {tromper les yeux, il faut choides
objets immobiles, tels que le rideau
d ApeHes 8c les raifins de Zeuxis. Car fi les
objets font fufceptibles du moindre mouve-
n*snt, l’oeil ne peut plus y être trompé : dès-
lors on conviendra que l’art, quand fon but eft
1 illufid^ j eft borné à l’ imitation des objets les
Plus_ infipides. En fécond lieu, les modèles
choifis pour faire illufion, doivent être d’une
teinte fourde 8c de nature à abforber les rayons
de la lumière. Car le plus grand blanc que les
peintres puiflent employer étant une matière
opaque, il n’eft pas poflible qu’ îls parviennent
a imiter, au point de tromper, l’éclat d’une
lumière refléchie fur aucun corps dur & lui—
fant : dun autre côté, les belles couleurs dont
la nature embellit plufieurs de fes produirions ,
rendent ternes & l’aies les plus belles, matières
coloreés dont les peintres puilfent fe fer-
v ir , fi elles lui font inimédiatement comparées
•, d’où il faut conclure que les objets
de couleurs riches & brillantes né doivent
pas. être pris pour modèles, fi le feul but de
la peinture eft de tromper les yeux.
Allons plus loin : apres avoir démontré que
ce genre de talent eft borné | l’imitation des
objets immobiles &. des couleurs les moins
brillantes, prouvons que ces repréfentations
ne peuvent avoir de fuccès que fur des ef-
paces de médiocre grandeur ; car fi vous pré -
fentez un tableau d’une vafte étendue , il faut
fuppofer une grande «èiftancé pour le voir- Or
une grande diftance fuppofe un point de vue
unique, pour produire quelqu’ illufion par les
objets du tableau qui feront fufceptibles de
perfpedive , & ces mêmes objets paroîtront
difformes, fi le fpedateur eft hors de ce point
de vue obligé : mais comme il eft difficile
qu’ il s’y place fans y être ameiïë, & fans qu’ il
en foit prévenu, il eft contraire à la r^ifon
d’entreprendre des ouvrages à illufion dans de
grands efpaces.
Concluons de tout ce qui vient d’être..^iië§
que la Peinture fait Je charpie de nos yjçux*jt
qu’ elle pare nos habitations, qu’elle.ipt^ente
tout -l’éclat auquel l ’art puiffe atteindre ÿ que
lorfqu’ elïe exprime les paffiqps & les mqu-
vemenç de l’ame , elle nous pénètre des fen-
timens les plus nobles & les plus touchans :
mais que nous devons abandonner le projet de
faire illufion toutes les fois que nous voudrons
déplover fes facqltçs lçs plus distinguées.
Maïs demandera t-on, qu’eft-ce donc que
la peinture, fi elle n’eft vraiment excellente,
diftinguée , fublime, que lorfqu’elle ne trompe
pas les yeux dans l’imitation des objets que ;
nous offre cette rivale 'de la nature ? Hâtons-
nous de répondre que la peinture eft un art,
qu’elle n’égale pas la nature dont elle ne peut j
ni atteindre l ’éclat, ni préfenter la mobilité,
& que fon véritable but eft d’en réunir les
productions, & d’ en offrir la repréfentation
immobile par tous les moyens dont les procédés
de cet art font capables ; difons encore qu’on ne
doit pas plus attendre de la peinture que l'es
objets qu’elle nous préfehte l'oient pris pour
les véritables objets, que l’on n’exige de l’exécution
dramatique, que le ' théâtre , les adeurs
& les vers qu’ ils débitent l’oient pris pour les
mêmes lieu x , les mêmes héros & les mêmes
difeours dont on nous donne la repréfentation.
Et comme cette poéfié eft une imitation de
ce qui peut s’entendre, à laquelle en réunit
quelques a Citons, de même la peinture eft une
image de tout ce qui tombe fous le l’ens de
la v u e , dans tous les mouvemens 8c fous tous
les points de vue poflibles.
On verra qu’ en rpduifant notre art à ce
qu’ il peut entreprendre, nous en étendons
8c l’ufage & l’empire. Il femble au contraire,
que les perfonnes qui lui fuppofent la faculté I
d’égaler la nature, dont il n’ eft qu’une agréable
image, ayent voulu, par le projet le plus
barbare , l’exclure de tous les lieux qu’ il
eft fait prtur embellir : voyons leurs moyens.
Lorfqu’on propofe , par exemple , " de placer
dans les vuides que doit la;fier une fage architecture
, quelques peintures des actions
les plus intérefîantes , ils difent : « la d e - '
*» meure des hommes doit conferver le ca-
» raClère d’un lieu feriiié & entouré de ma-
» çonerie : les tableaux offrent ou des percés qui
» détruifent cette idée , ou un fond d’archi-
» teClure qui n’ a nulle analogie avec celle
» du lieu où elle eft peinte, ou enfin dea
» figures dont les adions & les coftumes font
» étrangers aux habitans des endroits que la
peinture décore ; elle doit donc en être
» exclue ». On fent lé vuide de ces arguments
; je crois y avoir répondu en démontrant
qùe la plus intéreflante peinture ne pouvoir
jamais aller en comparaiion ni avec l’ar-
ch^Slure réelle , ni.avec les figures animées,
& , tmcore moins avec les percés réels , dont
l’ ôRi-e&ure des croifées offre le parallèle accablant
pour l’art de peindre des ciels 8c de
vaftes lointains *, j’ y a i , dis-je, répondu en éta-
biiffant que tous les efforts de l’ art dont nous,
parlons ne peuvent atteindre à faire prendre
les objets qu’ il imite pour les objets eux-mémes,
& qu’ il n’a pour but que d’ en rappeller la
Viye & brillante image8
Comme certains philosophes de nos jours
déprimoient l ’arc des v e r s , ce langage mil élève
l’homme audeffus de lui-même, les détracteurs
de l ’arc de peindre le banniflent de la décoration
des plafonds 8c des coupoles , où fe
peuvent développer ce qu’il a de plus étonnant,
8c de plus enchanteur. Leurs raifonne-
mens, auxquels nous oppofons la réponfe que
nous venons 4e faire, font pourtant encore
plus fpécieux (nr le fujet des plafonds que fur
celui des peintures-verticalement placées ; mais
nous ne croyons pas devoir quitter les vues
generales que nous nous fommes engagés à parcourir
fous le mot peinture , 8c nous renvoyons
les détails dont il eft queftion ici à l ’article
plafond.
H nous refte encore à défendre lu peinture
contre des gens qui,.à force de vouloir mettre
de^l efprit & du raifonnement dans des matières
qu ils n’ont pas approfondies, altèrent par des
lophifines les moyens de nous procurer les
plus doux plæfirs. Ceux ci admettent la peinture
par tout où on peut la placer; ils contiennent
de fes charmes; ils ne prétendent pas
non plus la reftreindre aux fimples imitations
dans lesquelles elle peut-être prife pour la nature
même : mais ils exigent un tel degré
de vraifemblance que les peintres manquent,
fuivant eux , d’efprit 8c de raiî’on , lorfqu’ ils
cnoififtent des adions dans lefquelles les êtres
animés ne peuyent pas relier pendant un certain
temps. Nous parlons ici du célèbre abbé
de ot Réal, fort habile littérateur, mais également
^détradeur dea peintres & de Iz peinture
qu’ il ne connoiflbit pas. Cet auteur prooofe
un tableau où Diogène demande la charité
a une ftatue de Minerve : il "fait l’éloge du
peintre qui a choifi une adion dans laquelle
un homme peut refter quelque temps immobile
, 8c blâme vivement ceux qui, au contraire,
peignent des batailles , des tempêtes, 8c autres
adions de mouvement. Mais, ou ce léger
obfervaieur a paffé bien rapidement auprès de
fon tableau, ou il a dû être bien contrarié de
ce que la figure de fon Diogène reftoit abfo-
lument immobile, fans remuer les jambes,
les bras, les doigts, ni même les lèvres, les
prunelles , la poitrine, enforte qu’ il ne refpiroit
même pas. Cependant l’attitude la plus tranquille
ex ige, dans la nature, des mouvemens
de cette forte, même involontaires : o r , fi la,
peinture n’a pas la faculté de les exprimer, il
faut que les gens a.ufti fubtils que l’abbi de
St. Réal renoncent à tout ce que cec art petit
leur préfenter d’êtres animés , ou qu’ ils s’accoutument
à cette idée très-fimple,, & que l’on
ne fauroit afîez leur répéter , que l’art de peindre
n’offre pas la nature en adion , mais des
tableaux de toutes les adions. Alors ils partageront
toutes nos jouiflances, 8c par cette