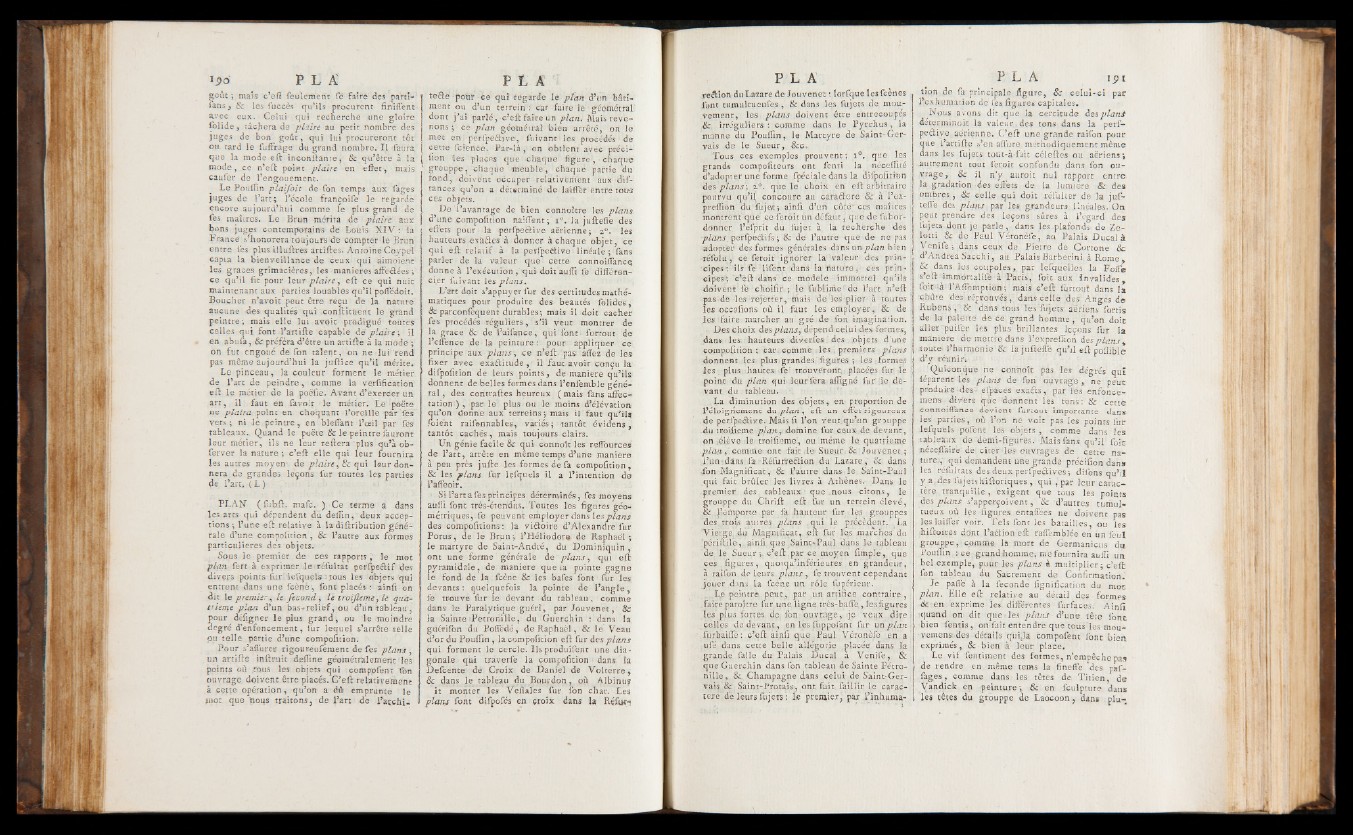
P L A 1
goût -, mars c’ eft feulement fë faire des parti-5
lans , & les fuccès qu’ils procurent finiffent
avec eux. Celui qui recherche une gloire
lo lid e , tâchera de plaire au petit nombre des
juges de bon goût, qui lui procureront tôt
ou tard le fuffrage du grand nombre. Il faura.
que la mode eft inconllante; & qu’être à la
mode, ce n’eft point plaire en effet, mais
caufer de l’engouement.
Le Pouffin plaifoit de fon temps aux Pages
juges de l ’art; l’école françoile le regarde
encore aujourd’hui comme le plus grand de
fes maîtres. Le Brun mérita de plaire aux
bons juges contemporains de Louis X IV : là
Francé .«/honorera toujours de compter de Brun
entre les plus illuftres artiftes. Antoine Coypel
capta la bienveillance de ceux- qui -âimoient
les grâces grimacières, les maniérés âffëétées -,
ce qu’ il fit pour leur plaire, eft ce qui nuit
maintenant aux parties louables qu’il polfédoit.
Boucher n’avoit peut être reçu de la nature
aucune des qualités qui conftitüent le grand
peintre; mais elle lui avoir prodigué toutes1
celles qui font l’artifte capable de plaire ; il
en abula, & préféra d’être un artiftè à la mode ;
on fut engoué de fon talent, on ne lui'rend
pas même aujourd’hui la juftice qu’ il mérite.-
Le pinceau, la couleur forment le métier
de l’art de peindre, comme la verfifieation
eft le métier de la poëfie. Avant d’ exercer un
ar t, il faut en favolr le métier. Le poète
ne plaira point en choquant l’oreille par fes
vers ; ni le peintre, en bleflant l’oeil par fes
tableaux. Quand le poète & le peintre l'auront
leur métier, ils ne leur reliera plus qu’à observer
la nature ; c’eft elle qui leur fournira
les autres moyen: de plaire, 8c qui leur donnera
de grandes leçons fur toutes les parties
de l’art, ( L )
PLAN ( fubft. ma Pc. ) Ce terme a dans
les arts qui dépendent du deffin, deux acceptions;
l’ une eft relative à la diftribution générale
d’une çompofition , & l’autre aux formes
particulières des objets. -
Sous le premier de ces rapports ^ le mot
fla n fert à exprimer ,1e-réfultat pe-rfpecl-if dés
divers points fur] le (quels tous les Objets’qui
entrent dans une fcènè; font placés: ainfi on
dit le p remierle. fécond, le troijiemè7 le quatrième
plan, d’un bas-rrelief, ou d’iin tableau
pour défigner le plus grand; ou le moindre
degré d’enfoncement, fur lequel s’arrête telle
ou telle partie d’une çompofition.
Pour s’ afiurer rigoureufement de fes plans ,
un artifte inftruit defline géométral em ent les
points où .tous les. objets qui comppfént ftjn
ouvrage doivent être placés. G’ eft relativement
à cette opération, qu’on a dû emprunte le
mot que "nous traitons, de l’art de l ’archi-
P L A
teéle pour ce qui tegarde le p la n d’un bâtiment
ou d’ un terrein : car faire le géométral
dont j ’ai parlé, ■ c’eft faire ün pla n. Mais revenons
; ce p la n géométral bien arrêté, on le
met en perfpéâive, fuivant les procédés de
cette fcience. Par-là, on obtient avec préci-
fion les places que -chaque figure; chaque 1 grouppe, chaque meuble, chaque partie du
fond, -doivent occuper relativement aux dif-
tances qu’on a déterminé de laifler entré tou\5
ces objets.
De l’avantage de bien connoître les plans
d’une çompofition naiffent; i° . la jufteflè des
effets pour la perfpeclive aerienne; %°. les
hauteursÆxàéles à donner à chaque objet, ce
qui eft relatif à la perfpeélive linéale ; fans
parler de la valeur que cette connoiflancq
donne à l’exécution , qui doit aufli fe différencier
fuivant les plans.
L’art doit s’appuyer fur des certitudes mathématiques
pour produire des beautés folides,
& parconféquent durables; mais il doit cacher
fes procédés réguliers, 1 s’il veut montrer de
la grâce & de l’aifance, qui font furtout de
l’eifence de- la peinture : pour appliquer ce.
principe aux p lans, ce n’éft pas: affez de les
fixer avec exàélitude, il faut-avoir conçu la.
difpofition de leurs points, de maniéré qu’ ils
donnent de belles formes dans l ’enfemble général
, des contraftes heureux (mais fans affec-»
ration-) , par le' plus ou le moins d?élévation
qu’on donne aux terreins ; mais il faut qu’ils
foi eh t raifonnables, variés; -tantôt évidens,
tantôt cachés, mais toujours clairs.
Un génie facile & qui .connoît les reflources
de l’art, arrête en même temps d’une maniera
à peu près jufte les formes de fa çompofition,
& les p la n s fur Içfquels il a l’ intention de
l’ affeoir.
1 Si l’ art a fes principes déterminés, fes moyens
aufli font très-étendus. Toutes les figures géométriques,
fe peuvent employer dans l e s p la n s
des compofitions : la viétoire d’Alexandre fur
Porus, de le Brun ; l’Héliodoro de Raphaël;
le martyre de Saint-André, du Dominiquin ,
ont une forme générale de p la n s , qui eft
pyramidale, de maniéré que ia pointe gagne
le fond- de la fcène & les bafes font fur les
devants: quelquefois la pointe de l’angle,
fe trouve fur le devant du tableau, comme
dans le Paralytique guéri, par Jouvenet, &
la Sainte 'Pétronille, du Guerchin : dans la
guérifon du Poffedé; de Raphaël, & le Veau
d’or du Pouflin , la çompofition eft fur des p la n s
qui forment le cercle. Ils produifent une diagonale
qui traverfe la çompofition dans la
-Defcente dé Croix de Daniel de Volterre ,
& dans le tableau du Bourdon, où Albinus
it monter les Veftales fur fon char. Le$
p la n s font difpofés en croix dans la Réfuta
p L A
reftion du Lazare de Jouveneï : lorfque les fcènes
font tumultueufe.s , & dans les fujets de, mouvement,
les plans doivent être entrecoupés
& irréguliers : comme dans le Pyrrhus, la
manne du Pouflin, le Martyre de Saint-Ger-
vais de le Sueur, & c .
Tous ces exemples prouvent; i° . que les
grand* compofiteurs ont fenti la néceflité
d’adopter une forme fpéciale dans la difpofiti'on
dés plans ; z°. que le choix en eft arbitraire
pourvu qu’ il concoure au caraéleré & à l’ex-
preflion du ftijef; ainfi d’un côté" ces maîtres
montrent que’ ce ferôitùn défaut, que de fûbor-
donner l’efprit du fujet à la recherche des
plans, perfpeélifs ; & de l’autre que de ne pas
adopter des formes générales dans unp lan bien
réfolu, ce feroit ignorer la valeur des principes':
ils fè lifent dans la nature eès principes^
c’eft dans ce modèle immortel qu’ ils
doivent'fè choifir ; lè fublimer de l ’art rï’eft
pas de -les •rejëtfer, mais de les plier à toutes
les occafions où il faut les employer, & de
,les .faire marcher au gré de fon imagination.
Des; choix des^/anj1, dépend celui des formes,
dans - les::hauteurs div.erl’es., des . [objets d'une
çompofition : car. comme:i les ■ premiers; ; plans
donnent fies plus grandes, figures ; lés • formes
les ; plus ; hautes, fe: trouveront;. placées fur de
point du plan qui -leur lera àfligné fur le devant
du tableau. .
La diminution des objets, en proportion de
l’éloignement du plan, eft un effet rigoureux
.de perfpeélive. Mais fi l’on veut,qu’un grouppe
.du trolSieme p l a n -domine fur ceux de devant,
on ,-él,éve île-troifieme;, ou même le. quatrième
plan ,. comme ont fait -le- Sué tir.: &, Jouyenec ;
Vun-jdans far-Réfurteélion du Lazare , &; dans
Ton Magnificat, & L’autre dans,le Saint-Paul
qui fait brûler les livres à Athènes.- Dans le
.premier, des. tableaux ■ que.nous citons, le
grouppe du Chrift eft fur un terrein élevé,
& l’emporte .par fa hauteur fur les grouppes
des. trois autres plans . qui le précèdent. La
Vierge du Magnificat, eft fur les marches du
pérjftile,. ainfi que ;Saint-Paul dans le tableau
de le Sueur;, c’eft .par ce moyen fimple, que
ces , figures, quoiqu’ inférieures en grandeur,
à r ai fon de leurs plans, le trouvent cependant
jouer dans la fcène un rôle fupérieur.
. ’ L.e peintre peut , par ,un artifice contraire ,
. faire paro?tre fur une. ligne, très-bafle,, les.figures
les" plus fortes, de, fon ouvrage, je veux dipe
celles de devant, en les luppofant fur- un plan
lurbaifle: c’eft ainfi que Paul Vér.onèfe' ren a
;ufe dans cette belle allégorie placée dans La
grande falle du Palais Ducal a V enife, &
que Guerchin dans fon tableau de Sainte Pétronille
, & Champagne dans celui de Saint-Ger-
vai^ ,& Saint-Protais; ont fait, faillir le caractère
de leurs fujets : le preiuier? par .l’ inhuma-
P L A ip i
tion de fa'principale figure, & celui-ci par
l’exhumation de les figures capitales.
Nous avons dit que la certitude desplanÈ
déterminoic la valeur,.des tons dans la perf-
peélive aerienne. C’ eft une grande railbn pour
que l’artifte n’en allure méthodiquement même
dans les fujets tout-à-fait céleftes ou aeriens;
.autrement tout lero.it confondu .dans fon ou-
y ra ge , & il n’y auroit nul rapport entre
la gradation des effets de la lumière & des
ombres, & cefte qui doit réfui ter de la juf-
teffe des plans par les grandeurs ünéales. On
peut prendre des leçons sûres à l’égard des
fujets dont je parle , dans les-plafonds de Ze-
lotti 8ç de Paul Véronèfe, au Palais Ducal à
Venife ; dans ceux de Pierre de Cortone &
d’Andrea Sacchi, au Palais Barberini à Rome ,
& dans les coupoles, par léfquëlles la Fofle
s’eft immôrtalifé à Paris, foit aux Invalides
fôit'-à-l’Aflomptibn; mais c’eft l'urtout dans la
x,hût'è 'd'e^.réprouvés,, dans ceile des' Anges de
Rubens 6c dans tous les fujets aériens fortis
de là palette de ce grand homme, qu’on doit
âller puifer les plus' brillantes leçons fur la
maniéré de mettre dans l’ expreflion des plans
toute, i-’harmenie & la juftefle qu’il eft poflible
d’y réunir'.
y1 Quiconque ne connoît pas les degrés qui
feparerît les plans de fon ouvrage , ne peut
produire vies- elpàces exaéls , par lé s enfonce-
mehs divers que donnent les tons: & cettè
connoiffance devient furtout importante dans
les parties, où l ’on ne voit pas les points fur
lefquels pofènt lés objets , comme dans les
tableaux de demi-figurés. Mais fans qu’ il foit
néceflairè dèi citer des ouvrages de cette na-
tureo," qui demandent une grande précifion dans
les réfui rats des deuxperfpeclives ; difons qu’il
y a [des 'fujetshiftoriques , qui , par leur caractère
tranquille , exigent que tous les points
des plans s’apperçoivent, & d’autres tumultueux
où les figures entaflëes ne doivent pas
les laifler voir. Tels font les batailles, ou les
hiftoirçs dont, l’aéüonëft raflemblée en un fe'ul
grouppe, 1 comme la mort de Germanicus du
Pouflin : cq grand homme, me fournira aufli un
bel exemple', pour les plans à multiplier; c’eft:
fon tableau du Sacrement de Confirmation.
Je pafle à la fécondé lignification du mot
plan. Elle eft relative au détail des formes
de en exprime les differentes furfaces. Ainfi
rquand on dit que :lès plans d’une tête fone
bien fentis, on fait entendre que tous les mou-
vemens des détails qui:]a compofent font bien
exprimés, & bien à leur place.
Le v if Gentiment des formes, n’empêche pas
de rendre en même tems la fineffe des paf-
fages, comme dans les têtes de Titien, de
Vandick en peinture v & en fculpture dans
Je« çé;es du grouppe ae Laocoon, dans plu