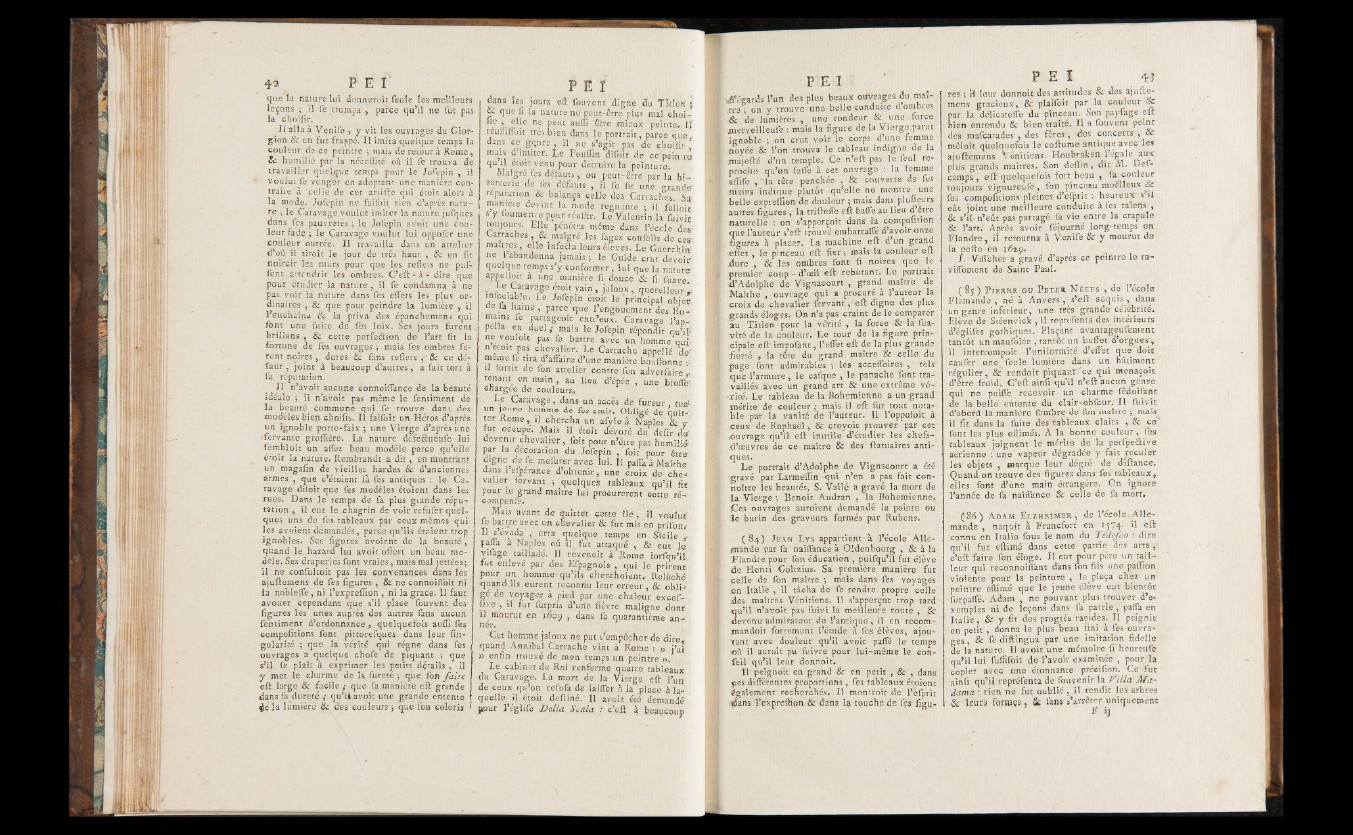
4a P E I
cjue là nature lui donneront feule les meilleurs
leçons ; ^ il le trompa , parce qu’il ne fut pas
la choifir.
Il alla à Venife , y vit les ouvrages du Gior-
gion & en fut frappé. Il imita quelque temps la
couleur de ce peintre 3 mais de retour à Rome,
Sc humilié par la néc.efiité où il le trouva de
travailler quelque temps pour le Jofepin , il
voulut fe venger en adoptant'une manière contraire
à celle*de cet arrifte qui étoit alors à
la mode. Jofepin ne faifoit rien d’après nature
j le Caravage voulut imiter la nature jufquès
dans fes pauvretés -, le Jolepin avoit une couleur
fade ; le Caravage voulut lui oppofer une
couleur outrée. I l travailla dans un àttelief
, d’où il tiroît le jour de très haut , 8c en fit
noircir les murs pour que les reflets ne puf-
lent attendrir les ombres. C’ eft - à - dire que
pour étudier la nature, il fe condamna à ne
pas voir la nature dans fes effets les plus ordinaires
, & que pour peindre la lumière , il
1 enchaîna 8c la priva des épanehemehs qui
font une fuite de fes loix. Ses jours furent J
brillans , & cette perfection de l’ art fit la
fortune de fes ouvrages -, mais fes ombres furent
noires, dures 8c fans reflets ^ 8c ce défaut
, joint à beaucoup d’autres, a fait tort à
la réputation.
Il n’avoit aucune connoiffanee de la beauté
idéale ; il h’avoit pas même le fentiment de
la beauté commune qui fe „trouve dans des
modèles bien choifis. I l faifoit un Héros d’après <
tin ignoble porte-faix ; une Vierge d’après une
Servante groffière. La nature défeétueufe lui
iembloit un affez beau modèle parce qu’el-le'
étoit la nature. Rembrandt a dit , en montrant
un magafin de vieilles hardes & d’anciennes
armes , que c’étoient là fes antiques : le Ca-
ravage difbit que fes modèles étoient dans les,
rues. Dans le temps de fa plus giande réputation
, il eut le chagrin de voir refufei'quelques
uns de fes tableaux par ceux mêmes qui
lès avoient demandés, parce qu’ ils étoient trop
ignobles. Ses figures avoient de la beauté,
quand le_hazard lui avoit offert un beau modèle.
Ses draperies font vraies, mais mal jettées;
il ne confultoit pas les .convenances dans les
ajuftemens de fes figures , & ne connoiffoit ni
la nobleffe, ni l ’expreffion , ni la grâce. Î1 faut
avouer cependant que s’il place fou vent des
figures les unes auprès des autres fans aucun
fentiment d’ordonnance , quelquefois àùfli fes
compofitions font pittorefques dans leur Angularité
; que la vérité qui régne dans fes
ouvrages a quelque chofe de piquant ; que
s’ il fè plaît à exprimer les petits détails , il
-y met le charme de la fureté -, que fon faire
eft large & faeile y que fa manière eft grande
dans fa dureté y qu’i i avoit une grande entente i
i e la lumière 8c des couleurs 3 que fon coloris I
P Ë Ï
dans les jours eft Couvent digne du Titien' j
que fi la nature ne peut-être plus mal choi-
, * eü e ne peut aulïi “être mieux peinte. If
reumftbit très bien dans le portrait, parce que,,
dans ce g-çnre, il ne s’agit pas de ehoiür ,
mais d imiter. Le Pouflin difoit de ce“peintre
q u ü étoit venu pour détruire la peinture.
Malgré fes défauts, ou peut-êtréxpar la bizarrerie
de fes défauts , il fe fit une grande'
réputation.& balança celle des Gamelles. Sa
maniéré devint la mode régnante ; il falloir
s y foumettre pour réuffir. Le Valentin la fuivit
toujours. Elle pénétra même dans l ’école des'
Garraches, & malgré les fag.es confeih de ces-
maîtres, elle tnfeSa leurs éleves. Le Guercbin
ne 1 abandonna jamais ; fe Guide crut devoir'
quelque temps s’y conformer , lui que la nature'
appellent à un-e^ manière fi douce & fi fuave.-
J-e.Gm'avage étoit vain, jaloux, querelleur 1
infociab.'e. Le Jofepin étoit le'principal objet-
de la haine , parce que l’engouement des Ro-
mains le partageoit entr’eux. Caravage l’ao-
pella en d ue l; mais le Jofepin répondit qu’il'
ne vouloit pas fe battre avec un-homme qui-
netoit pas chevalier. Le Carrache appelle de’
meme fe tira d’affaire d’ une manière bouffonne ÿ
il lortit de fon attelier contre fon adverfaire è
tenant en main , au lien d’épée ,- une brolfe'
chargée de eouleurs.-
Le Caravage, dans un accès dé fureur, tuai
•in jeune homme de fes amis. Obligé de quitter
Rome, il chercha un afyle à Naples & y
tut occupé. Mais il étoit dévoré, du defir do'
devenir chevalier, foit pour n’écre pas humilié
par la décoration du Jofepin , foie pour être'
digne de le. mefurer avec lui. Il paffà à Malthe'
dans 1 efperance d’obtenir,- une croix de che-*
vaher fervant ; quelques tableaux qu’ il fit
pour le grand maître lui procurèrent cette ré-
compenfe.-
Mais avant de quitter cette f i é , fl vo’ulut
fe battre avec un chevalier & fut mis en prifon.
Il s’évada , erra quelque temps en Sicile ,.
pafla à Naples oü tl fut attaqué , & eut lé
vifage tailladé. Il revenoit à Rome lorfqu’il
fut enlevé par des Efpag.nols , qui le prirent
pour un homme qu’ ils cherchoient.- Relâché’
quand ils eurent reconnu leur erreur, & obli--
gé de voyager à pied par une chaleur excef-
five , il fut furpris d’une fièvre maligne dont
il mourut en léop , dans là quarantième an-*
fiée.
Cet homme jaloux ne put s’empêcher de dire .
quand Annibal Carrache vint à Rome : » j’"a|
» enfin trouvé de mon temps .un peintre ». .
Le cabinet du Roi renferme quatre tableaux
du Caravage. La mort de la Vierge eft l ’un
de ceux qu’ on réfuta de laiffer à la place à laquelle
il étoit deftiné. Il avoit été demandé
pour l’églife Délia Scala : c’eft à beaucoup
PE I
^égards l’un des plus beaux ouvrages du maî- ,
1 • Gn y trouve une belle conduite d’ombies
& de lumières , une rondeur & une force
jnerveilleufe : mais la figure de la Vierge parut
ignoble ; on crut voir le corps d une femme
noyée & l’on trouva le tableau indigne de la
jnajefté d’un temple." Ge n’eft pas le feul reproche
qu’on faite à cet ouvrage : la femme
afïife , ~la tête penchée , & couverte de fes
mains indique plutôt qu’elle ne montre une
belle expreflion de douleur ; mais dans plufieurs
autres figures , la trifteffe eft baffe au lieu d être
naturelle : on s’apperçoit dans la compofitiqn -
que l’auteur s’eft trouvé embarraffé d’avoir onze
figures à placer. La machine eft d’ un grand
effet , l.é pinceau eft fier 3 mais la couleur eft
dure , & les ombres font fi noires que Ve
premier coup - d’oeil eft rebutant. Le portrait
d’Adolphe de Vignaçourt , grand maître de
Malthe , ouvrage qui a procure a l’auteur la
croix de chevalier fervant, eft digne des plus
grands éloges. On n’a pas craint de le comparer
.au Titien pour la vérité , la force & la fua-
vitè de la couleur. I ,é tour de la figure principale
eft irapofant, l’ effet eft de la plus grande
fierté y la tête du grand maître & celle du
.page font admirables •, les acceffoires , tels"
que l’armure, le cafque^le panache font travaillés
âvec un grand art & une extrême vér
rité. Le tableau de la Bohémienne a un grand
mérite de couleur y mais il eft fur tout notable
par la vanité de l'auteur. £1 l’oppofoit à
ceux de Raphaël, & croyoit prouver par cet
^ouvrage qu’ il eft inutile d’étudier les chefs-
d’oeuvres de ce maître & des ftatuaires antiques.
Le portrait d’Adolphe de Vignacourt a été
gravé par Larmeflin qui n’en a pas fait con-
noître les beautés. S. Vallé a gravé la mort de
la Vierge •, Benoit Audran , la Bohémienne.
Ces ouvrages auroient demandé la pointe ou
le burin des graveurs formés par Rubens.
(84) Jean Lys appartient à l’école A lle mande
par fa naiffance à Oldenbourg , & à la
Flandre pour fon éducation , puifqu’ il fut élève
de Henri Goltzius. Sa. première manière fut
celle de fon maître 3 mais dans fes voyages
en Italie , il tâcha de fe rendre propre celle
,des maîtres Vénitiens. 11 s’apperçut trop tard
qu’ il n’ avoit pas fuivi la meilleure route , &
devenu admirateur de l’antique, il en recom-
mandoit fortement l ’étude à fes élèves, ajoutant
avec douleur qu’ il avoit paffé le temps
où il auroit pu firivre pour lui-même le con-
feil qu’ il leur donnoit.
Il peignoit en grand & en petit , & , dans
çes différentes proportions , fes tableaux étoient
également recherchés. Il montroit de l’ efprit
-jéans l’expreftion & dans la touche de fgs figu-
P E I 4?
res ; 11 leur donnoit des attitudes 8c des ajuftemens
gracieux, & plaifoit par la couleur
par la délicateffe du pinceau. Son payfage eft
bien entendu & bien traité. Il a fouvent peint
des mafearades , des fê te s , des concerts , &
mêloit quelquefois le coftume antique avec les
ajuftemens Vénitiens. Houbraken l’égale aux
plus grands maîtres. Son deftîn, dît M. Def-
camps , e ft quelquefois fort beau , fa couleur
toujours vigourèufe, fon pinceau moelleux &
fes compofitions pleines d’ efpric : heureux s ii
eût joint une meilleure conduite a fes taie 13s ,
8c s’ il> n’ eût pas partagé, fa vie entre la crapule
& l’art. Après avoir féjourné long-temps en
Flandre, il retourna à Venife 8c y mourut de
i la pefte èn 16x9.
J. Viffcher a gravé, d’après ce peintre' le ra-
! viffement de Saint Paul.
(85 ) Pierre ou Peter Néefs , de l’école
Flamande , né à Anvers., s’eft- acquis , dans
un genre inférieur, une très grande célébrité.
Elève de Stéenvick , il reprefenta des intérieurs
d’églifes gothiques. Plaçant avantageufement
tantôt un maufolée , tantôt un buffet d’orgues ,
il interrompoit l’ uniformité d’effet que doit
caufer une feule lumière dans un batiment
régulier, & rendoit piquant^ce qui menaçoit
d’être froid. C’eft ainfi qu’il n’eft aucun genre
qui ne puiffe recevoir un charme féduifanc
de la belle entente du clair-obfcur. I l luivit
d’abord la maniéré fombre de fon maître ; mais^
il fit dans la fuite des tableaux clairs , & ce
font les plus eftimés. A la bonne couleur, fes
tableaux joignent le mérite de la perfpeélive
aerienne : une vapeur dégradée y fait recule'r
les objets , marque leur degré de diftance.
Quand on trouve des figures dans-fes tableaux,
elles font d’une main étrangère. On ignore
l’année de fa naiffance & celle de fa mort.
(-86) Adam Elzheimer, de l’école A lle mande
, naquit à Francfort! en 1574* ^ e^
connu en Italie fous le nom du Tédefco : dire
qu’il fut eft i me dans cette patrie des arts ,
c’ eft faire fon éloge. Il eut pour père un tailleur
qui reconnoiflant dans fon fils une paiTion
violente pour la peinture , le plaça chez un
peintre eftimé que le jeune élève eut bientôt
furpaffé. Adam , ne pouvant plus trouver d’exemples
ni de leçons dans fa patrie, paffa en
I ta lie , & y fit des progrès rapides. I l peignit
en petit, donna le plus beau fini à fes ouvrag
e s , & fe distingua par une imitation fidelie
de la nature. Il avoit une mémoire fi heureufe
qu’ il lui fuffifoit de l’avoir examinée , pour la
copier avec une étonnante préeifion. Ce fut
ainfi qu’ il repréfenta de fouvènir la V illa M a -
dama : rien ne fut oublié, il rendit les arbres
& leurs foriuçs, & fans s’arrêter uniquement
F il