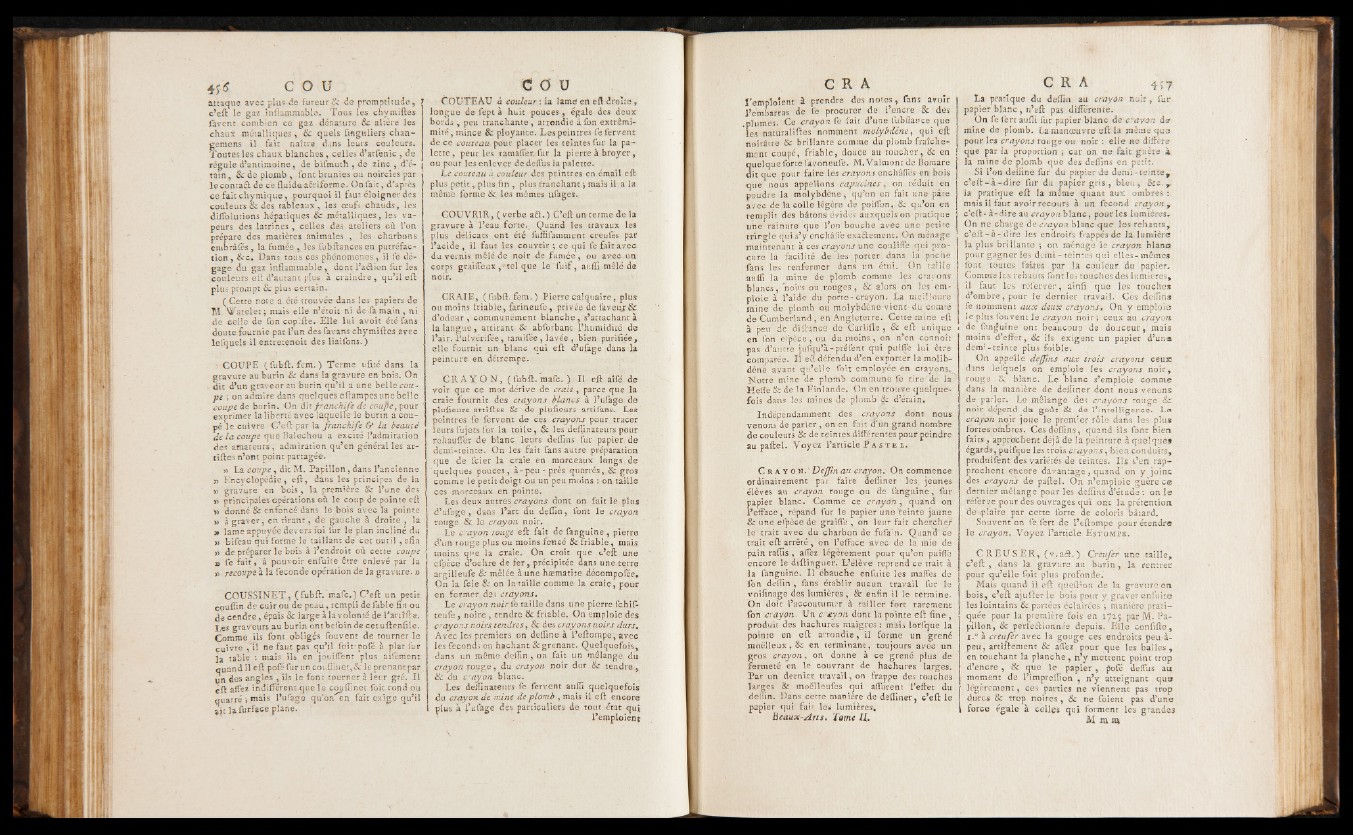
attaque avec plus de fureur & de promptitude, ;
c ’eft* le gaz inflammable. Tous les chymiftes
favent combien ce gaz dénature & altère les
chaux métalliques , & quels fvnguliers chan-
gemens il fait naître dans leurs couleurs.
Toutes les chaux blanches, celles d’arfenic , de
régule d’antimoine, de bifmuth , de zinc , d’é- i
tain, & de plomb , font brunies ou noircies par
le contact de c'e fluida-acriforme. On fait, diaprés
ce fait chymique, pourquoi il faut éloigner des
couleurs & des tableaux, les oeufs chauds, les
diffolutions hépatiques & métalliques,.les vapeurs
des latrines, celles des ateliers où. l’on
prépare des matières animales , les-charbons
embrâfés, la fumée , les fub(tances en putréfaction
, & c . Dans tous ces phénomènes , il fè dégage
du gaz inflammable , dont l’ aétion fur les
couleurs e il d’autan c plus à craindre, qu’il eil
plus prompt & plus certain.
(C e tte note a été trouvée dans les papiers de
M. XTatelet ; mais elle n’étoit ni de fa main, ni
de celle de fon coplfte. Elle lui avoit été fans
doute fournie par l’un des favans chymiftes'avec
lefquels il entretenoit des liaifons.)
COUPE ( fubft. fern. ) Terme uftté dans la
gravure au burin & dans la gravure en bois. On
dit d’un graveur au burin qu’ il a une belle coupe
-, on admire dans quelques eftampes une belle
coupe de burin. On dii franchi f e de coupe, pour
exprimer la liberté avec laquelle le burin a cou-,
pé le cuivre G’eft par la franchife G* la beauté
de la coupe que Balechou a excité l’admiration
des amateurs , admiration qu’ en général les ar-
tiftes n’ont point partagée.
» La coupe, dit M. Papillon, dans l ’ancienne
» Encyclopédie , eft, dans les principes de la
» gravure en b ois , la première & l’une des
» principales opérations ©ù lé coup de pointe eft
donné & enfoncé dans le bois avec la pointe
» à graver, en tirant, de gauche à droite , la
9 lame appuyée devers foi fur le plan incliné du
» bifeau qui forme le taillant de' cet outil , 2(in
» de préparer le bois à l’ endroit où cette cou pe .
» fe fa it , à pouvoir enfuite être enlevé par la
» recoupe à la fécondé opération de la gravure. »
CO U SS IN E T , (fubft. mafe.) C’ eft un petit
coufîin de cuir ou de peau, rempli de fable fin ou
fle cendre, épais & large à la volonté de l’arcîfte.
Les graveurs au burin ontbefoin de cet uftenfile.
Commeyils font obligés fouvent de tourner le
çuivre ,Tl ne faut pas qu’ il foirpofé à plat fur
la table : mais ils en jouiffent plus aifément
quand il eft pofé fur un couflinet,& le prenant par
un des angles , ils le font tourner à leur gré. Il
eft âflez indifférent que le couflinet foit rond ou
quarre i mais l’ufage qu’on en fait exige qu’il
ait la furrace plane.
COUTEAU à couleur : la lame eft eft droite,
longue de fept à huit pouces, égale des deux
bords , peu tranchante, arrondie âfon extrêmi-
mité, mince & ployante. Les peintres fe fervent
de ce couteau pour placer les teintes fur la pale
t te , peur les ramaffer/fur la pierre à broyer,
ou pour les enlever dedeffusla palette.
Le couteau à couleur des peintres en émail eft
plus petit, plus fin , plus tranchant ; mais il a la
mêm'e forme & les mêmes ufages.
COUVRIR, ( verbe a61.) C’ eft un terme de la
gravure à l ’ eau forte. Quand les travaux les
plus délicats ont été fuffifamment creufés par
l’acide, il faut les couvrir; ce qui fe fait avec
du vernis mêlé de noir de fumée, ou avec un
corps graiffeux ,**el que le Tu i f , aufli mêlé de
noir.
CRAIE, (fubft. fem.) Pierre calquai r e , plus
ou moins friable, farineufe, privée de faveur &
d’odeur, communément blanche, s’attachant à
la langue, attirant & abforbant l’humidité de
l ’air. Pulvérifée, tamifée , lavée , bien purifiée,
elle fournit un blanc qui eft d’ ufàge dans la
peinture en détrempe.
C R A Y O N , ( fubft. mafe.) Il eft aifé de
voir que ce mot dérive de craie, parce que la
craie fournit des crayons blancs à l’ ufage de
pluüeurs artiftes & de plufieurs artifans. Les
peintres fe fervent de ces crayons pour tracer
leurs fujets fur la to ile , & les deffinateurs pour
rehauffer de blanc leurs deflins fur papier de
demi-teinte. On les fait fans autre préparation
que de feier la craie en morceaux longs. de
quelques pouces, à-peu - près qu-arrés, & gros
comme le petit doigt du un peu moins : on taille
ces morceaux en pointe. - . •
Les deux autres crayons dont on fait le plus
d’ ufage , dans l ’art du dçflin, font le crayon
rouge & le crayon noir.
Le crayon rouge eft fait de fanguine, pierre
d’un rouge plus ou moins foncé & friable, mais
moins que la craie. On croit que c’eft une
efpèce d’ochre de fe r , précipitée dans une terre
argilleufe & mêlée à une hæmatite décompofce.
On la feie & on læ rai lie comme la craie, pour
en former des crayons.
Le crayon noir fe taille dans une pierre fehif-
treufe, noire , tendre & friable. On emploie des
crayons noirs tendres, & des crayons noirs durs.
Avec les premiers on delïïne à l’eftompe, avec
les féconds en hachant &grenant. Quelquefois,
dans un même deffin, on fait un mélange du
crayon rouge, du crayon noir dur & tendre,,.
ik du crayon blanc.
Les deffinateurs fe fervent aufli quelquefois
du crayon de mine de plomb , mais il eft encore
plus à l’ ufage des particuliers de tout état qui
l’emploient
Tempîoîent à prendre des no ie s , fans avoir
l ’embarras de fe procurer de l’encre & des
.plumes. Ce crayon fe fait d’une fubftance que
les naturaliftes nomment molybdène, qui eft
noirâtre &: brillante’ comme du plomb fraîchement
coupé, friable, douce au toucher, & en
uelque forte favoneufe. M.Valmont de Bomare
it que pour faire les crayons enchâffés en bois
que nous appelions capucines, on réduit en
poudre la molybdène, qu’on en fait une pâte
avec de la colle légère de poiffon, 8c qu’on en
remplit des bâtons évidés auxquels on pratique
une rainure que l ’on bouche avec une petite
tringle qui s’y enchâffe exaélement. On ménage
maintenant à c es crayons une cou lifte qui procure
la facilité de .les porter dans la poche,
fans les renfermer dans un étui. On taille
aufiî la mine de plomb comme les crayons
blancs, noirs ou rouges, & alors on les emploie
à l’aide du porte-crayon. La meilleure
mine de plomb ou molybdène vient-du comté
de Cumberland , en Angleterre. Cette mine eft
à peu de diftance de Carlifle , & eft unique
en fon efpèce, ou du moins, on n’en connoît
pas d’antre jufqu’à-prélent qui puiffe lui être
comparée. Il eft défendu d’en exporter la molib-
dèrie avant qu’elle foit employée en crayons..
Notre mine de plomb commune fe tire de la
Heffe | | de la Finlande. On en trouve quelquefois
dans les mines de plomb &: d’étain.
Indépendamment des crayons dont nous
venons de parler , on en Tait d’un grand nombre
de couleurs & de teintek différentes pour peindre
au paftel. Voyez l’article P a s t e l .
C r a y o n . Deffin au crayon. On commence
ordinairement par faire aefliner les. jeunes
élèves au crayon rouge ou de fanguine, fur
papier blanc. Comme ce crayon, quand on
l’efface, répand fur le papier une Peinte jaune
& une efpèce de graifte , on leur fait chercher
le trait avec du charbon de fufain. Quand ce
trait eft arrêté, on l’efface avec de la mie de
pain radis , aflez légèrement pour qu’on puiffe
encore le diftinguer. L’élève reprend ce trait à
la fanguine. I l ébauche enfuite les maffes de
Ton deftin , fans établir aucun travail fur le
voifinage des lumières , & enfin il le termine.
On doit l’accoutumer à tailler fort rarement
fon crayon. Un crayon dont la pointe eft fine ,
produit des hachures maigres : mais lorfque la
pointe en eft arrondie, il forme un grené
moelleux, & en terminant, toujours avec un
gros crayon, on donne à ce grené plus de
fermeté en le couvrant de hachures larges.
Par un dernier travail, on frappe des touches
larges & tnoëlleufes qui affûtent l ’effet du
defiin. Dans cette maniéré de defliner, c ’eft le
papier qui fait les lumières.
Beaux-Art s. Tome IL
La pratique du deffin au crayon noir, fur
papier blanc, n’ eft pas différente.
On fe fert auffi fur papier blanc de crayon de?
mine de plomb. La manoeuvre eft la même que
pour les crayons rouge ou noir : elle ne diffère
que par la proportion ; car on ne fait guère à
la mine de plomb que des deflins en petit.
Si l’on deffine fur du papier de demi -teinte^
c’e f t -à -d ir e fur du papier gris , b leu, & c . y
la pratique eft la même quant aux ombres :
mais il faut avoir recours à un fécond crayon y
c’eft - à-dire au crayon blanc, pour les lumières*
On ne charge de crayon blanc q,ue les rehauts,
c’ e ft- à -d ire les endroifs frappés de la lumière
la plus brillante ; on ménage le crayon blanc
pour gagner les demi - teintes qui elles - mêmes
font toutes faites par la couleur du papier.
Comme les rehauts font les touches des lumières,
U faut les -réferver, ainfi que les touches
d’ombre, pour le dernier travail. Ces deffins
fe nomment aux deux crayons. On y emploie
le plus iouvent le crayon noir ; ceux au crayon
de fanguine ont beaucoup de douceur, mais
moins d’effet, & ils exigent un papier d’une
demi - teince plus foible.
On appelle dejjins aux trois crayons ceux
dans lefquels on emploie les crayons noir,
rouge ik blanc. Le blanc s’emploie comme
dans la manière de deffiner dont nous venons
de-parler. Le mélange des crayons ro u g è '&
noir dépend, du goût & de l’ intelligence. Le
crayon noir joue le premier rôle dans les plus
forces ombres. Ces deflins, quand ils font bien
faits, approchent déjà de la peinture à quelque»
égards, puifque les trois crayons, bien conduits,
produifent des variétés de teintes. Us s’ en rapprochent
encore davantage , quand on y joint
des crayons de paftel. On n’ emploie guère ce
dernier mélange pour les deflins d’étude : on le
réferve pour des ouvrages qui ont la prétention
de-,.plaîre par cette forte de coloris bâtard.
Souvent on fe fert de l’ eftompe pour étendre
le crayon. Voyez l’article Estompe.
C R E U S E R , ( v.aét. ) Creiifcr une taille,
c’eft , ( dans la gravure au burin , la rentrer
pour qu’elle (bit plus profonde.
Mais quand il eft que fl ion de la gravure en
bois, c’eft aju(ter Le bois pour y graver enfuite
les lointains & portées éclairées ; manière pratiquée
pour la première fois en 1725 par M. Papillon,
& pé'rfe&ionnée depuis. Elle confifte,
i.° à creufer avec la gouge ces endroits peu-à-
peu, artiftement & affez pour que les b a lle s ,
en touchant la planche , n’ y mettent point trop
d’ en c re , & que le papier , pofé deffus au
moment de l’impreflion , n’ y atteignant qu»
légèrement, ces parties ne viennent pas trop
dures & trop noires, & ne foienc pas d’une
force égale à celles qui forment les grandes
M m m