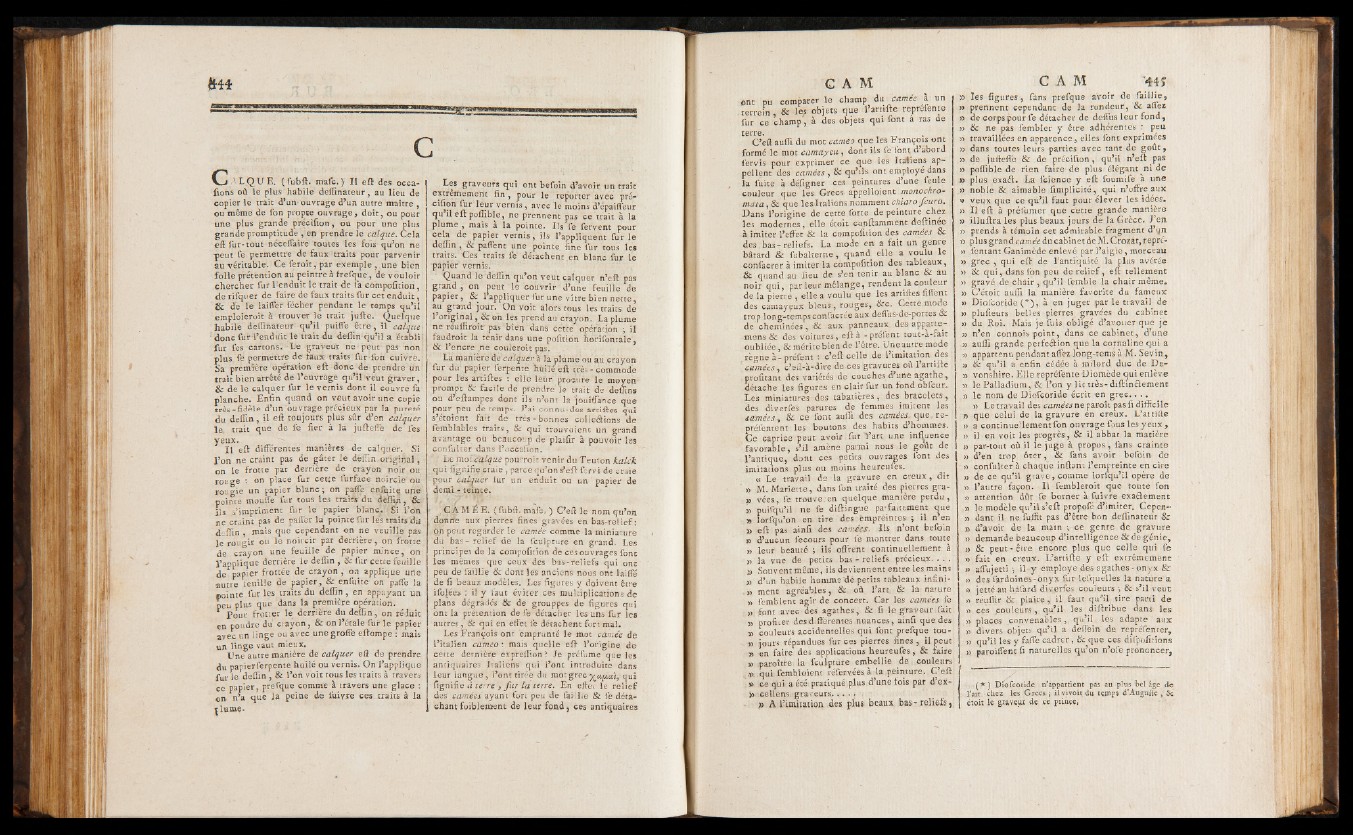
ïSjgffaæiæsS
c
C i 'L Q U E . (fubft. mafc. ) I l eft des occa-
fions où le plus habile defiinateur, au lieu de
copier le trait d’ un ouvragé d’un autre maître ,
ou même de fon propxe ouvrage, doit, ou pour
une plus grande précîfion, ou pour une plus
grande promptitude ,’en prendre le calque. Cela
eft fur-tout néceffaire'toutes les fois qu’on ne
■ peut Ce permettre de faux traits pour parvenir
au véritable. Ce feroitH par exemple , une bien
fo lle prétèntion au peintre à frefque, de vouloir
chercher fur 1-enduit le trait de fa compofition,
de rifquer de faire de faux traits fur cet enduit,
& de le laifler fécher pendant le temps qu’ il
emploieroit à trouver le trait jufte. Quelque
habile dèfiinateur qu’ il puiffe ê tr e , il calque'
donc fui: l’ enduit le trait du deffin qu’ il a établi'
fur fes cartons.-! Le graveur ne- peut pas non!
plus, fe permettre de faux traits fur-fon cuivré.;
Sa première opération eft donc de prendre un1
trait bien afrêté de l’ ouvrage qu’ il-veut graver,
& de le calquer fur le vernis dont il couvre fa
planche. Enfin quand on veut avoir une copie
très-fidèle d’un ouvrage précieux par la pureté
du deffin, il eft toujours plus sûr d’en calquer
le, trait que de fe fier à la juftefle de fes
veux.
I l eft différentes manières de calquer. Si
l ’on ne craint pas de gâter le dêffin original,
on le frotte par derrière de crayon' noir ou
ronge : on place fur cetie furface noircie ou
rougie un papier blanc; on pâlie cnfuite une
pointe moufle fur tous les traits du dèlEp, &
ils s’ impriment fur le papier blancy Si l ’on
ne craint pas de paffer là poinre fur les traits du
deffin , mais que cependant on ne veuille pas
le rougir ou le noircir par derrière, on frotte
de crayon une feuille de papier mince, on
l ’applique derrière le deffin , & fur cette feuille
de papier frottée de crayon , on applique une
autre feuille de papier, & enfuite on palfe la
«ointe fur les traits du deffin, en appuyant un
peu plus que dans la première opération.
- Pour frotter le derrière du deffin, on réduit
en poudre du crayon, & on l’étale fur le papier
avec un linge ou avec une groffe eftompe : mais
un linge vaut mieux.
Une autre manière de calquer eft de prendre
du papierferpente huilé ou vernis. On l’applique
fur le deffin , & l’on voit tous les traits à travers
ce papier, prefque commé à travers une glace :
on n’ a que la peine de iiiiyjre ces-traits à la
jlume.
Les graveurs qui ont befoin d’avoir un trait
extrêmement fin , pour le reporter avec pré»
cifion fur leur vernis, avec le moins d’épaiffeur
qu il eft poffible, ne prennent pas ce trait à la
plume , mais a la pointe. Us fe fervent pour
cela de papier vernis, ils l ’appliquent fur le
deffin , & paflènt une pointe fine fur tous les
traits. Ces traits fe détachent en blanc fur le
papier vernis;'
. Quand le deffin qu’on veut calquer n’eft pas
grand, on peut le couvrir d’une feuille de
papier, & 1 appliquer fur une vitre bien nette,
au grand joiir. Ort voit alors tous les traits de
l’original, & on les prend au crayon. La plume
neréuffiroir pas bien dans cette opération ; il
faudroic la tenir dans une pofition horifontale,
& l’encre rne couieroit pas.
La maniéré de'calquer k la plunie ou au crayon
fur du1 papier ferpente huilé eft très-commode
pour .lès artiftes : ellé leür procure le moyen
prompt & facile dé prendre le trait de deflins
ou d eftampes donc ils n’ont la jouifîance que
pour peu de temps. J’ ai connu»des arciftes qui
s’étoient fait de très-bonnes colleaions de
femblables traits, & qui trouvoienc un grand
avantage ou beaucoup de plaifir â pouvoir les
confulter dans l’occafion.
' ; Le mot calque pourroit venir du Teuton kalck
qui fignifiecrale, parcequ’ons’eft fervi de craie
pour calquer fur un enduit ou un papier de
demL-lteiqte. '
C A M É E . ( fubft. mafc> ) C’ eft le nom qu’on
donrfe aux pierres fines gravées en bas-relief:
on peut regarder le camée comme la miniature
du b a s -re lie f de la fculpture en grand. Les
principes de la compofition de ces ouvrages font
les mêmes que ceux des bas-reliefs qui,ont
peu de faillie & dont les anciens nous ont laiffe
de fi beaux modèles. Les figures y doivent être
ifolées : il y faut éviter ces multiplications de
plans dégradés & de grouppes de figures qui
ont la prétention de fe détacher les uns fur les
autres, & qui en effet fe détachent fort mal.
Les François ont emprunté le mot camée de
l’ itajien cameo.: mais quelle eft l’origine de
cette dernièr^ exprelfion? Je préfume que les
antiquaires Italiens qui l’ont introduite dans
leur langue, l’ont tirée du mot grec qui
lignifie à terre , fur la terre. En elfec le relief
des' camées ayant fort peu de faillie & fe détachant
faiblement de leur fond, ces antiquaires
ont pu comparer le champ du camée à un
.terrain, & les objets que l’artifte reprefente
fur ce champ, à des objets qui font a ras de
terre. • " ' _
C’ eft auffi du mot cameo que les François ont
formé le mot camay eu , dont ils fe font d’abord
fervis pour exprimer ce que les Italiens appellent
des camées, & qu’ ils ont employé dans
la fuite à défigner ces peintures d’une feule
couleur que les Grecs- appelloient monochro-
mata, & que les/Italiens nomment chiarofcuro.
Dans l’origine de cette forte de peinture chez
les modernes, elle étoit copftamment deftinee
à imiter l’ effet & la compofition des camées &
des, bas-reliefs. La mode en a fait un g.enrë
bâtard & fubalterne, quand elle a voulu le
confacrer à imiter la compofition des tableaux,
& quand au lieu de s’ en tenir au blanc & au
noir qui, par leur mélange, rendent la couleur
de la pierre , elle a voulu que les artiftes fiffent
des camaypux bleus , rouges, & c . Cette mode
trop long-temps confacrée aux deffus-de-portes &
de cheminées, & aux panneaux des apparte-
xnens & des voitures , eft a -prefënt tout-a-fait
oubliée , & mérite bien de l’être. Une autre mode
règne à-préfent : c’eft celle de l’ imitation des
camées y c’eft-à-dire de ces gravures où l’artifte
profitant des variétés de couches d’une agathe ,
détache les figures en clair fur un fondobfcur..
Les miniatures des tabatières, des bracelets,
des diverfés parures de femmes imitent les
camées, & ce font auffi des camées, que.re-
prélentent les boutons des habits d’hommes.
Ce caprice peut avoir. fur Tart une influence
favorable, s’ il amène parmi nous le goût de
l ’antique, dont ces petits ouvrages l’ont des
imitations plus ou moins heureufes.
a Le travail de la gravure en creux, dit
' » M. Mariette, dans fon traité des pierres gra-
» vées, fe trouve.en quelque maniéré perdu,
» puifqu’ il ne fe diftingue parfaitement que
» lorfqu’on en tire des ëmpréintes ; il n’en
» eft pas ainfi des camées. Us n’ont befom
» d’aucun fecours pour le montrer dans toute
» leur' beauté ; ils offrent continuellement à
» la vue de petits bas-reliefs précieux- • • .
» Souventmême, ils deviennent entre les mains
» d’ un habile homme 'dé petits tableaux infini-
. » ment agréables,, & où l ’art & la nature
» femblent agir de concert. Car les camées fe
» font avec des agathes, & fi le graveur .fait
» profiter des différentes nuances, ainfi que des
» couleurs accidentelles qui font prefque tou-
» jours répandues fur ces pierres fines , il peut
» en faire des applications heureufes, & faire
» ;paroîtfe la fculpture embellie de couleurs
.» qui fembloient réferv.ées à la .peinture. C’eft:
» ce qui a été pratiqué plus d’une fois par d’ex-
» cellens. graveurs.. . . . .
- A l’imitation des plus beaux bas-reliefs,
» les figures, fans prefque avoir de faillie ,
» prennent cependant de la rondeur, & affez
» de corps pour fe détacher de deflus leur fond,
» & ne pas femblcr y être adhérentes : peu
» travaillées en apparence, elles font exprimées
» dans toutes leurs parties avec tant de g oû t,
» de juftefle & de précifion, qu’ il n’eft pas
» poffible de rien faire de plus élégant ni de
» plus exaét. La fcience y eft foumife à une
» noble & aimable (implicite, qui n’offre aux
v veux que ce qu’ il faut pour élever les idées.
» Il eft à préfumer quê cette grande manière
» illuftra les plus beaux jours de la Grèce. J’en
» prends à témoin cet admirable fragment d’un
» plus grand camée du cabinet de M. Crozât, repré-
» Tentant Ganimède enlevé par l’ aigle, morceau
» grec , qui eft de l ’antiquité la plus avérée
» & qui, dans fon peu de re lie f, eft tellement
» gravé de chair , qu’ il femble la chair même.
» C’étoit auffi la manière, favorite du fameux
» Diofcoride ( * ) , à en juger par le travail de
» plufieurs belles pierres gravées du cabinet
» du Roi. Mais je luis obligé d’avouer que je
» n’ en connois point, dans ce cabinet, d’ une
-» auffi grande perfeérion que la cornaline qui a
» appartenu pendant affez long-tems à M. Sevin,
» & qu’ il a enfin céd.ée à milord duc de De-
» vonshire. Elle repréfente Diomède qui enlève
» le Palladium, & l’on y lit très-diftinélement
» le nom de Diofcoride écrit en g re c .. . .
» Le travail des camées ne paroît pas fi difficile
» que celui de la gravure en creux. L’airifte
» a continuellement fon ouvrage fous les yeux ,
» il en voit les progrès, & il abbat la matière
» par-tout où il le juge à propos , fans crainte
j » d’en trop ô te r , & fans avoir befoin de
» confulter à chaque inftarn l’ empreinte en cire
» de ce qu’ il grave, comme iorfqu’ îl opère de
» l’autre façon. U fembleroit que toute fon
» attention dût fe borner à Cuivre exactement
>3 le modèle qu’ il s’eft propofé d’ imiter; Cepen-
» aant il ne fuffit pas d’être bon defiinateur &
» d’avoir de la main -, ce genre de gravure
5) demande beaucoup d?intelligence & d e génie,
» & pe.ut-être encore plus que celle qui fe
» fait en creux. L’artifte y eft extrêmement
» aflujetti -, il y employé des agathes - onyx &
» des l'ardoines-dnyx fur lesquelles la nature a
» jetté au hàfard diverfes couleurs ; & s’ il veut
» réuffir & plaire, il faut qu’i l : tire parti de
» ces couleurs, qu’ il les diftribue dans les
» places convenables, qu’ il, les adapte aux
» divers objets qu’ il a deffèin de repréfenter,
» qu’il les y faffe cadrer, & que ces difpoiïtions
» paroiffent fi naturelles qu’ on n’ofe prononcer,
: ( * ) Diofcoride n’appartient pas au plus bel âge de
l’ait.-chez les .Grecs ; i l vivoit du temps d’Augufte , &
étoit le graveur de ce prince,