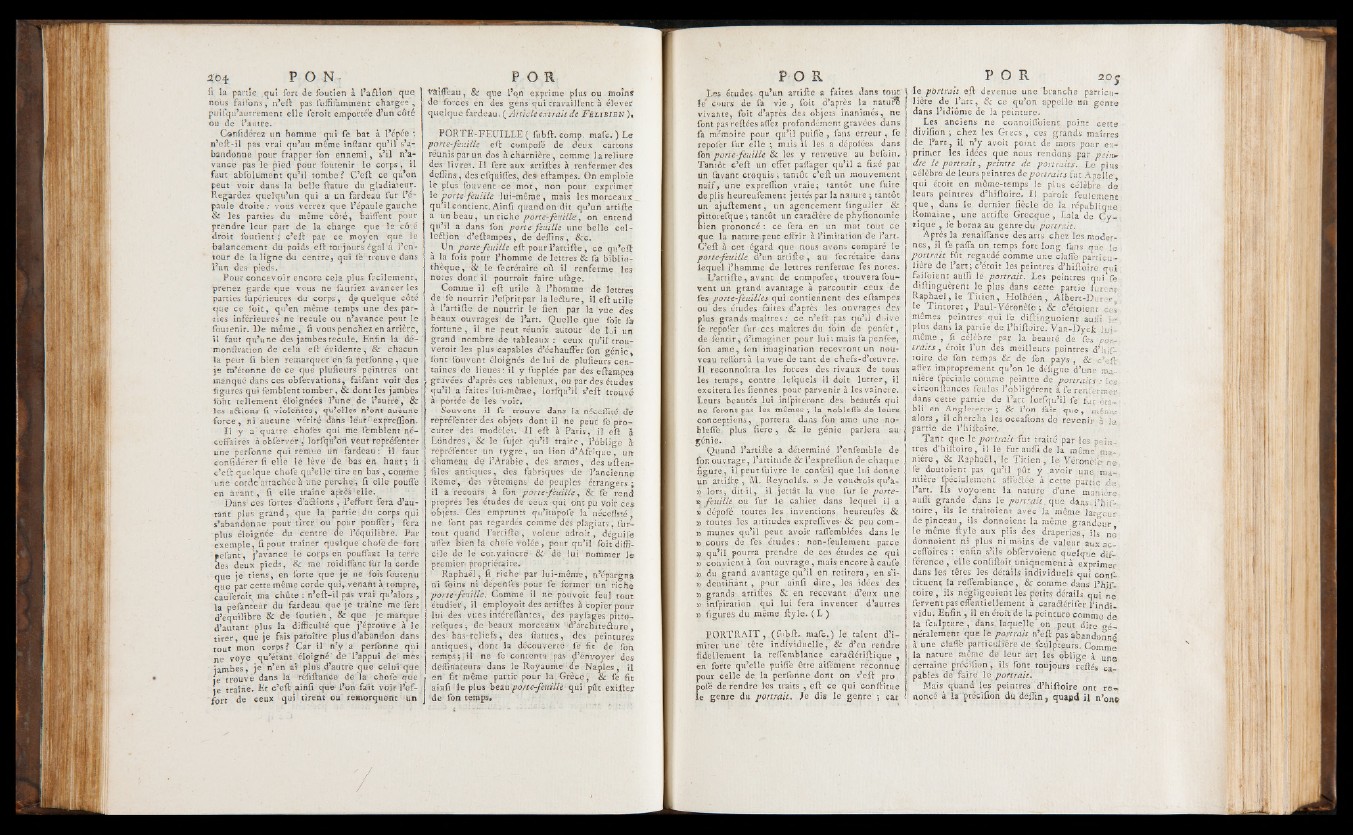
fi la partie qui fort de foutîen à l’aélion que
nous raifons, n’eft pas fuffifamment chargée , ;
puifqu’autrement elle feroit emportée d’un côté
ou de l’autre.
Cenfidérez un homme qui fe bat à l’épée :
n’efl-il pas vrai qu’au môme inftant qu’ il s’ abandonne
pour frapper fon ennemi, s’ il n’a-
vancè pas le pied pour foutenir le corps , il
faut abfolument qu’ il tombe ? C ’eft cè qu’ on
peut voir dans la belle ftatue du gladiateur.
Regardez quelqu’ un qui a un fardeau fur l’épaule
droite : vous verrez que l’épaule gauche
& les parties du même côté, baillent pour
prendre leur part de la charge que le cô'.é
droit foutient j c’eft par ce moyen que le
balancement du poids eft toujours égaî'à l’entour
de la ligne du centre, qui le trouve dans
l ’un dés pieds.
Pour concevoir encore cela plus facilement,
prenez garde que vous ne fauriez avancer les
parties ihpérieures du corps, de quelque côté
que ce fo it, qu’en même temps une des parties
inférieures ne recule ou n’ avance pour le
foutenir. De même, fi vous penchez en arrière,
il faut qu’ une des jambes recule. Enfin la dé-
monftration de cela eft évidente-; & chacun
la peut fi bien remarquer en fa perfonne , que
je m’étonne de ce que plufieurs peintres ont
manqué dans ces obfervations, faifant voir des
figures qui femblent tomber, & dont les jambfes '
font tellement éloignées l’une de l’ âucfè, &
les aélions- fi violentes; qu’elles n’ont aucune
fo rc e , ni aucune ;vérité dàns léurr expreflion.
Il y a : quatre choies qui nie femblent qé-
ccffaires à obfervér;,' lorfqu’ori veur reprefentèr
une perfonne qui remué un fardeau: il faut
confidérer fi elle lé lève de bas en. haut; fi
c’eft quelque chofe qu’elle'tire en bas , comme
une corde attachée à une pérc-hçi; fi elle pouffe
en avant, fi elle traîne apres3 elle ._
Dans ces fortes d’actions j-l’ effort fera d’autant
plus grand, que la partie: du- corps qui
s’abandonne pouf tirer ou pour pouffer, fera
plus éloignée du centre de l ’équilibre. Par
exemple, fi pour traîner quelque chofe de fort
•efanr, j’avance lé corps en pouffant la terre
des deux pieds, 8c mè roidiffant fur la corde
que je tiens, en forte que je" në fois foutenu
que par cette même corde qui,menant à rompre,
cauferoit ma chûte : n’eft-il pas vrai qu?alors ,
la pefanteùr du fardeau que je traîne me left
d’équilibre & de foutien , & que je marque
d’autant plus la difficulté què j’éprouve à le,
tirer, que je fais paraître plus d’abandon dans
tout mon corps f Car il n’y a perfonne qui
ne voye qu’étant éloigné'de l ’appui dermes:
jambes, je n’ en ai plus d’autre que celuî'que
îe trouvé dans la réfiftariée d e là chofe- que (
ie traîne. Et c’eft ainfi qüe- l’on fait VciipPef-'
fort de ceux qui tirent ou remorquant un
Vâiffeau, & que l’on exprime plus ou moins
de forces en dés gens qui travaillent à élever
quelque fardeau. { Articleextrait de F é l i b i e n )«
PÔRTE-FEUILLE ( fubft. comp. mafc. ) Le
porte-feuille eft compofé de deux cartons
réunis par un dos à charnière, comme la reliure
des liv re s . Il fert aux artiftes à renfermer des
dçfiins, desefquiffes, de» eftampes. On emploie
le plus fouvent ce mot, non pour exprimer
1 e porte feuille lui-même, mais les morceaux_
qu’ iLcontient. Ainfi quand on dit qu’ un artifte
a un beau, un riche porte-feuille, on entend
qu’ il a dans fon porte feuille une belle col-
leéljon d’eftampes, de deflins, &rc.
Un porte feuille eft pour l’artifte, -ce qu’eft
à la fois pour l’homme de lettres & fa bibliothèque,
& l e feçrétaire où il renferme les
notes dont il pourrait faire ufage.
Comme il eft utile à l’homme de lettres
de l e nourrir l’efpritpar laleéture, il eft utile
à l’artifte de nourrir le fien par la vue des
| bèaux ouvrages de l ’art. Quelle que foit fa
fortune,, il ne peut réunir autour de îdi un
grand nombre de tableaux : ceux qu’il trouverait
les plus capables d’échauffer fon génie,
i font fouvent éloignés de lui de plufieurs cen-
j taines de lieues: il y fupplée par des eftampes
\ gravées d’après ces tableaux, ou par des études
'q u ’ il a faites lui-même, lorfqu’ il s’eft trouvé
I à portée de les voir.
Souvent il fe trouve dans la nécefiïté. de
1 repréfenter des objets dont il ne peut ie procurer
des modèles. Il eft à Paris, il eft â
Londres; & le fujet qu’ il traire , 5 l’oblige h
'repréfenter un ty g rê , un lion d’Afrique, un
! ‘chameau de l’Arabie , des armes, des uftenfiles
antiques, des fabriques de . l’ ancienne
Rome, des vêtemens de'peuples étrangers ;
il a recours à fon porte-feuille, & fe rend
proprés les études dé ceux qui orrt pu volt* ces
objets. Ces emprunts qu’impofe la nécefîtté,
ne font pas regardés comme dés plagiats, fur-
tout quand l’a rtifte, voleur adroit , déguife
'affez bien la choie volée, pour qu’il foit difficile
d e 'le cpi.yaincré &• de lui nommer le
premier« propriétaire^
Raphaël ; fî riche- par lui-mêmle , n’épargna
ni foins ni dépenfe's pour ïej former un riche
porte-feuille. Comme il ne pouvoir feul tout
étudier , il employoit des artiftes à copier pour
lui des vues inféreffantes', des paylàges’pitto-
refques-, de-b eaux morceaux lja’archite<ftiire,
des' bas-reliefs, des ftatués, des peintures
antiques ; dont la découverte'le fit de fon
temps;!il ne -fe contenta pas d’envoyer des
defliriàteurs dans le Royaume1 de Naples, il
i-en fit même partir pour la Grèce; & fe fit
ainfi Te plus beau porte-f&ùillë qui pût exifter
de fon temps*
\ le portrait eft devenue une 'branche particulière
Les études • qu’ un artifte a faîtes dans tout I
îe' èours de fa vie , foit d’après la natu?S
vivante, foit d’après des objets inanimés, ne
font pas reliées affez profondément gravées dans
fa mémoire pour qu’ il puiffe , fans erreur , fe
repofer fur elle ; mais il les a dépotées dans
fon porte feuille & les y retrouve au beloin.
Tantôt c’eft un effet paffager qu’il a fixé par
lin lavant croquis ; tantôt c’eft un mouvement
naïf, une expreflion vraie; tantôt une fuite
de plis heureufement jettes par la nature ; tantôt
un ajuftement, un agencement lingulier &
plttorefque ; tantôt un caraSère de phyfionomie
bien prononcé : ce fera en un mot tout ce
que la nature peut offrir à l’imitation de l’art.
C’eft à cet égard que nous avons comparé le
portefeuille d’ un artifte , au feçrétaire dans
lequel l’hemme de lettres renferme fes notes.
L’artiftë , avant de compofer, trouvera fouvent
un grand avantage à parcourir ceux de
les porte-feuilles qui contiennent des eftampes
ou des études faites .d’après les ouvrages des
plus grands'maîtres : ce n’eft pas qu’il doive
fe repofer fur ces maîtres du foin de penfer,
de léntir,, d’imaginer pour lui; mais fa pènfée,
fon ame, Ion: imagination recevront un nouveau
réffortà la vue de tant de chefs-d’oeuvre.
U reconnoîtra lés forces des rivaux de tous
les temps, contre lefquels il doit lutter, il
excitera les fiennes pour parvenir à les vaincre.
Leurs bçautés lu i infpireront des beautés qui
ne feront pas les mêmes ; la nobleffe de leurs-
conceptions, portera dans fo^i ame une nobleffe.
plus fiè re , & le génie parlera au
génie*!!
Quand l’artifte a déterminé l’enfeinble de;
fon ouvrage, l’attitude & l’expreftion de chaque
figure., il peut fuiv.re le confeil que lui donne
un artifte , M. Reynolds. >5 Je voudrais qu’ a-
» lors; ait-il, .il jettât la vue fur le porte-
» feuille ou fur le cahier dans lequel il a
» dépofé toutes les inventions heureules &
» toutes les attitudes expreflives- & peu com-
» munes qu’ il peut avoir raffembiées dans le
» cours de fes .études: non-feulement parce
» qu’ il pourra prendre de ces études ce qui
» convient à fon ouvrage , mais encore à caufe
» du grand avantage qu’ il en retirera, en s’i-
» demifiânt , pour ainfi dire, les idées des
» grands artiftes 8c en recevant d’eux une
» infpiration qui lui fera inventer d’autres
» figures du même ftyle. ( L )
PORTRAIT , .(fi'bft. mafc.) lé talent d’imiter
une tête individuelle,' & d’ en rendre
fidellement la reffemblance cara&érîftique ,
èn forte qu’elle puiffe être aifément reconnue
pour celle de la perfonne dont on s*eft pro
pofé de rendre les traits , eft ce qui conftitue
le genre du portrait* Je dis le genre ; car <
de l ’ar t, & ce qu’on appelle un genre
dans l’idiôme de la peinture.
Les anciens ne connoiffoient point cette
divifion ; chez les Grecs , ces grands maîtres
de l9a r t, il n’ y avoit point de mots pour exprimer
les idées que nous rendons par peiivr
dre le portrait, peintre de portraits. Le plus
célèbre de leurs peintres de portraits tut. À p e ile ,
qui étoit en même-temps le plus célèbre de
leurs peintres d’ hiftoire. Il paraît feulement
q ue , dans le dernier fiècle de la république
Romaine, une artifte Grecque , Lala de Ç y - ]
zique , fe borna au genre du portrait.
Après la renaiffance des arts chez les moder nes,
il fe paffa un temps fort long fans que îe
portrait fût regardé comme une claffe particulière
de l’art; c’étoit les peintres d’hiftoire qui
faifoient aulfi le portrait. Les peintres qui fe
diftinguèrent le plus dans cette partie furent
Raphaël, le T itien , Holbéen , Albert-Dure«-
le Tintoret, Paul-Vérbnèlé ; & c’étoient ces
mêmes peintres qiii fe diftinguoient auili 1er ,
plus dans la partie de l’ hiftoiré. Van-Dyclc lui-
même , fi célèbre; par la beauté de fes 'p o r traits
^ étoit l’un des meilleurs peintres d’hiftoire
de fon temps & de fon pays , & c’eft:
affez improprement qu’on le défigne d’une manière
fpéciale comme peintre de portraits : les,
circonftances feules l’obligèrent à fe renfermer
dans cette partie de l’art lorfqu’ il fe fat éta- *
bli en Angleterre; & l’on fait que, même
alors , il chercha les occafions de revenir à la
partie de l’hiftoire.
Tant aue le portrait^ut traité par les peintres
d’hiftoire, il le fut aufli de la même' manière
, & Raphaël, le T itie n , le Vérpnè'ÿ ne !
fe doutoient pas qu’il pût y avoir une.«ma-,
mière fpécialemehc affectée à cette partie da
l’ art. Ils voyoïent là nature d’une manière
aufli grande dans le portrait., que dans i’hif-
toire, ils le traitoient avec la même largeur
de pinceau, ils donnoient la même grandeur
le même ftyle aux plis des draperies, ils ne
donnoient ni plus ni moins de valeur aux ac-
ceffoires : enfin s’ ils obfervôierit quelque différence,
eile confiftoit uniquement à exprimer
dans les têres les détails individuels qui conl-
tituent là reffemblance, & comme dans l ’hiftoire
, ils négîigeoierit les petits détails qui ne
fervent pas effentiellement a caraêtérifer l’individu.
Enfin , il en étbft de la peinture comme de
la fculptûre , dans, laquelle on peut dire généralement
que le part raie n’eft pas abandonne
| à une claffe particulière de Icülptpurs. Comme
la nature même de leur art les obligé à un©
? certaine précifion , ils font toujours reliés ca-
[ pables de‘ faire1 lé portrait.
Mais qüand les peintres' d’hiftoire ont re.-*
!’ nonce à l a jprêçifioh du déifin, quand il n’on*